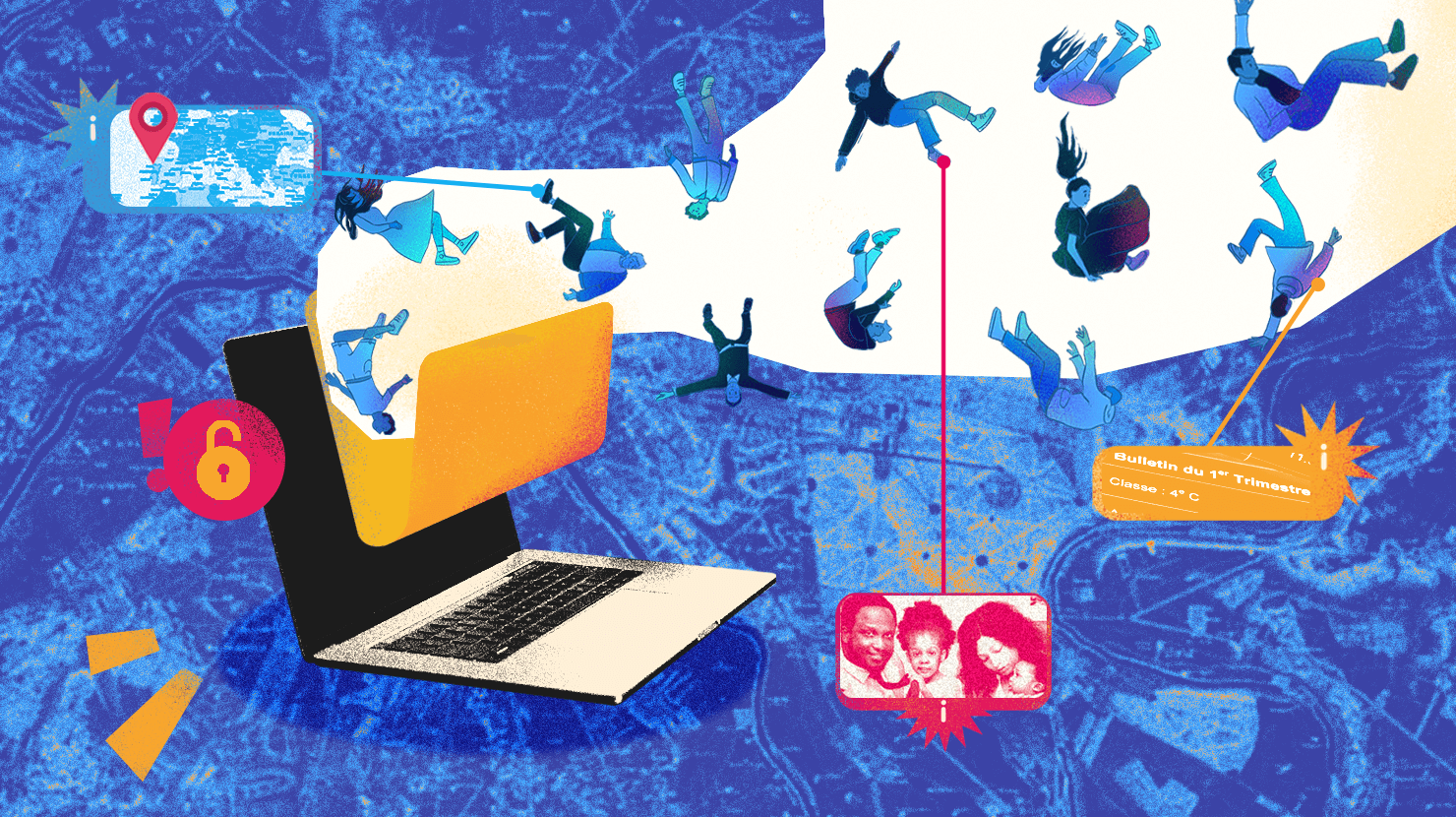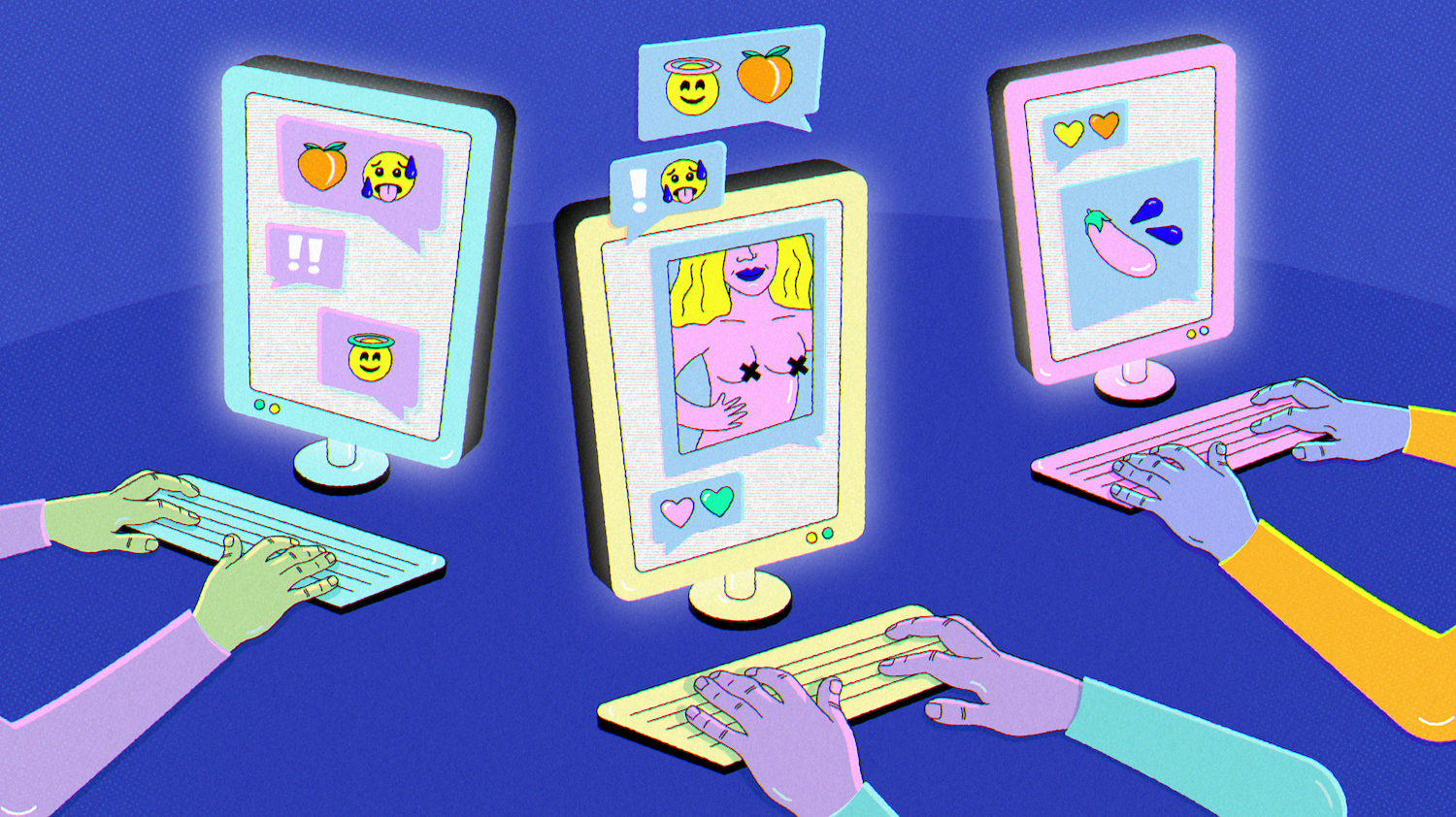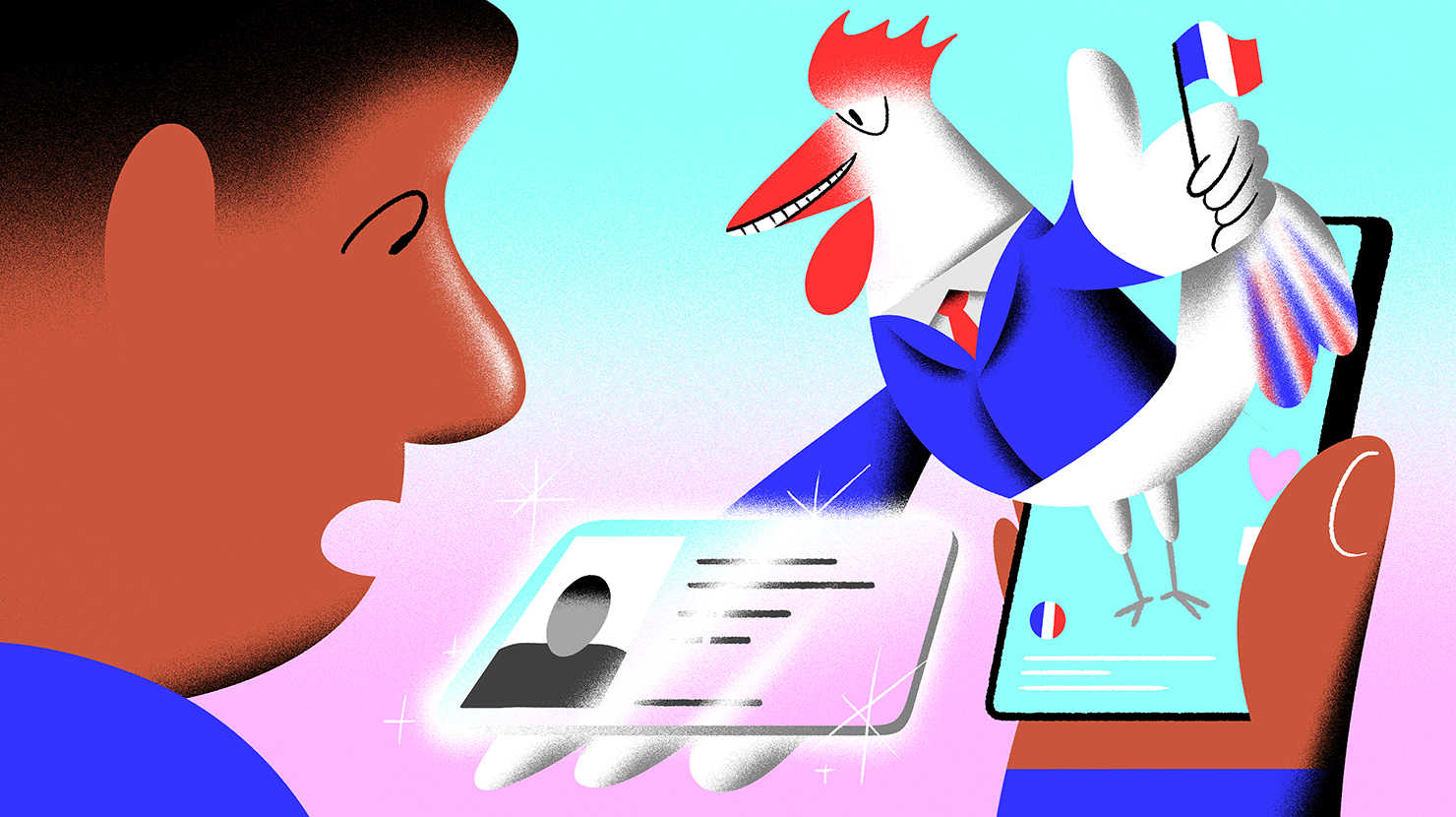Lille (59) – Mia est en sueur en plein centre-ville. Ce mois de juillet 2022 est un cauchemar. La chaleur est écrasante. Ses deux petites filles lui tiennent chacune une main : la plus grande a neuf ans, l’autre sept. Ont-elles compris ce qu’il se jouait ? Quels souvenirs garderont-elles de leur père ? Encore aujourd’hui, la mère de 44 ans en a la gorge serrée, les yeux mouillés. Elle l’a fui après de longues années de violences physiques et psychologiques cet été-là, sans savoir où se réfugier. Où dormir ? Au téléphone, les gens qui avaient accepté de les héberger leur demandent de venir récupérer le peu d’affaires qui leur reste. Le monde de Mia s’écroule. Les pires questions se bousculent dans sa tête : Pouvait-elle vraiment se permettre de partir ? Elle n’a plus de travail, de maigres économies. Mais son quotidien n’était plus supportable et sa survie était en jeu. Nouvel appel : son assistante sociale l’aiguille vers une association spécialisée dans l’accompagnement des femmes victimes de violences. Là voilà à traverser la capitale des Hauts-de-France à bout de souffle, bravache devant ses enfants, mais pleine d’angoisses et si fragilisée.
Même scénario pour Dounia, 28 ans, à l’été 2023. « J’ai tout quitté : mon appartement en région parisienne, ma promesse d’embauche… » Après son dépôt de plainte pour violences conjugales, une travailleuse sociale lui a assuré qu’elle pourrait retrouver un peu de stabilité ici. Mais la longueur des listes d’attente pour un hébergement d’urgence est aussi dramatique qu’à Paris (75). Selon les chiffres publiés par la Métropole Européenne de Lille (MEL), en moyenne 225.000 femmes entre 18 et 75 ans sont victimes au cours d’une année de violences physiques et/ou sexuelles commises par leur ancien ou actuel partenaire intime dans la région. Alors les associations sont débordées et ne peuvent pas répondre immédiatement aux besoins de toutes. Dounia est enceinte de huit mois. Elle tombe des nues. Après quelques nuits à l’hôtel, la future maman se retrouve dehors à errer dans les rues à seulement quelques semaines de son accouchement.
Mia, Dounia, mais aussi Naïma et Sofia ont eu le courage de fuir un foyer violent, avant d’être confrontées à la précarité et ses galères dans la région lilloise. StreetPress a choisi de raconter les parcours de quatre femmes issues de quartiers populaires et pour certaines immigrées. Pour des raisons de sécurité, leurs prénoms ont été modifiés et leur anonymat minutieusement respecté.

À l’été 2023, Dounia a quitté son appartement. Après son dépôt de plainte pour violences conjugales, une travailleuse sociale lui a assuré qu’elle pourrait retrouver un peu de stabilité ici. Mais la taille des listes d’attente pour un hébergement d’urgence est longue, très longue. / Crédits : Léa Guiraud
La rue ou le bourreau
Dounia a 20 ans lorsqu’elle quitte le continent africain à la faveur d’un regroupement familial. Mariée, battue, « j’ai fini par fuir mon ex-mari », conclut-elle les dents serrées. La désormais trentenaire fait partie de celles qui essuient leurs larmes avant même qu’elles ne coulent. Après plusieurs longues semaines à la rue, son errance s’est arrêtée aux portes de l’église évangéliste de la réconciliation, qui possède un centre d’accueil rudimentaire et éponyme. Il permet aux femmes enceintes ou avec enfants d’avoir un toit sur la tête pendant trente jours consécutifs. « On doit attendre 21h pour pouvoir entrer, été comme hiver. Et à 9h du matin, il faut être parti. » Des matelas sont posés à même le sol, il fait une chaleur presque suffocante. Elles sont cinq avec leurs enfants dans une petite pièce en mezzanine, où la douche fonctionne une fois sur deux. « C’est fatigant et on n’a aucune intimité. » Dounia a depuis réussi à regagner la région parisienne et a trouvé un peu de stabilité : son petit garçon est né, elle s’en occupe dans un logement à eux, loin de la brutalité. Mais ces mois à la rue et enceinte jusqu’au cou l’ont profondément marquée.
Un an. Naïma, 43 ans, a pris son mal en patience avant d’avoir accès à une aide et un logement. Elle n’est pas passée par le statut de sans domicile fixe. Elle a enduré l’attente à l’appartement familial, au côté du conjoint qu’elle souhaitait fuir. « Il disait qu’il connaissait du monde dans la police, qu’il avait déposé des plaintes contre moi », se souvient celle dont le calvaire commence quelques mois après son arrivée en France, au printemps 2022. La Maghrébine épouse un Français qui contrôle toute sa vie : insultes, dénigrement, droit de veto sur ses fréquentations, son apparence, il ne veut pas qu’elle travaille ou qu’elle apprenne le français. Naïma n’a qu’un permis de séjour et très peu de connaissances légales. Lui la persuade qu’elle risque la prison si elle demande le divorce :
« Il m’a frappée en janvier 2023. Je suis allée à l’hôpital, le médecin a vu les bleus et a fait un signalement. Mais je n’ai pas porté plainte. »
Les violences les plus connues restent les violences physiques et sexuelles, mais elles ne sont pas les seules que vivent les femmes victimes de violences conjugales. Elles connaissent aussi des violences verbales (insultes, intimidations, menaces), économiques, leur ex ou actuel conjoint les empêche de travailler, leur prend leur portefeuille, leur carte bancaire… Des violences administratives : elles sont privées de leurs documents d’identité, médicaux, ou empêchées de s’en procurer, parfois également victimes de cyberharcèlement. Dans tous les cas, elles sont victimes de violences psychologiques (propos méprisants, humiliants, dénigrement, isolement), cette forme de violence peut conduire à des addictions, mais aussi au suicide de la victime.
Si vous êtes victime de violences vous pouvez contacter le 3919 (Violences femmes info – anonyme et et gratuit). Vous pouvez également trouver sur cette plateforme les associations près de chez vous.
Vous pouvez également signaler directement en ligne une violence conjugale, sexuelle ou sexiste en cliquant ici
En cas d’urgence appelez le 17 (police et gendarmerie), le 15 pour les urgences médicales ou le 18 pour les pompiers.
Naïma décide de rentrer dans sa famille au pays pour trouver refuge. Mais elle n’est plus la bienvenue. « Ils me disent de revenir avec lui, que je ne dois pas divorcer… » Les larmes montent, elle lutte pour les contenir, secoue la tête, s’excuse pour son français qu’elle ne trouve pas assez fluide. Et reprend. La brune parle vite, comme si tout devait sortir d’un seul coup. « L’une de mes sœurs est avocate, mais elle ne m’a pas aidée. » Esseulée, Naïma revient en France et son calvaire reprend. « En octobre 2023, il a été trop loin, trop de coups. » Elle décide de se rendre au commissariat, malgré ses peurs. La Maghrébine avait déjà appelé quelques mois plus tôt, sans oser porter plainte ou s’y rendre physiquement :
« Je suis tombée sur la personne que j’avais eue au téléphone. Elle m’a écoutée et m’a dit avec un sourire que ce n’était pas grave [de ne pas avoir porté plainte avant]. Maintenant, j’étais là. »
« La psy m’a proposé des médicaments »
Après la rue et les rares nuits en hôtel, Mia et ses filles s’installent dans un squat. Dans l’ancienne maison sale et délabrée, les cafards courent au sol et les matelas disponibles sont plein de tâches. Elles dorment par terre, sur leurs manteaux. La mère paie pourtant un certain prix pour y loger – toujours moins cher que les nuits d’hôtel inaccessibles. À l’époque, Mia ne ferme pas l’œil, au sens propre : en éveil constant, elle lutte pour sa survie et celle de ses filles, voudrait les protéger de tout. « On m’a dit que j’avais un syndrome post-traumatique », lance Mia. « Pour moi, c’était un truc de soldat. » On n’est pas dans un film, se dit-elle. Elle n’a pas vécu la guerre et d’autres ont sûrement vu pire. « C’est n’importe quoi », conclut-elle. Dans la foulée, après 10 mois de ballotage, elle trouve une place en foyer. C’est quand, enfin, elle s’est retrouvée dans un vrai lit et qu’elle a su ses filles en sécurité, que « tout est ressorti » : son corps a lâché. Une sorte de burn out, lui ont expliqué les médecins :
« Je n’arrivais ni à dormir ni à me lever. La psychologue m’a proposé des médicaments. »

Quand, enfin, Mia s’est retrouvée dans un vrai lit et qu’elle a su ses filles en sécurité, son corps a lâché. Une sorte de burn out. / Crédits : Léa Guiraud
« Je ne savais même plus faire des pâtes. Ma chambre me terrifiait. » Naïma aussi raconte ce moment de fragilité psychologique. « Quand je rentrais dans la cuisine, j’avais l’impression de plonger dans le noir. » Il a aussi fallu sortir de l’emprise de son mari maltraitant. « Violence financière en me refusant l’argent et administrative, en me cachant mes papiers d’identité », énumère-t-elle. Tout était de sa faute, toujours, peu importe les faits, peu importe si c’était elle qui prenait les coups. « Il disait ensuite aux enfants que j’étais folle qu’il n’avait rien fait. » Elle a depuis tout déconstruit. Un chemin sinueux et long, sur lequel elle a trouvé de l’aide :
« Je ne me serais pas exprimée comme ça avant. C’est grâce à la psychologue, aux militantes de l’association Solfa. Je n’avais pas conscience de tout cela avant. »
L’association Solfa permet des mises à l’abri à l’hôtel dans le Nord. Elle fait aussi appel à des solutions alternatives citoyennes, comme Un abri qui sauve des vies. L’association recense les personnes qui ont des logements suffisamment grands pour accueillir une femme et potentiellement ses enfants pendant quelques jours, semaines, voire mois. Mais pour toutes ces solutions, les femmes accueillies doivent avoir des titres des séjours en règle.
Si vous avez besoin d’aide, vous pouvez les contacter directement à l’accueil de jour Rosa, pôle violences faites aux femmes, au 94 rue de Wazemmes, à Lille sans rendez-vous. Vous pouvez aussi contacter les cellules d’écoute : 03 20 57 94 27
Si vous souhaitez participer à aider ces femmes et le travail de cette asso, vous pouvez vous renseigner sur le site de Solfa.
Libérée ?
Sofia, 54 ans, a décroché un logement social dans la région lilloise après six mois d’attente. Ses deux enfants ont chacun leur chambre, elle dort dans le salon sur le petit matelas donné par l’association Solfa, qui a une valeur sentimentale très importante. Une façon de se souvenir du chemin parcouru pour accéder à son indépendance et sa sécurité. La quinqua ne s’estime pas complètement sortie de l’emprise de son ex-mari pour autant. Mariée en 1996, les violences psychologiques ne commencent que 17 ans plus tard. Il l’enferme, l’humilie et devient violent avec sa fille. La reconstruction est sinueuse et le croiser devant les tribunaux est une souffrance pour cette femme et ses enfants :
« J’ai demandé la garde exclusive de mon fils de 14 ans, le rachat des parts de la maison et j’attends le verdict. J’ai peur, peur qu’on oblige mon fils à retourner chez lui. »
Naïma aussi attend. Son ex-mari refuse le divorce. Elle devrait tout de même réussir à entériner cette union ce mois de juin. « J’ai peur qu’on ne reconnaisse pas mes souffrances. Je me dis encore parfois : “j’ai trop peur, j’arrête tout”. » Elle préférerait laisser tomber la procédure de divorce pour être certaine de ne pas le recroiser. Depuis sa fuite, elle l’a revu une fois. « Il m’a envoyé un regard méchant. » Cette brève altercation la hante. Comme Mia, qui n’a qu’une crainte : être retrouvée par son ex-conjoint. L’horizon s’est pourtant éclairci pour elle et ses filles : elle a été naturalisée, a trouvé un logement. Elle tient toutefois l’adresse secrète, craintive.
Dans le cas de Sofia, son ex a réussi à retourner ses deux aînés – désormais adultes – contre elle. « Ils savent où me trouver, mon avocate a mon adresse et leur a donné. » Elle aurait aimé être comprise et soutenue. Tout de même, elle raconte « se sentir mieux ». Cette fuite est un second départ pour ses deux ados et elle :
« Il était persuadé que je ne serais pas capable de partir, de m’occuper de moi. J’ai prouvé que je le pouvais. La guerre devant les tribunaux n’est pas encore terminée. Mais j’ai gagné la plus belle des batailles. »
 Soutenez
Soutenez