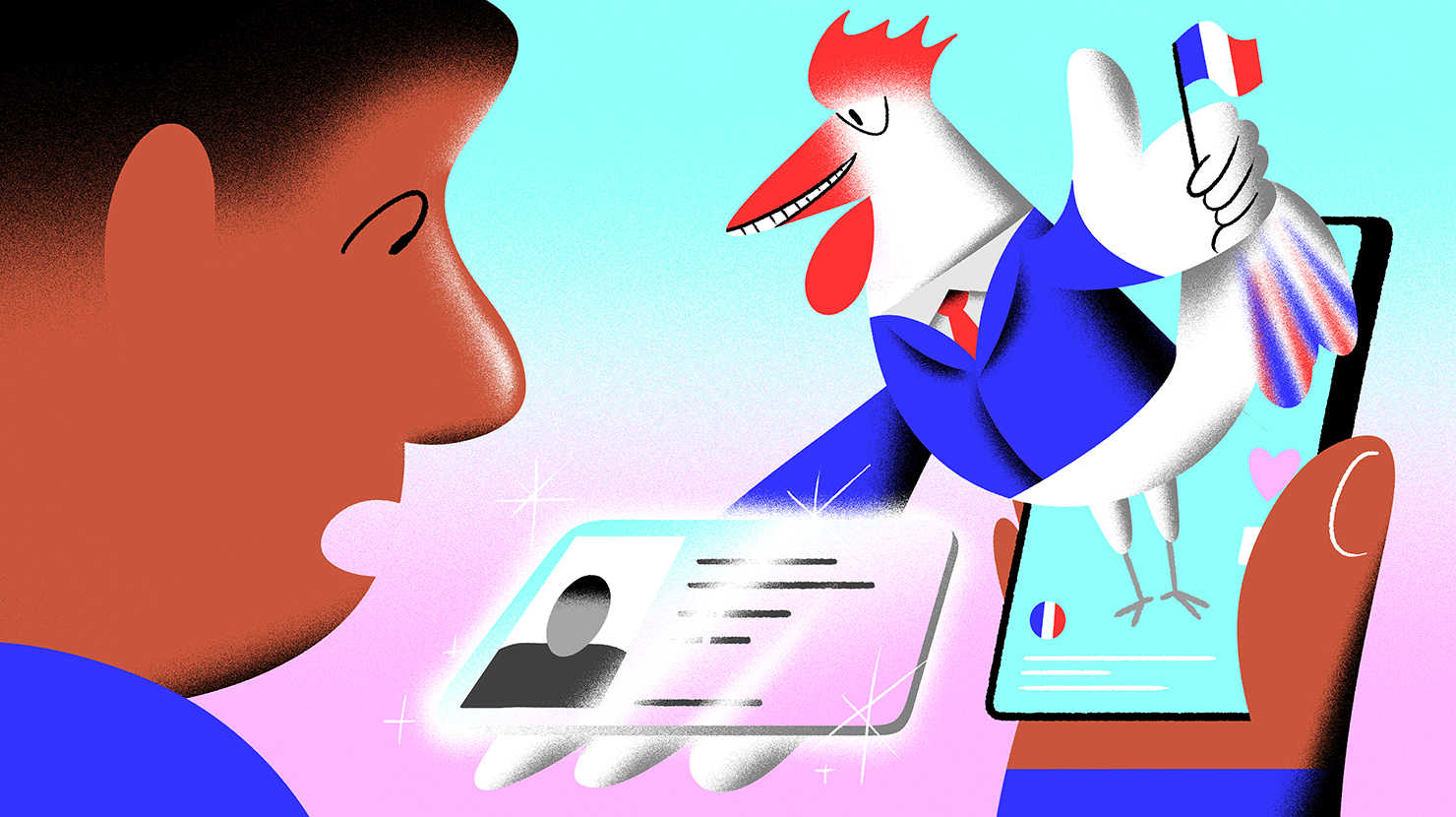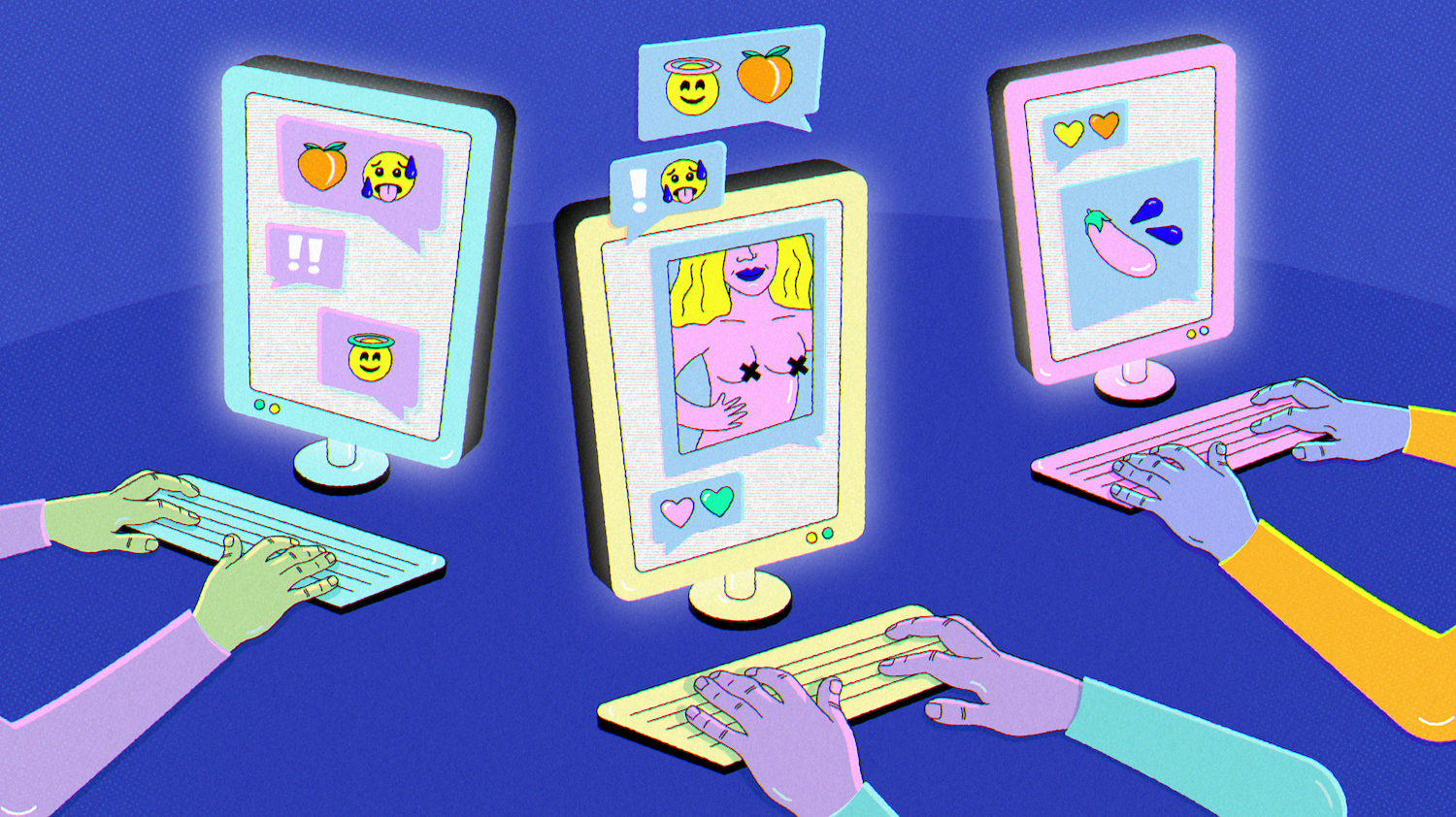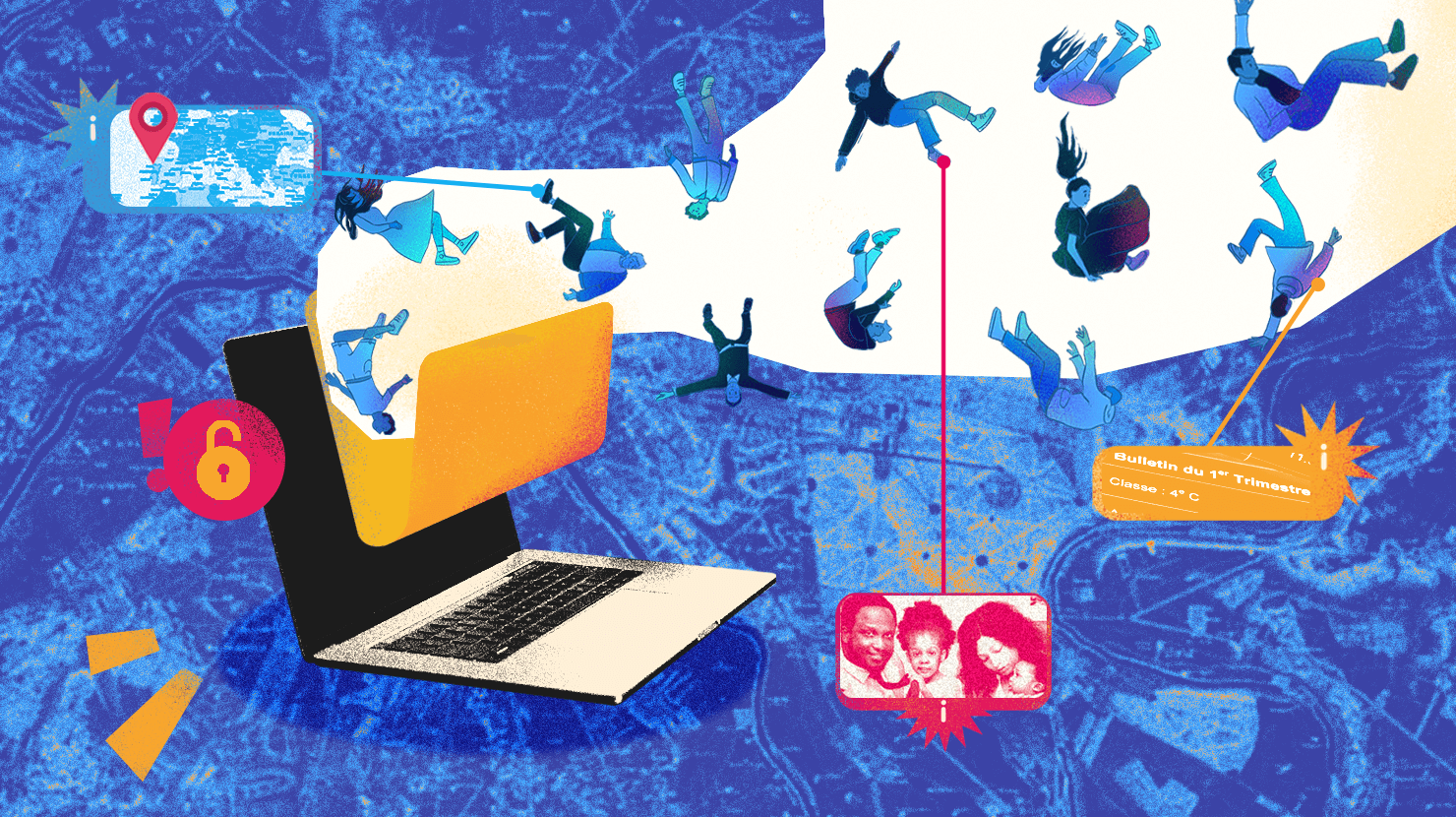New-York, 1998 – Driver, alors au top de sa carrière après la sortie de son premier album Le Grand Schelem, est dans la capitale du hip-hop mondial pour enregistrer un son avec des membres du Wu-Tang Clan. Le rendez-vous est fixé dans un studio du centre de Manhattan. En arrivant sur place, il se rend compte que c’est au mythique Quad Studio, qu’il va enregistrer, là même où Tupac s’est fait tirer dessus à peine 4 ans plus tôt. «J’ai lu tellement d’articles sur le shooting que j’essaie de faire une reconstitution des évènements.» raconte le quarantenaire, encore des étoiles dans les yeux 24 ans après : « Je repère le fameux ascenseur : “Ok Tupac il devait être là, les mecs qui étaient avec les journaux qui étaient cachés avec les flingues là” Je suis comme dans un film c’est fou. » Pour un gamin de 22 ans bercé au rap US, le symbole est fort.

J’étais là, Driver & Ismaël Mereghetti, co-édité par les éditions Faces Cachées et Hors Cadres. /
30 ans que Driver, un surnom qu’on lui a donné quand il était gamin pour se moquer de son incapacité à faire du vélo, traîne sa grande carrure dans le rap. Il a posé avec Lunatic, Diam’s, Dany Dan, des membres du Wu-Tang Clan donc, enregistré ses premiers sons dans l’appartement de Desh, DJ mythique du Ministère A.M.E.R. Un de ses morceaux avec l’artiste marocain Jalal El Hamdaoui s’est retrouvé dans la bande original du Dictator, blockbuster de l’acteur américain Sacha Baron Cohen. Il a négocié avec un narco colombien pour que sa copine puisse tourner dans son clip et tourné un film en Hongrie avec Max Boubil. Bref, une vie digne d’un film. Mais pour l’instant, il se contente d’une autobiographie, «J’étais là » écrit avec le journaliste Ismaël Mereghetti et co-éditée par les éditions Faces Cachées et Hors Cadres. Autour d’un monaco dans un bar du 19ème arrondissement, casquette vissée sur la tête et bombers sur le dos, Driver se raconte, et à travers lui tout un pan de la culture française.
Tu te rappelles de la première fois que t’entends du rap ?
Ça commence avec le rap US. Eric B and Rakim, Public Enemy, Run DMC … On est à la fin des années 80 j’ai 11 ans. Je deviens fou sur Straight Outta Compton de NWA.

Voyage à Dallas en 1998. / Crédits : DR.
Et le rap français ?
Ça doit être un an plus tard. Avec mon frère dans la chambre, on passe beaucoup de temps à chercher des nouvelles stations, un peu au hasard, sur la radio. Et un dimanche soir, on tombe sur Radio Nova. C’était l’émission de Lionel D et Dee Nasty, Deenastyle. Y’a le crew de MC Solaar, 501. Ils rappent des histoires qui pourraient nous arriver, qu’on entendait pas dans la chanson française “classique”. Une claque magistrale, à ce moment-là je sais que je ne veux écouter que ça.
Immédiatement tu te mets à écrire tes propres freestyle ?
[Il rigole] Non au début j’allais au collège et rappais les morceaux qui passaient sur Nova. Jusqu’au jour où y’a un mec qui écoutait lui aussi la radio et qui dit devant tout le monde : “Tu mens c’est pas toi ça !”. Je me suis mis à écrire mes propres textes pour plus que ce genre d’incidents n’arrive.
Comment on se créé sa culture rap quand on est un gamin de Sarcelles à une époque où le rap est pas si développé que ça ?
Quand je découvre le rap, je tombe amoureux pas que d’une musique, mais d’une culture. Je veux tout savoir, et je veux pas écouter un disque de temps en temps. Sauf qu’on n’est pas riche. Je découvre qu’à la FNAC on peut voler d’une certaine façon. Au début c’est pour ma consommation, puis vite je me rends compte que je peux en faire un petit business. Tous les samedis je faisais Les Halles, les Ternes et Montparnasse, les plus faciles à l’époque. 9 CD par week-end, 7 pour vendre, 2 pour moi. Je traîne les magasins de vinyls de Châtelet. Je fais des connexions, je rencontre des gens. Ce qui fait que j’avance dans ma carrière de rappeur, je me fais ma culture rap, et un peu d’argent de poche !
Pour revenir un peu en avant, tu commences donc à rapper quand t’as 12-13 ans, et à 14 ans, tu te retrouves à donner des cours à l’université Paris 8 … Qu’est ce que c’est que cette histoire ?
Ça commence à Radio Beur. Je découvre une émission animée par celui qui allait devenir Alibi Montana, qui passe tous les mercredis après-midi et où tu peux venir faire des freestyles. J’ai réussi à trouver d’autres mecs de Sarcelles qui rappaient vite fait, on monte un groupe et on va faire des freestyle là-bas. Et un jour t’as un vieux monsieur qui est là, Georges Lapassade, qui est prof à Paris 8 et qui nous dit “J’adore ce que vous faites, j’organise un festival, j’aimerais que vous veniez rapper.” On fait le concert, on s’en sort bien et en sortant je tombe sur Stomy Bugsy qui me félicite ! Pour moi c’est un héros, il passe sur Nova, il vient de Sarcelles ! Je me sentais disque de platine.
Et donc à Paris 8 ce prof avait monté un studio où on pouvait venir faire de la musique et en échange on devait parler de notre art à des étudiants. Ça n’avait aucun sens, j’avais 14 piges et j’apprenais la vie à des gens qui ont 22-23 ans ! Mais si il fallait passer par là pour accéder au studio, ça m’allait.
Ton premier album Le Grand Schleme arrive quelques années plus tard, en 98, en pleine période de l’âge d’or du rap français.
C’est ce que dit Booba dans le morceau La Lettre “paraît que l’industrie du disque a saigné et que les negros arrêtent pas de signer” c’est clairement ça. A cette époque là Skyrock est obligée de passer du rap français et les maisons de disques ont besoin de rappeurs. Pour avoir un rendez-vous en label t’as juste à dire que t’es rappeur et t’es reçu. Sauf qu’à cette époque là j’étais avec deux producteurs, et ça se passe super mal. Ils arrivent aux rendez-vous avec leur pitbull, ils s’embrouillent entre eux. Ils font peur aux gens ! Du coup personne veut me signer. Au bout d’un moment on se sépare et le premier rendez-vous que j’obtiens tout seul, ce sera ma signature, chez Polydor.
Tu décroches ton premier contrat et ta première avance, pour tes parents ça devient sérieux à ce moment-là ?
Ils ont appris que je faisais de la musique quand j’avais 15 ans. Je devais faire un concert à Massy, un soir de semaine et le lendemain je partais en voyage en Angleterre, j’étais obligé de leur dire. C’était la première fois que j’allais toucher de l’argent avec la musique. J’ai vu dans le regard de mon père qu’il comprenait pas cette histoire de rap mais qu’il avait en face de lui un fils responsable qui va travailler pour gagner son propre argent.
Quand je touche mon premier chèque d’une maison de disque, je rentre chez moi et mon père était en train de faire les comptes. Il se creusait la tête pour savoir comment on allait passer le mois. Je lui dit que cette histoire de musique, ça a donné quelque chose, que j’étais là. Il m’a pris dans ses bras et a levé les yeux aux ciels. A partir de ce moment-là, ouai, ils ont été avec moi.
Quelques années après tu feras un feat avec Manu Dibamgo, qui est originaire du même village que ton père au Cameroun. Ça représente quoi pour toi ?
Quand je feat avec lui sur mon deuxième album, c’est un cadeau. Je le fais d’abord pour moi, mais surtout pour mes parents et mon père. Je veux qu’ils soient fiers de moi. La boucle est bouclée, c’est comme si j’étais né au village avec eux.

Driver feat. Julia Channel. / Crédits : DR.
On a l’impression que une grande partie de ta carrière consiste à te faire des kiffs, y’a par exemple l’épisode à Monaco.
Quand je sors mon premier album, le magazine l’Affiche me propose une interview originale, et comme je suis là pour exaucer tous mes rêves je dis “ce serait bien qu’on aille à Monaco”, vu que je suis fan du club. Et il se trouve que Philippe Christanval, qui joue à Monaco, vient de Sarcelles ! Du coup je me retrouve à visiter tout le club avec Henry et Christanval, Monaco gagne et surtout ils passent mon son “Aie Aie Aie” à la mi-temps dans le Louis II. J’ai envie de pleurer !

De G à D : avec l'actrice Lisa Raye / en Colombie / sur le tournage de Robin des bois, la véritable histoire. / Crédits : Dr.
Un personnage qui revient souvent dans le bouquin et dans ta vie c’est Sarcelles, ta ville. Qu’est ce que ça représente pour toi ?
C’est toute ma vie, j’y habite encore. Déjà dans le paysage rap, on a des légendes qui viennent du coin, Ministère A.M.E.R et puis les carrières solo de Stomy Bugsy et Passi. Mais plus largement Sarcelles c’est ma base. Quand je sors mon premier album, j’étais vraiment dans la lumière, j’allais dans des soirées mondaines avec des gens de la télé, ça peut vite faire perdre la tête. Mais vu que je rentrais toujours à Sarcelles, mes potes me traitaient comme si j’avais jamais fait de musique. Ils ne m’ont pas mis sur un pied d’estale, ils ne m’ont pas descendu non plus. J’étais Frédéric.
Ton attachement à Sarcelles t’as empêché de faire un feat avec Passi.
Y’a eu une guerre de quartier qui a causé un mort, et il se trouve que dans l’équipe de l’assassin il y avait Passi. Pendant longtemps une partie de la ville lui en voulait. Même le fait qu’il explose tout en solo après cette histoire, ça rend dingue une partie des gens. Du coup y’a aucun membre du Ministère A.M.E.R sur mon premier album à cause de cette histoire. Passi n’habitait plus à Sarcelles, Stomy non plus, mais moi si. Ça fait que si y’a un morceau avec eux, les conséquences c’est pour moi.
Mais quelques années après j’ai écrit un morceau pour Stomy, Sarcelles. Ça faisait un moment qu’il habitait plus ici et il avait besoin d’un morceau que les jeunes de la ville pouvaient comprendre.
Dans ton morceau Changer de vie, déjà sur ton premier album, tu dis justement qu’il faut que “tu changes de vie” que tu partes de Sarcelles, et pourtant…
Ouai, c’est fou pour un mec qui est jamais parti. Je me disais que je partirais quand je me sentirais détesté. Sauf que je me sens à l’aise tout le temps ! Mais après tout peut arriver, même quitter le pays. J’ai eu un gros choc avec la Colombie. Ou les Etats-Unis. Le jour où j’ai posé le pied à Los Angeles je me suis senti chez moi.
C’est comment ton premier voyage aux Etats-Unis ?
Je devais rejoindre Boyz II Men pour un de leur concert parce que j’avais fait une reprise avec eux. On me dit que le voyage c’est dans le Mississippi. A ce moment là quand t’es français dans le hip-hop, les Etats-Unis c’est New-York. Et puis j’entends Mississippi je pense à Mississippi Burning, un film sur le KKK. Je me dis “Ils veulent m’envoyer dans un endroit où ils brûlent des noirs ?”. Bon j’arrive à Jackson et je vois que des noirs, ça me rassure. En interview dans les coulisses, Shawn, le leader de Boyz II Men, dit que mon flow lui a fait pensé a Biggie, je suis comme un fou.
Une autre histoire aux Etats-Unis, à New-York, où y’a une sombre histoire d’enlèvement.
Je pense que les gens de la maison de disque quand ils vont lire le bouquin ça va leur faire bizarre, ils sont pas au courant de cette histoire. C’était en 2002, je préparais mon deuxième album. Je voulais faire un feat avec une rappeuse américaine et je propose Gloria Velez, qui rappe un peu et surtout était la Vixen numéro 1 aux Etats-Unis. Moi je suis amoureux d’elle en fait [Il rigole]. Bref, je crois qu’on devait la payer 10 000 euros pour le feat mais le jour de l’enregistrement elle vient pas. On comprend pas trop, son manager nous explique qu’ils ont pas reçu l’argent et qu’elle viendra pas en studio tant qu’elle l’aura pas eu. En fait Polydor a bien envoyé l’argent mais s’est trompé dans le numéro de compte et qu’ils doivent attendre de le récupérer avant de le renvoyer. C’est là où les producteurs de Gloria ont une idée de génie, ils me disent : « Ce qu’on va faire c’est qu’on va te kidnapper. En vérité t’es libre, on te fait rien. Mais il faut que ta maison de disque le pense et l’argent va vite arriver ». Polydor panique, ils envoient l’argent à Gloria, ils m’en renvoient parce qu’ils ont peur que je reste plus longtemps que prévu. On est tous gagnants en fait, je fais la fête en boite avec mes ravisseurs, c’était beau.
Côté musical, tu passes par un gros moment de passage à vide après ton deuxième album, qu’est ce que qu’il se passe ?
On doit être vers 2005-2006. J’avais signé avec Polydor pour 3 albums mais ils me rendent mon contrat à la fin d’exploitation du 2ème. Et à ce moment là je perds confiance en moi. Dans ce milieu, quand tu marches, on te regarde avec respect. Quand c’est fini, le regard est différent. J’avais l’impression que plus personne voudrait travailler avec moi, que j’étais devenue une merde. Mark de Bombattak me sort la tête de l’eau. Il me convint de faire une compilation avec pleins d’artistes. J’ose appeler Diam’s, que je connaissais depuis plusieurs années, je lui dit “ça va mal pour moi, je fais plus rien. Je monte un projet, j’ai besoin de toute la force dessus”. A l’époque elle est sur le toit du monde mais elle accepte. Elle se rend pas compte que le couplet et demi qu’elle m’a donné me sauve la vie.
La compilation Self Defense sort donc chez Allmades, le label que t’as monté avec Jean-Pierre Seck, puis vous vous mettez à produire un jeune talent, Black Kent, et ça va mal se finir.
Aux Etats-Unis je vois des rappeurs devenir producteurs et je me dis que je veux faire ça. En Black Ken je vois un diamant brut. Je l’invite sur Self Defense, la connexion fonctionne bien. On le signe. On sort des clips, on a une grosse présence sur Internet, les gens commencent à apprécier ce qu’il fait. Mais les choses se dégradent pour diverses raisons, on s’embrouille et on se sépare.
Tu fais des vidéos avec Tonton Marcel pour raconter l’embrouille, lui un son. Mais ça va jusqu’à une baston.
On a bossé avec Black Kent de 2007 à 2010 je crois. La baston, ça doit être un an plus tard, sur le quai du RER aux Halles. J’ai pas pu m’en empêcher, je l’ai croisé et je lui ai sauté dessus.
A LIRE AUSSI : Tonton Marcel, le cuistot qui interviewe le gratin du rap français
Avec le recul tu dirais que t’étais trop rappeur pour être producteur ?
Un producteur ça doit penser à ses intérêts en premier. Mais moi en tant que rappeur, je vais aussi penser aux intérêts du rappeur. Des moments où Jean-Pierre disait “Non ça se passe pas comme ça” je disais “non mais comprends le, parce que dans sa tête c’est comme ça, je le sais je l’ai vécu.” Quand on s’est embrouillé, beaucoup de gens m’ont dit “faut pas mettre d’affectif comme ça.” Sauf que c’est pas une boite de conserve que j’ai en face de moi, je vais en studio avec ce mec là, je traine avec lui. Quand tu dois créer, ça vient du cœur. Si je dois recommencer à produire quelqu’un, je remettrais de l’affectif et c’est normal.
A la fin du livre, tu évoques le fait que tu es passé très proche de la mort à la suite à une erreur médicale. Qu’est ce que ça fait de voir la fameuse lumière blanche ?
Je voulais maigrir mais sans passer par des régimes ou le sport. J’ai fait une opération qui s’appelle Sleeve, où on te retire une partie de l’estomac. Après l’opération, j’ai eu une douleur aiguë dans l’estomac. Il s’avérait qu’un point de suture avait été mal refermé. Mais un moment mes yeux commencent à se révulser. Je me sens partir. Et en effet, j’ai vu cette écran blanc qu’on voit dans les films, il existe ! A ce moment-là j’ai vu ma famille, j’ai vu une fille que je pensais juste apprécier mais qui se révèle visiblement plus importante pour moi. Je me dis que je vais me battre, pour mes proches.

De G à D : Oxmo Puccino / Dany Dan / Alibi Montana et Morsay / Crédits : DR.
Depuis presque deux ans, tu produis entre autres choses, le podcast Featuring, dans lequel tu reçois des personnalités importantes du rap français, de DJ Kore à Oxmo en passant par Manu Key. C’est important de partager aux jeunes générations cette histoire du rap français ?
Oui clairement. J’ai pleins de jeunes qui viennent me voir en me disant qu’ils apprennent pleins de trucs sur une époque qu’ils ont pas vécu. Si je peux avoir un rôle de passeur, ça me va. Mais ça me met une pression aussi. On vient de m’appeler pour aller parler dans une école de mon parcours, c’est tellement de responsabilités pour moi ! A la base je suis juste un mec qui kiffe la musique, en faire, et tout d’un coup t’as cet espèce de poids. Je l’ai pas choisi mais peut-être que je vais devoir passer par là.