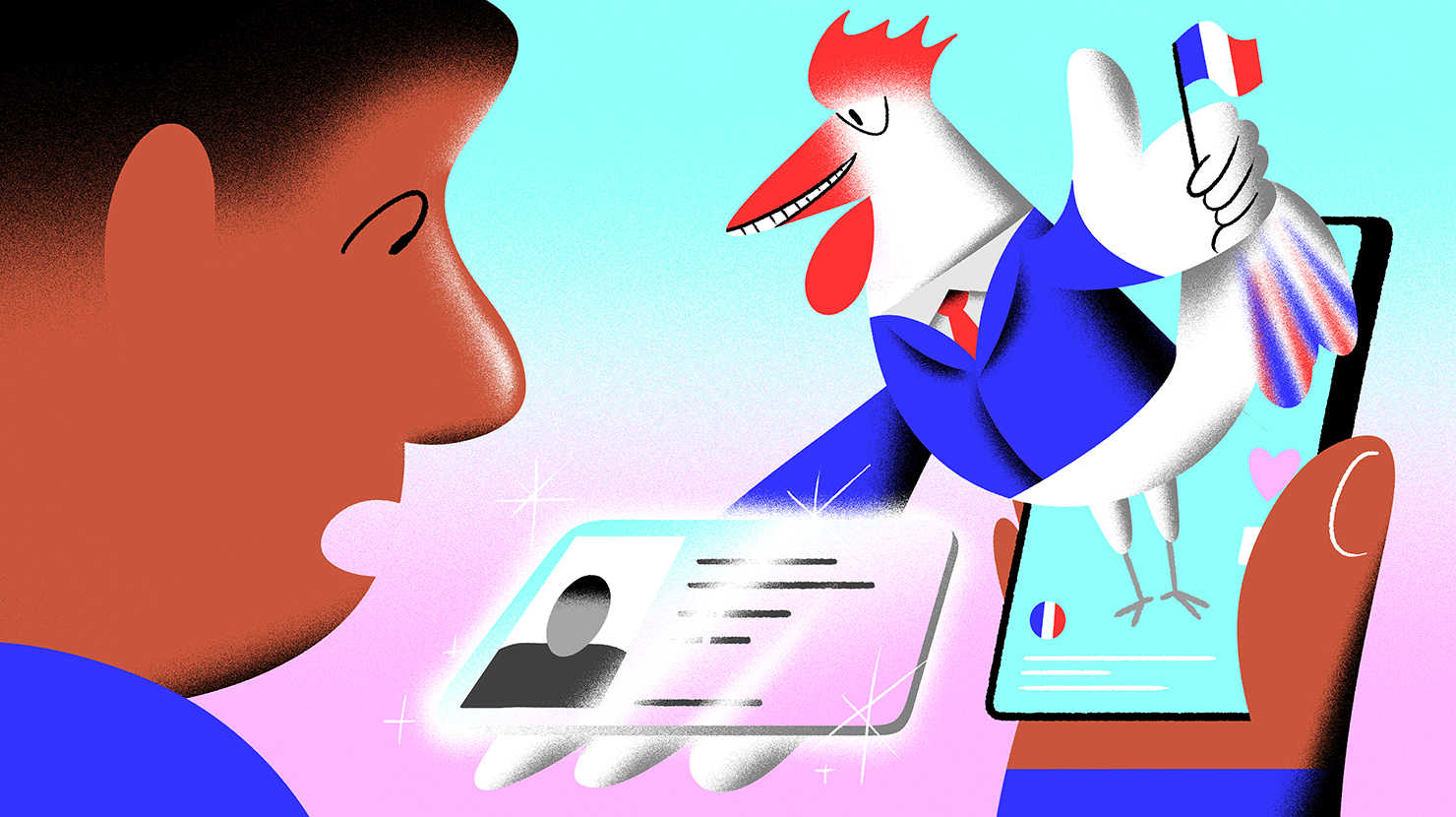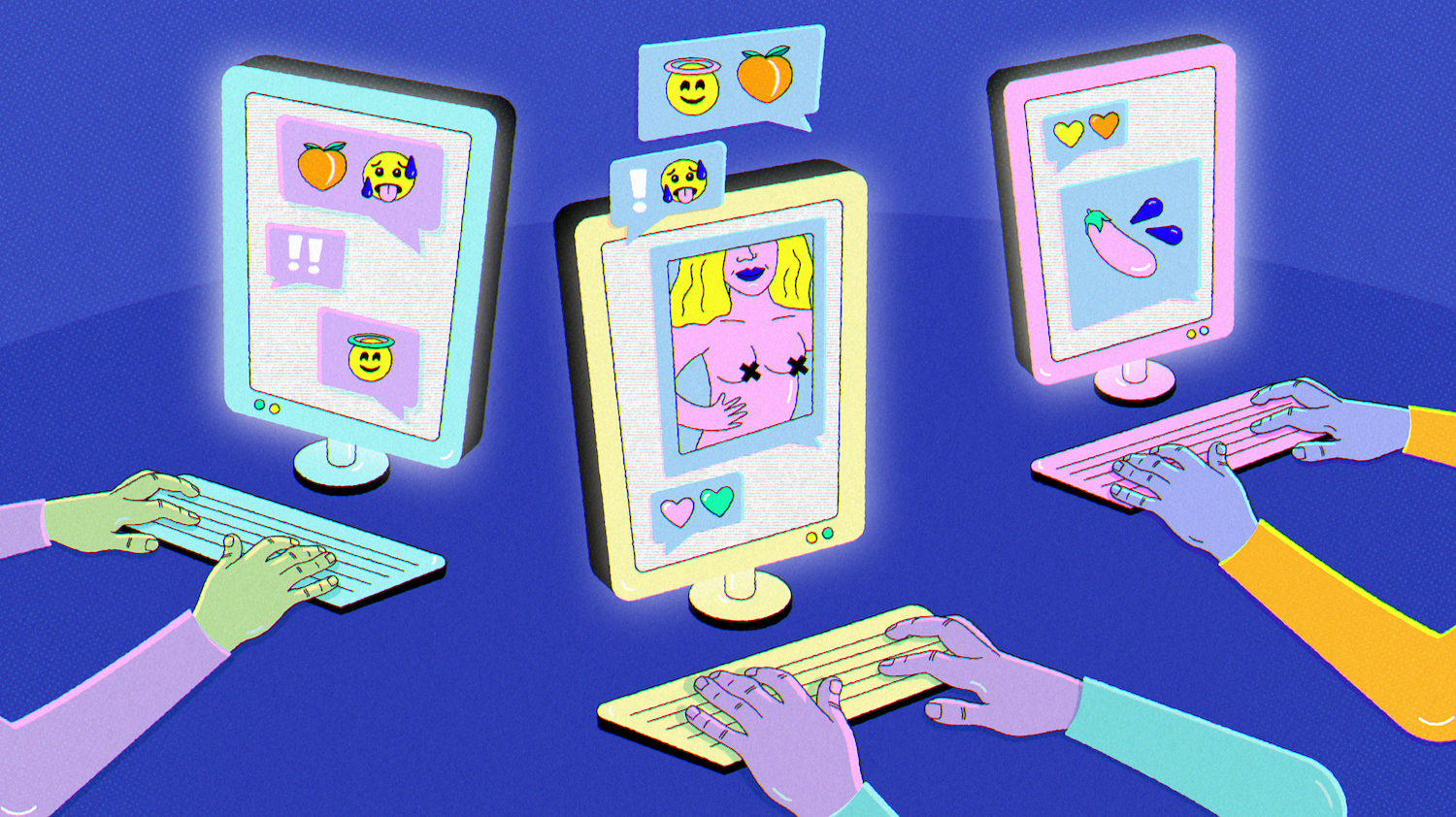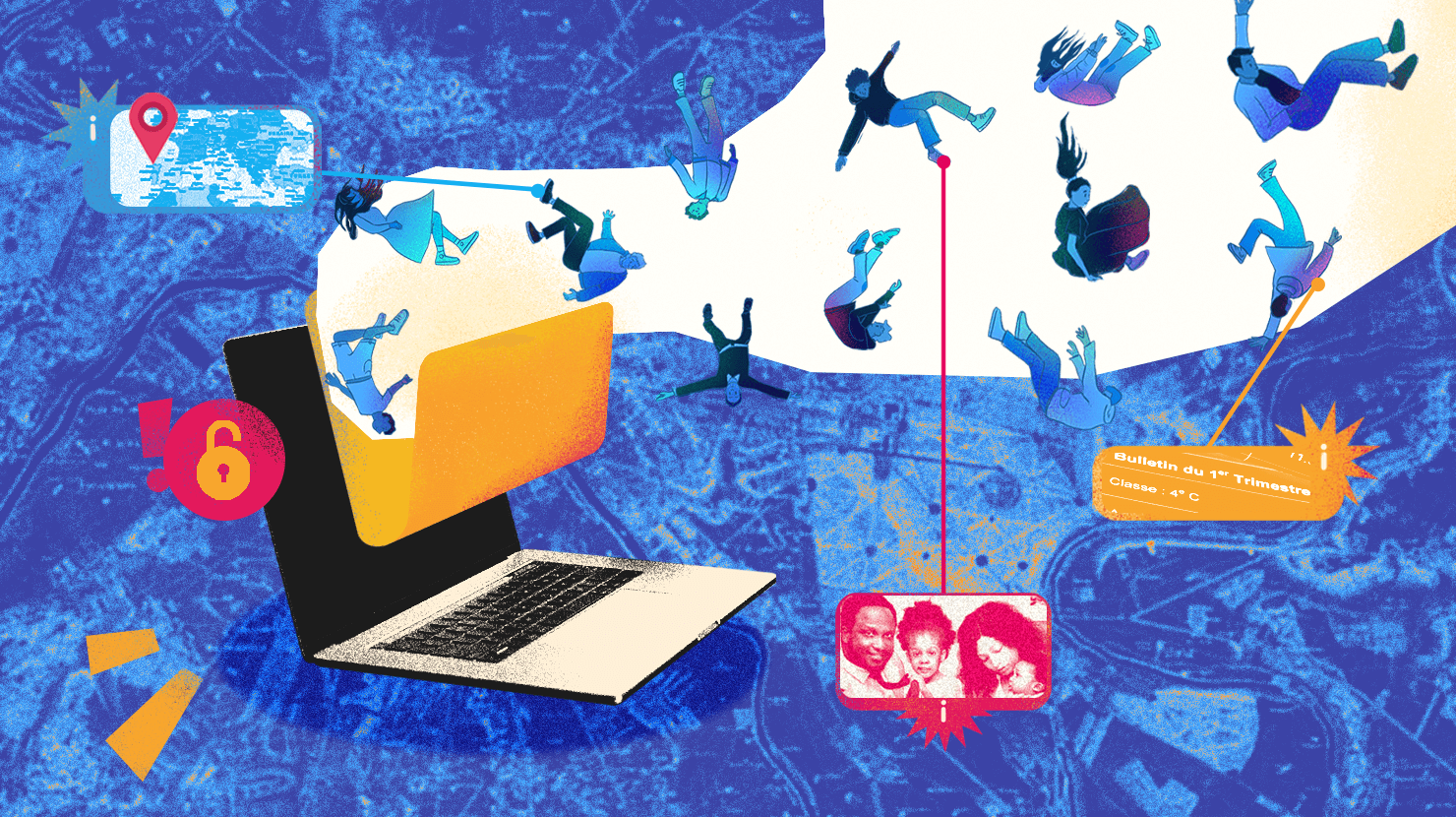« J’étais proche du burn out. » Florence Duvergier est avocate en droit des étrangers à Grenoble. Pendant huit ans, elle s’est chargée des demandes d’asile de migrants. « Pour un dossier gagné, c’est quinze de perdus », regrette-t-elle. Le 31 décembre, elle a tout arrêté. Trop difficile de supporter la partialité des juges, l’urgence des cas avec certains de ses clients au bord de l’expulsion et les échecs perpétuels malgré la solidité des plaidoiries :
« J’avais pris vingt kilos, j’avais mal au genou. Je me suis dit que je me maltraitais physiquement. »
Comme Florence Duvergier, de nombreux avocats qui accompagnent les migrants dans leurs démarches juridiques témoignent de leur épuisement.
Avoir ses clients en danger
« J’ai déjà donné de l’argent à des clients pour qu’ils puissent manger », raconte Julie Allard, qui a été avocate au barreau de Nantes. Une autre fois, une famille qu’elle défendait était à la rue, elle leur a donné une tente. Des actes qui sortent de sa fonction. Mais il est parfois difficile de ne pas se laisser submerger. « C’est très violent. Les gens nous racontent des choses horribles. En tant qu’avocat, on fait un peu tampon », confie Mathilde Robert. Sa voix cache mal l’émotion. La jeune avocate au barreau de Paris raconte comment, depuis juin, elle a parfois du mal à prendre du recul sur les récits de ses clients :
« On n’oublie pas leurs histoires une fois rentré le soir. Certains dossiers m’ont rendue malade. »
Une fois, elle a vu une mère se rendre aux urgences pour que son bébé soit nourri. Son droit d’asile avait été refusé, elle ne pouvait pas travailler et n’avait aucune ressource.
Sylvain Gauché s’estime moins exposé au barreau de Grenoble. Il ne traite que certains dossiers concernant le droit des étrangers et ne touche pas au droit d’asile. Mais il fait écho pour ses collègues : « Tous trouvent ça très dur. L’asile surpasse tout en terme d’émotion, c’est très compliqué à gérer je pense ». « C’est des coups de massue sur la tête », assure sa collègue Florence Duvergier, qui poursuit :
« La charge émotionnelle est plus prégnante que dans d’autres domaines du droit : les gens sont plus aux abois, ils te sollicitent beaucoup humainement. »
Quand certains recours échouent, cela signifie voir repartir ses clients pour un pays dangereux, être impuissant devant des familles séparées ou des mères à la rue.
Délais courts partout, justice nulle part
Autre cause de mal-être, les procédures aux délais invraisemblables. L’Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF) est l’une des décisions courantes à laquelle les avocats sont confrontés. C’est le préfet qui la prend. Si elle est « classique », elle peut être contestée pendant 30 jours. Mais si elle est « sans délai », le compte à rebours tombe à… 48h. Deux jours à peine pour monter un dossier, rencontrer le client, préparer l’audience, parfois trouver un interprète.
À LIRE AUSSI : Famille séparée, femmes enceintes et enfants arrêtés pour remplir un charter pour l’Albanie
« On se retrouve à faire des recours un peu pourris. Et, surtout, à calculer tout, tout le temps. Si la notification est tombée le jeudi à 8h, la fin du délai est samedi 8h », raconte Florence Duvergier. « Les procédures sont très rapides et cela a un impact sur les cabinets. C’est difficile de faire des recherches poussées et de bien préparer un dossier en aussi peu de temps », confirme Camille Escuillé, avocate au barreau de Paris.
Une justice politique ?
La vision de la justice de ces avocats s’est écornée un peu plus à chaque dossier. « Je n’y crois plus. Le système est mal foutu », s’énerve Florence Duvergier. Peu importe le travail effectué en amont, selon elle. Certains juges sont connus pour ne gracier personne. « Tout dépend du magistrat sur lequel on tombe. C’est assez insupportable. »
À LIRE AUSSI : « Madame 3% », la juge qui expulse les sans-papiers plus vite que son nombre
« Parfois, on sait qu’on a juridiquement raison, et on se prend une réponse de la justice administrative qui n’est pas à la hauteur de ce qu’on attendait », ajoute, résignée, Camille Escuillé. Mathilde Robert, la jeune avocate, va jusqu’à parler de « violence institutionnelle » :
« Le cynisme de la préfecture est hallucinant. »
Elle a vu ses clients vivre l’enfer pour obtenir un rendez-vous préfectoral : faire la queue pendant des heures, avoir affaire à des gens désagréables, être méprisés… Sans pour autant avoir un rendez-vous à l’autre bout.
« Il y a une vision politique des choses. Et des préjugés sur nos clients. C’est révoltant », fustige Julie Allard, qui a été avocate au barreau de Nantes. Des juges lui ont déjà rétorqué que ses clients pouvaient dormir dehors décemment, qu’il ne faisait « pas si froid ». Une autre fois, les personnes qu’elle a défendues étaient trop bien habillés pour être dans le besoin. Désenchantée, elle ajoute :
« J’avais une vision idéalisée de la justice et des institutions. Je pensais qu’un juge était indépendant, impartial, qu’il allait tout faire pour faire respecter le droit. »
Elle aussi a plaqué sa carrière dans les tribunaux. « J’étais tout le temps le nez dans le guidon. Si je n’avais pas arrêté, j’aurais fait un burn-out. » Elle n’a pas lâché sa robe pour autant. Julie Allard a pris un virage militant en créant « Aux frontières du droit », un spectacle où elle questionne le droit et la politique d’immigration. « Avoir un regard plus distancié et plus politique me manquait. »
S’entraider
Certains baveux tiennent bon, mais ce n’est pas sans effort. « Avec le temps, il y a une forme de distanciation, d’habitude qui se crée. Un peu comme un chirurgien qui exécute les gestes mécaniquement », résume Sylvain Gauché, aujourd’hui blindé émotionnellement. Ils déploient des stratégies pour se protéger. « Je rappelais à mes clients que je n’étais pas une assistante sociale. J’essayais de passer par mail et pas par téléphone », détaille Florence Duvergier.
Entre eux, ces avocats se serrent aussi les coudes. Ils ont créé l’ADDE (Association pour la Défense des Droits des Étrangers), qui leur permet d’échanger leurs expériences. « Ça nous permet d’exorciser. On pousse des coups de gueule, on partage un certain pessimisme devant les projets qu’on nous pond », témoigne Camille Escuillé (1). Elle en rigole :
« On a tous un adversaire commun : la préfecture. »
« Ce groupe permet également de mettre en place des stratégies collectives intéressantes. On tente dans notre tribunal des choses déjà faites ailleurs », explique Sylvain Gauché. Un partage de vécus qui permet de mieux hacker le code des étrangers.
Mathilde Robert tire beaucoup de motivation de ce collectif. « On se tire vraiment vers le haut. » Une situation inédite pour la jeune avocate :
« J’ai l’impression qu’on est les seuls à être autant en mode guérilla. »
L’aide juridictionnelle à la traîne
L’autre point noir, ce sont les finances. La plupart des migrants n’ont pas les moyens de supporter le coût des procédures. Dans ces cas-là, un dispositif existe : l’aide juridictionnelle. Les frais de justice sont alors pris en charge par l’Etat, qui indemnise les avocats.
Mais ces derniers décrivent un système dysfonctionnel, constamment menacé par les réformes. Sans parler des délais d’indemnisation pour ces professionnels, qui dépassent parfois un an. « C’est la croix et la bannière. » Florence Duvergier s’agace. Bientôt deux mois qu’elle a cessé son activité et, alors qu’elle est en train de faire le bilan, elle attend encore certains paiements. « Il me manque un tiers de mon chiffre d’affaires. » Et un décret de 2018 est venu encore davantage fragiliser leurs revenus. « C’est compliqué pour les petits cabinets », ajoute Sylvain Gauché.
« Peut-être que dans dix ans, je serai blasée. Mais je vais essayer de garder l’équilibre », sourit Mathilde Robert. En début de carrière, elle espère tenir bon le plus longtemps possible, tout en connaissant les risques de sa spécialité.
Photo d’illustration de Yann Castanier : Lors de la manifestation du 16 septembre 2019 des avocats contre la réforme des retraites visant à fusionner la caisse des avocats dans un régime universel.
(1) Edit le 18 février 2020 à 10h30 : Camille Escuillé tient à préciser qu’elle n’est pas porte-parole de l’ADDE.
 Soutenez
Soutenez