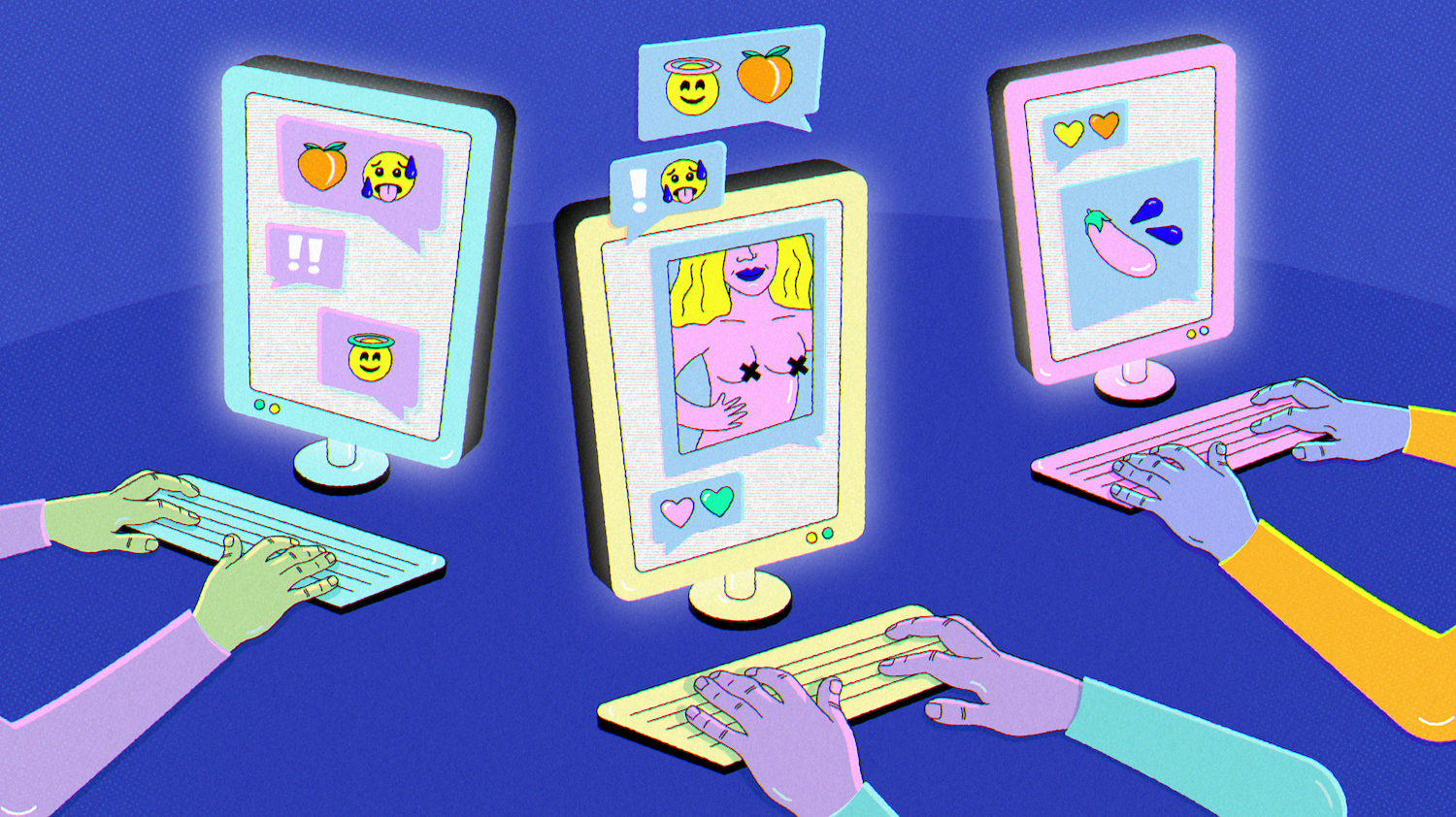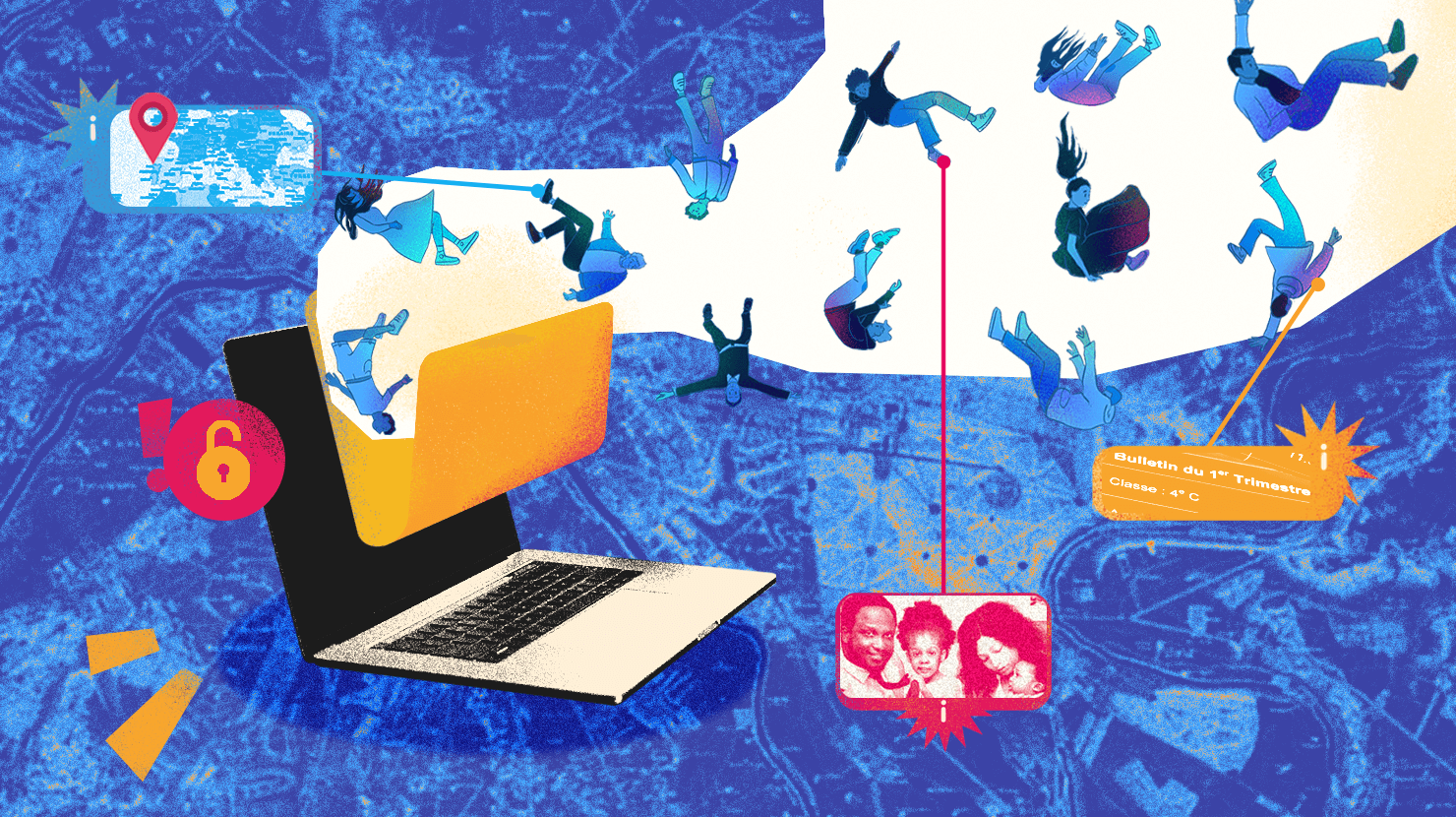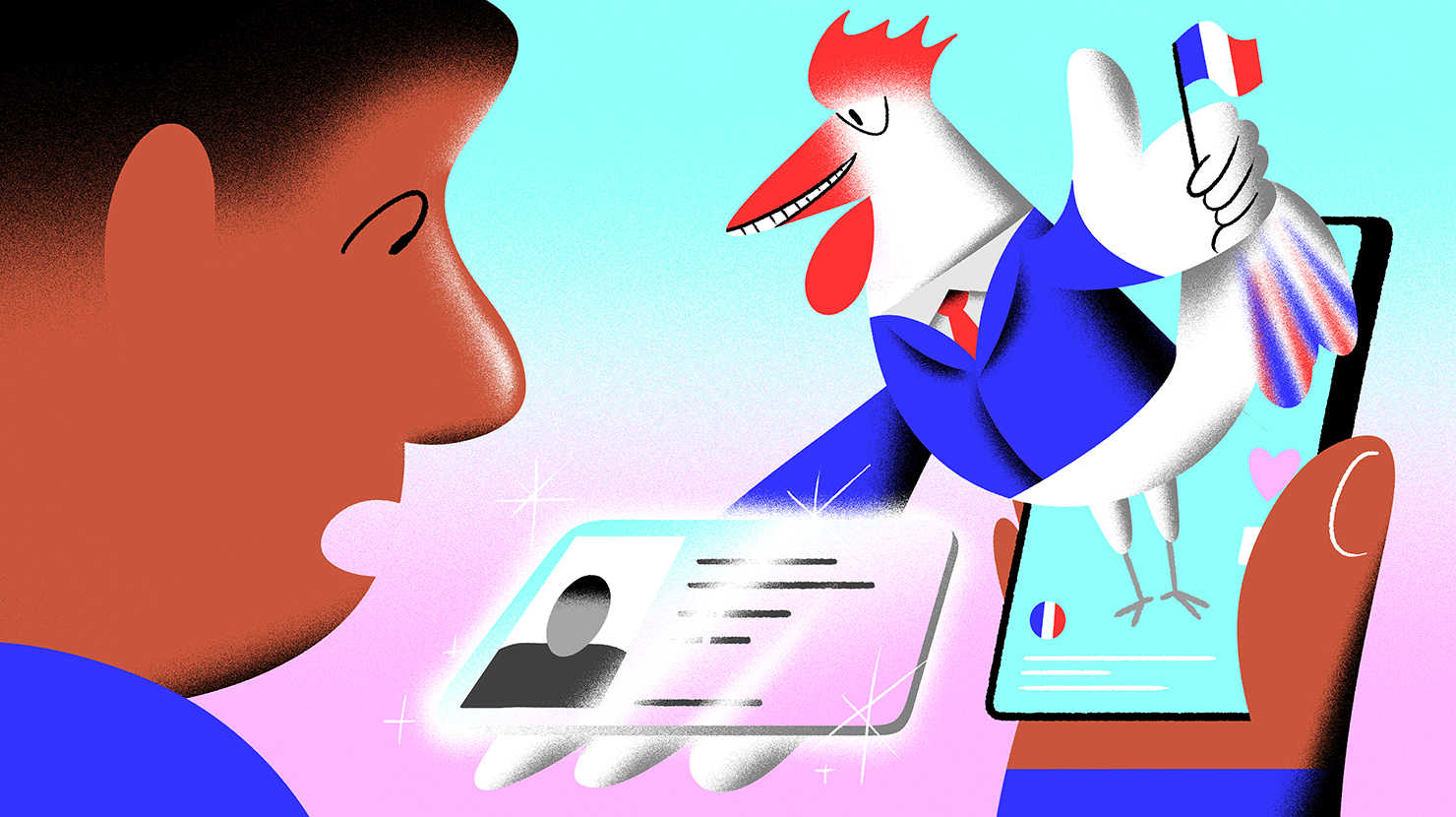« Everyone has a plan until they get punched in the mouth. » En version française : « Tout le monde a un plan jusqu’au premier coup de poing dans la face ». Imparable comme un uppercut sous le menton, la formule sert de légende à l’une des photos postées par Mike Tyson sur son compte Instagram. Assis dans un café des quartiers nord de Paris, le regard rivé sur son smartphone, Salim Kechiouche lit la phrase à haute voix, admiratif du parcours du plus grand poids lourd des 30 dernières années.
L’acteur français de 38 ans a lui aussi pratiqué la boxe à haut niveau. Lui aussi avait un plan : devenir champion du monde dans sa discipline. Jusqu’à ce que le cinéma croise son chemin et le propulse au générique de films d’auteurs loués par la critique et par les plus grands festivals, des Amants Criminels à La Vie d’Adèle. Devant un café serré, l’acteur aux yeux noirs évoque son goût pour la G-Funk et ses rôles récurrents d’homosexuel, ses souvenirs de jeunesse dans une cité de Vaulx-en-Velin et sa passion pour Loulou, chef-d’oeuvre de Maurice Pialat où Depardieu croise le fer avec Isabelle Huppert. Sans oublier son actualité : un premier rôle dans Voyoucratie – dont StreetPress est partenaire -, polar du duo de réalisateurs FKGO – pour Fabrice et Kevin. Le film a été primé lors du Manchester Film Festival en 2016 (film du festival, meilleur long-métrage, meilleur réalisateur, meilleur acteur). Salim Kechiouche y crève l’écran en voyou mutique confronté à l’implacable réalité de la pègre. Avant Mektoub, my love : canto uno, le prochain film d’Abdellatif Kechiche, qui pourrait l’installer pour de bon en haut de l’affiche.
Voyoucratie a été, pour partie, tourné en région parisienne sans autorisation. Vous n’avez pas eu trop de problèmes ?
Plusieurs fois, des policiers sont venus en demandant ce que l’on faisait. On leur répondait qu’on montait un film pour l’école, ça passait. Une fois, pour les besoins du tournage, on était en T-Max, cagoulés, avec de faux calibres. Avec Hedi [Hedi Bouchenafa, comédien aperçu dans Un Prophète ou la série Marseille, ndlr.], nous devions tourner une scène où l’on tire sur un type dans un bar à Aubervilliers. Là, les flics sont arrivés à fond, en civil. Heureusement qu’ils ont vu les perches et les caméras, ils se sont arrêtés. Après coup, ils nous ont dit qu’ils étaient à deux doigts de nous tirer dessus.
Quel souvenir gardes-tu de Vaulx-en-Velin, où tu as passé ton enfance et ton adolescence ?
C’était des quartiers, des grandes tours, des cité dortoirs avec pas grand chose à faire autour. J’avais l’impression que c’était un quartier fait pour dormir, et pas vraiment pour sortir, s’amuser ou faire des activités, ce qui laissait une grande place à l’ennui. On essayait d’aller chercher en ville ce qu’on ne trouvait pas chez nous. On allait parfois à Lyon pour tenter de rencontrer des gens, mais comme on était vus comme des péquenots de banlieue, ça chauffait. À Lyon, tu avais les quartiers populaires d’un côté et la bourgeoisie de l’autre… Entre les deux, il y avait un fossé, ça ne se mélangeait jamais.
En 1990, de grosses émeutes ont éclaté dans ta ville…
Archives Images des émeutes de Vaulx-en-Velin
J’avais 10 ans. Cela m’avait impressionné, j’avais l’impression que c’était la guerre. D’ailleurs, au début de « La Haine », on voit des images de ces émeutes. Il y a notamment un gars qui parle à des CRS. Il est tout seul, un peu bourré, face à des rangées de CRS, et il dit : « C’est facile, vous avez des armes, nous on n’a rien ». C’est un gars que je connais, il s’appelle Richard. Ces émeutes m’ont marqué. Voir les magasins brûler, les voitures faire du rodéo, c’était une animation. Mais bon, quand tu sais le fond du problème, à savoir que des policiers ont percuté violemment un jeune qui faisait de la moto sans casque dans la cité… Il s’appelait Thomas Claudio, c’était un handicapé, tout le monde l’aimait bien, il était un peu la mascotte du quartier. Il est mort. Au final, tout le monde s’est soulevé pour se révolter par rapport à ça.
Grandir là-bas, ça t’a aidé pour construire ton personnage ?
J’ai grandi en cité, mais du côté de Lyon, ce n’est pas exactement le même argot qu’à Paris. En région parisienne, on parle beaucoup avec le verlan. À Lyon, c’est vraiment de l’argot, mélangé à du javanais, du gitan. Pour dire un mec, par exemple, on dit un « pélo ». Ca a donné un côté un peu à l’ancienne à mon personnage. Comme il sort de prison, on se dit qu’il est un peu coupé du monde, qu’il n’est pas à la page.
À 13 ans et demi, tu as découvert la boxe. C’est arrivé comment dans ta vie ?
Au quartier, il faut quand même savoir un peu se battre, sinon tu te fais hagar, on te fait la misère. Comme je n’étais pas bien épais, on me cherchait souvent des noises. J’avais commencé par le football, mais je m’étais embrouillé avec le capitaine, je lui avais mis un coup de crampon et toute l’équipe voulait me faire la peau. Comme ces mecs-là habitaient aux alentours de chez moi, je savais que ça risquait de chauffer quand je les croiserai. J’avais un pote qui faisait de la boxe, je lui ai demandé de m’emmener à la salle. Au départ, c’était juste pour apprendre à me défendre, mais j’ai rapidement kiffé ce sport. La boxe m’a fait beaucoup de bien. J’avais eu des soucis dans ma famille, le sport m’a aidé à canaliser tout ça.

Bien installé. / Crédits : Pierre Gauthe
C’est quoi ton meilleur souvenir de boxe ?
Sans doute mon premier championnat de France en amateur, quand j’avais 17 ans. Ce jour-là, mon boxeur n’était pas là. J’étais d’office champion de France amateur de kick-boxing. Mon entraîneur m’a alors dit que le finaliste du championnat semi-pro n’avait pas d’adversaire. Je pouvais boxer contre lui et devenir aussi champion de France en semi-pro, il y avait une opportunité à prendre. Mais je devais répondre direct, car le combat commençait un quart d’heure plus tard. J’ai dit « ok » et je suis allé vomir aux toilettes. Je flippais. En plus, le type combattait chez lui à Bobigny. Nous, on n’était que trois à être venus de Lyon. J’ai écouté Tupac, l’album « All Eyez on Me ». Ca m’a donné de la force. Je lui ai scié les jambes et j’ai gagné le combat. Mais en y réfléchissant, mon meilleur souvenir, c’est peut-être surtout mon voyage en Thaïlande.
Tu es parti là-bas pour boxer ?
(repitw) Pour nous récompenser d’avoir représenté la ville, la mairie de Vaulx-en-Velin a offert à ses boxeurs l’opportunité d’aller s’entraîner en Thaïlande. C’était avant la grande vague des vacances en Thaïlande. Pour moi, c’était le premier voyage loin de chez moi, dans une autre culture. J’avais l’impression d’être sur une autre planète. On était tous des mecs de cité et on se retrouvait en Thaïlande. Bon, on s’est fait braquer le premier jour dans la banlieue de Bangkok ! Mais après, c’était le rêve : les cocotiers, la plage… On est restés quelques jours à Bangkok puis on s’est fait des vacances dans les îles du Sud avec aussi des entraînements intensifs, à la dure. Quand on est revenus, on a tous décroché des titres.
Et le cinéma, comment tu as mis un pied dedans ?
Gasface in da place 
Je suis entré dedans grâce à la MJC du quartier, dont dépendait mon club de boxe, qui organisait un voyage à Paris dans le cadre d’un débat organisé à la Défense sur l’avenir de la jeunesse avec le ministre de la Culture. J’avais 14 ans, je les ai supplié pour y aller, et c’est là que j’ai rencontré Gaël Morel, le premier réalisateur avec qui j’ai tourné.
Lorsqu’il t’a expliqué qu’il réalisait des films, il paraît que tu lui as répondu « moi aussi ».
Oui, mais c’était vrai ! [rires] Avec le caméscope de mon père, j’aimais bien délirer à essayer de monter des petits films avec mes potes ou mon petit frère. Des vidéos à la Van Damme ou bien inspirées par les parodies des Inconnus. Des tourné-monté avec le couteau que tu mets là [il mime quelqu’un en train de se poignarder le coeur], une pomme de terre, du ketchup… Ensuite, je racontais que je tournais des films. Ca a fait marrer Gaël. Il m’a dit que si ça m’intéressait, il pouvait m’appeler pour son long-métrage. J’ai dit « ok » et tout a commencé comme ça.
En 1995, quand tu tournes dans À toute vitesse de Gaël Morel, tu te vois déjà faire carrière dans le cinéma ou c’est juste une expérience comme ça ?
C’était juste une expérience, je me disais qu’il ne fallait pas trop rêver. Ce qui était fou, c’était de voir des gens aux petits soins avec moi, des personnes qui me maquillent et qui me coiffent, quelqu’un qui me demande si je veux du café, un autre si je veux du sucre, un dernier si je n’ai pas trop chaud. Au fond de moi, je trouvais ça trop bien. J’avais envie de faire ce métier ! [rires]
Après, je me suis rendu compte que si quelqu’un t’apportait un café, c’était pour que tu ailles plus vite et que tu sois bien en condition, pas juste pour tes beaux yeux. Tu apprends à savoir qui fait quoi dans l’équipe et à avoir du respect pour tout le monde. J’ai tourné ensuite pour François Ozon, qui m’avait repéré dans A toute vitesse. Il m’avait demandé si je voulais faire du cinéma, je lui avais répondu que je voulais être champion du monde de boxe. À l’époque, mon discours, c’était : « Le cinéma, pourquoi pas… ». C’est une chance pour moi d’être là aujourd’hui.
Dans ton parcours, l’année de tes 18 ans a l’air d’avoir été assez folle.
C’est l’année où j’ai eu mon bac. J’étais l’un des rares du quartier à l’avoir, c’était la fierté de ma famille. J’ai aussi eu mon permis. J’étais champion de France de kick-boxing. Et puis je venais de tourner le film de François Ozon, sélectionné à la Mostra de Venise. Mais en même temps, j’avais l’impression de créer un fossé avec les gens avec qui j’ai grandi… Pour justifier un truc débile, je faisais des conneries. Je traînais avec des mecs qui volaient des bagnoles, je me suis retrouvé dans des affaires un peu nazes. Juste pour dire : « Je ne suis pas une baltringue, je fais partie du truc. » Mais au quartier, tu peux vite te retrouver dans des salades : il suffit que tu sois au mauvais endroit au mauvais moment et tu peux te retrouver dans des sales histoires.
À ce moment-là, j’ai décidé de bouger et je suis parti en Algérie, à Oran. Là-bas, je me suis retrouvé bloqué à cause d’un problème de service militaire. J’y suis resté quasiment un an. C’est là où je me suis rendu compte à quel point j’étais profondément français. Et puis je me rappelle d’un truc que j’ai ressenti : avant de partir là-bas, j’avais un peu l’impression que tout m’était dû. Peut-être parce que j’étais encore un gamin et que tout marchait plutôt bien… Je ne me posais pas la question du travail ou de l’effort à fournir pour accéder à certaines choses. Alors qu’en Algérie, ce n’était pas évident pour mes cousins ou ceux que je connaissais. Ils n’avaient pas autant de liberté. C’est peut-être plus dur quand tu viens de cité, mais si tu fais un effort, tu peux y arriver. Je me suis dit que la posture de rester dans son coin, de se plaindre et de fumer des gros bédo en bas des tours, ça ne marche pas. Il faut se bouger.

Salim Kechiouche est à l'affiche de Voyoucratie, en salle le 31 janvier. / Crédits : Pierre Gautheron
(qitw) Qu’est ce que ça a changé pour toi, cette année là-bas ?
J’avais remarqué que les jeunes à Oran, dès que tu leur donnais une chance, les mecs ne se laissaient pas abattre, ils y allaient. Je me suis aussi rendu compte que là-bas, ils avaient besoin d’exutoire comme l’humour, la musique ou le jeu. C’était pendant l’époque du terrorisme, il y avait un couvre-feu. Mais en bas des tours, ce n’était pas la même ambiance qu’en France, où les mecs disaient que c’était la merde.
(repitw) Là-bas, leur délire, chaque jour, c’était d’arriver avec une nouvelle blague, trouver la vanne qui va bien faire pleurer de rire tout le monde. Je me suis dit que c’était ça que je voulais faire. Partager des choses avec des gens, les faire pleurer, les faire rire. J’ai eu une espèce de révélation. J’avais cette chance-là entre les mains et il ne fallait pas que je la gâche, il fallait prendre le taureau par les cornes : s’installer à Paris et arrêter de se plaindre.
Tu aurais pu être cantonné aux rôles de petites frappes, est-ce que tu as fait en sorte de ne pas être enfermé dans cette case ?
Ca s’est fait un peu tout seul, via des rencontres avec des gens du cinéma d’auteur. Et puis comme je venais d’un quartier et que j’étais boxeur, je savais que je risquais d’être cantonné là-dedans, alors j’essayais d’aller vers des propositions moins conventionnelles. À la fin des années 90, les rôles que l’on proposait aux acteurs comme moi, c’était souvent ceux de l’arabe de service qui vole des mobylettes… J’ai joué des rôles d’homosexuel, complètement sur un autre registre [dans Grande Ecole, Le Clan ou Le Fil notamment]. Je suis allé aux antipodes de ce que je suis. Mais les gens ne s’en sont pas rendus compte, ils ont pensé que j’étais comme ça dans la vie. J’ai dû montrer qu’il s’agissait de rôles et non de ma personnalité. Aujourd’hui, avec Voyoucratie, j’ai pu piocher dans un univers dans lequel j’ai baigné, dans des souvenirs que j’ai vécu. C’est comme si je faisais le parcours en sens inverse.
Tu tournes pas mal avec Abdellatif Kechiche. Ses tournages ont la réputation d’être assez chaotiques. Comment ça s’est passé pour toi ?
On est actuellement sur plusieurs longs-métrages : on a tourné un film qui est passé au festival de Venise, un deuxième que l’on a quasiment terminé et un troisième en cours d’écriture. Abdellatif Kechiche, c’est quelqu’un que je respecte beaucoup pour la qualité de son travail, pour sa liberté aussi. J’essaie de ne pas écouter ce que disent les autres, de vivre mon expérience avec lui. Et c’est une expérience géniale. Il met les acteurs au centre de son processus de création, ce qui est rare. La façon de faire classique peut transformer les acteurs en machines qui doivent s’adapter à la technique. Avec lui, l’acteur est au centre, tout le reste doit s’adapter. Comme c’est une manière de faire différente, et qu’en règle générale, on n’aime pas les manières de faire différentes, certains râlent. Moi j’aime cette liberté.
Sortie en salle de Voyoucratie le 31 janvier.
 Soutenez
Soutenez