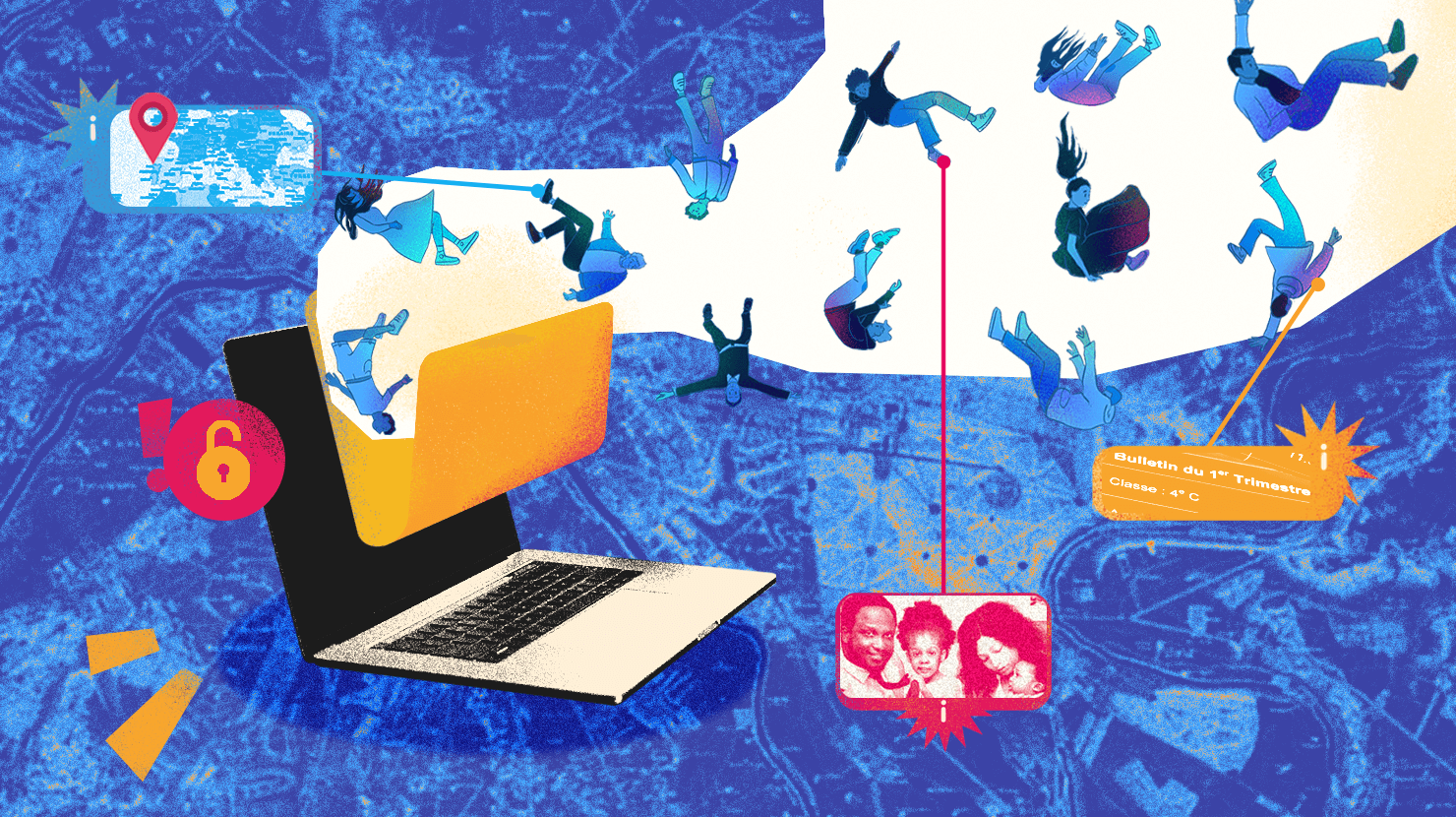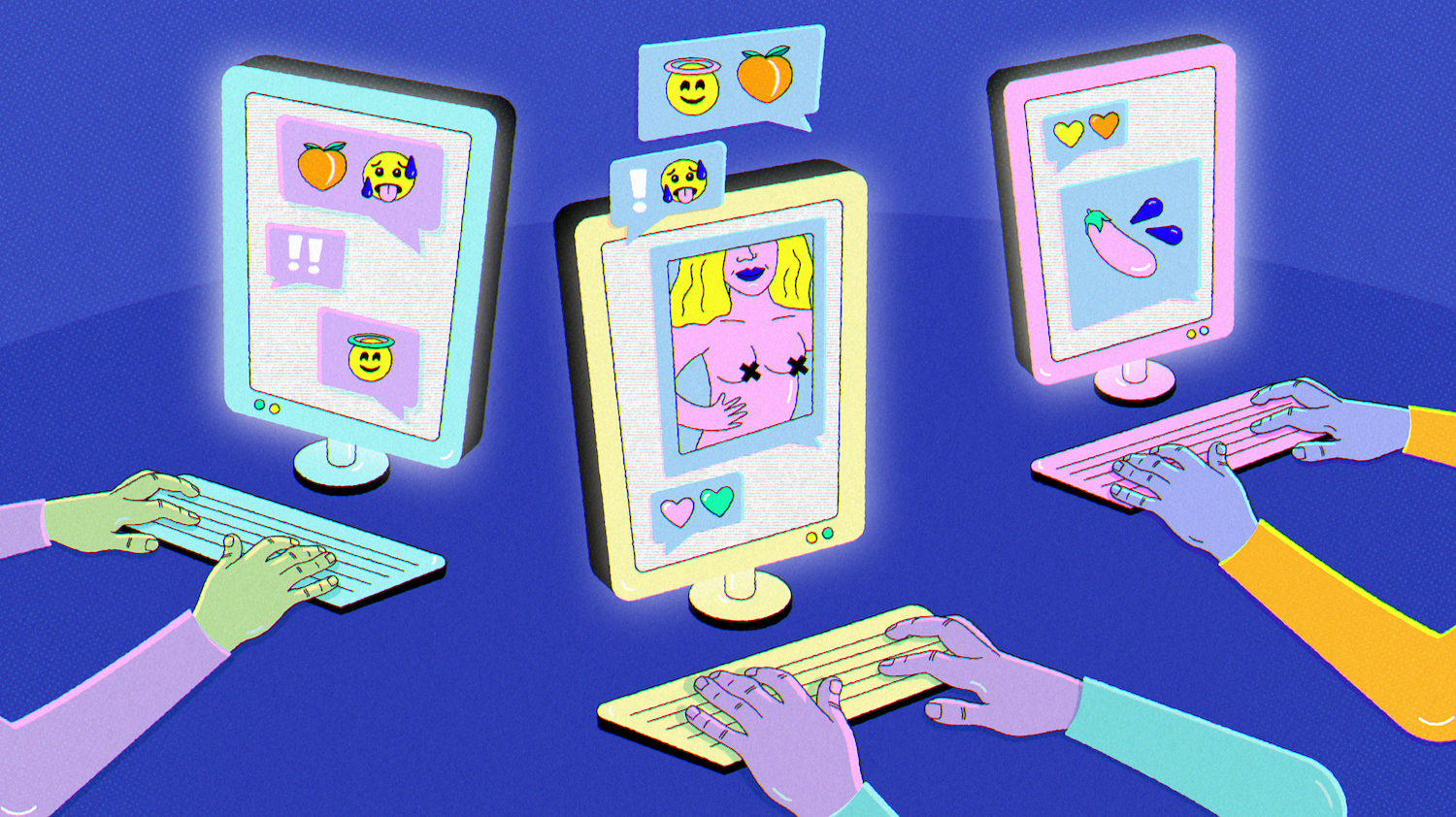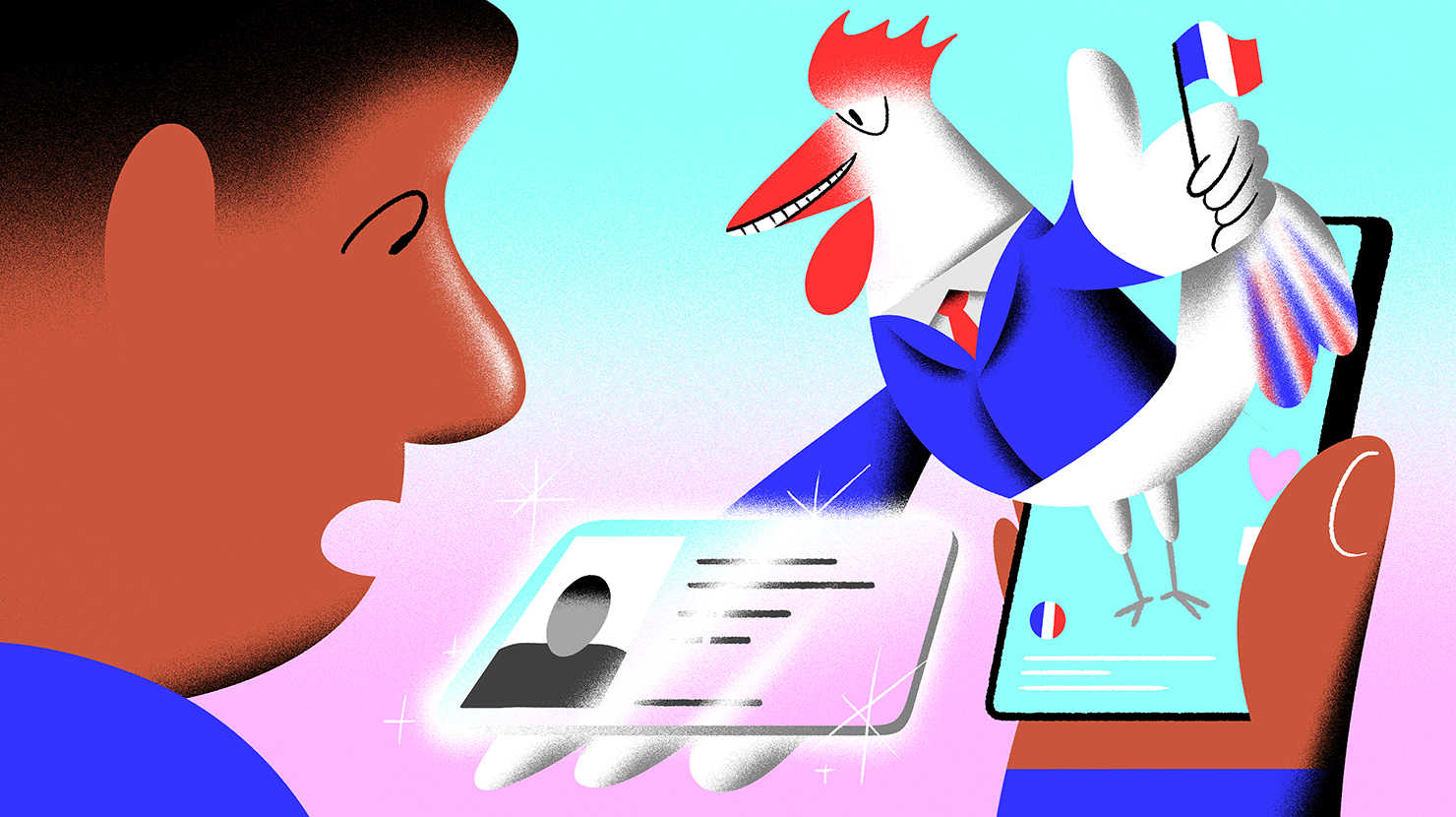Christine Parat accueille Aïcha dans son bureau. Deux tables et quatre chaises remplissent la pièce. À peine le temps de s’asseoir que la femme de 56 ans sort de son sac floqué Action, chaîne de magasins hard-discount, un papier. Très remontée, Aïcha vient pour qu’on l’aide à rédiger une lettre de contestation. Elle a reçu un avis de saisie administrative. L’État lui réclame encore 180 euros. Christine, écrivaine publique bénévole, est habituée à ce genre de situation. Elle commence à rédiger la lettre tout en demandant des précisions à Aïcha. « Je ferais plein de fautes. Je n’ai pas de vocabulaire ni de bonnes formulations. Si on ne comprend pas ce que j’écris, ça va être rejeté », craint la quinquagénaire. Originaire du Maroc, elle a des difficultés avec l’expression orale : « Je ne m’exprime pas très bien. J’avais fait une remise à niveau, mais ce n’était pas suffisant ». Et savoir écrire, c’est avant tout savoir s’exprimer selon elle. Une difficulté du quotidien qui l’oblige à demander de l’aide dès qu’une tâche administrative est trop compliquée. Aïcha vient très régulièrement voir un écrivain public.

Lorsqu’elle tient des permanences d’aides à la rédaction à Saint-Denis, Christine passe une grande partie de son temps à compléter des documents administratifs pour des personnes analphabètes ou illettrées. « Ils représentent 90 % des rendez-vous. » / Crédits : Maxime Asseo
Assistante sociale malgré elle
Lorsqu’elle tient des permanences d’aides à la rédaction au Toit des Mots à Saint-Denis (93), Christine passe une grande partie de son temps à compléter des documents administratifs pour des personnes analphabètes ou illettrées. « Ils représentent 90 % des rendez-vous. » Les impôts, retraites ou demande de logement sont de véritables cauchemards pour ceux qui ne savent pas écrire. Il y a aussi ceux en recherche d’emploi, ainsi que la rédaction des CV et des lettres de motivation.
La directrice de l’association, à la longue chevelure rouge, joue presque un rôle d’assistante sociale. Parfois, au téléphone, elle fait semblant de l’être. « Pas le choix », soupire-t-elle, la voix enrouée. Une profession en sous-effectif à Saint-Denis d’après elle :
« On est six bénévoles ici. Il n’en faut pas moins, surtout dans cette ville. »
Comme ses collègues, Christine écoute, conseille et rassure les personnes qui viennent la voir. « La plupart sont d’origine étrangère. Certains sont allés à l’école, mais pas longtemps, d’autres non et d’autres ont du mal avec le français. Mais tous sont perdus avec l’administratif. » La plupart s’expriment correctement à l’oral, mais lors du passage à l’écrit, « ce n’est plus la même langue. Ils se retrouvent complètement bloqués ».
Étroit ou insalubre ?
Pour Aïcha, ce sont les 180 euros qui coincent. Une somme importante, surtout quand les revenus ne volent pas très haut. D’autres jouent l’obtention d’un logement en venant voir un écrivain public. Ne pas savoir écrire ou lire peut vous laisser poireauter dans des appartements à l’hygiène plus que discutable. C’est le cas d’une jeune femme victime de violences conjugales qui vient voir Christine aujourd’hui pour « imprimer quelque chose dans son dossier ». Elle restera une demi-heure. Au vu de sa situation, elle a finalement plusieurs choses à demander. Endettée à hauteur de 11.000 euros, sans emploi, au RSA, elle cumule les difficultés. Elle vit avec son fils dans un logement où les rats côtoient la moisissure. Elle a fait une demande de logement au titre de la loi Dalo (Droit au logement opposable). Dossier refusé. « Je vis chez une dame à qui je donne un loyer, mais elle ne veut pas me donner de certificat pour ma demande de logement ». Christine tente d’appeler la propriétaire, en vain. Elle laisse un message, rédige le recours et espère faire avancer la situation.
Les demandes de logement sont récurrentes. Il y en aura deux aujourd’hui. Quand la première veut quitter son logement insalubre, la deuxième aimerait partir d’une chambre d’hôtel d’une dizaine de mètres carrés à Villejuif (94). Cette jeune mère de 22 ans y vit avec sa fille d’un an. Enceinte, elle a fait plus d’une heure de transport pour venir. Même si elle sait « un peu écrire et reconnaître les panneaux de signalisation ou du RER », la rédaction d’une lettre de motivation est une autre histoire. « C’est basique ce que je sais faire, mais dans cette situation, j’avais besoin d’aide. C’est trop compliqué à comprendre. On me demande trop d’informations, trop de choses à faire », confesse cette demandeuse d’asile, récemment arrivée de Guinée. Dépassée par la paperasse, elle n’a que l’écrivaine publique pour espérer faire bouger les choses. Cette fois encore, Christine espère une victoire. Elles ne sont pas fréquentes.

Christine s’indigne contre le charabia administratif qu'on demande : « Quand c’est écrit “la copie de votre adhésion citée en référence”, comment voulez-vous qu’ils comprennent quoi que ce soit ? » / Crédits : Maxime Asseo
Pas le temps d’apprendre
Les demandes négatives ou rejetées finissent très souvent par revenir sur le bureau de l’écrivain public. Il faut essayer d’améliorer un peu plus les dossiers et retenter sa chance une nouvelle fois. Hakim (1) s’est vu refuser la reconnaissance d’une maladie professionnelle au motif qu’il n’a pas établi de lien entre ses symptômes et son travail. Ce bagagiste, proche de la soixantaine, soulève des valises à l’aéroport Charles de Gaulle depuis 20 ans. Il a plusieurs hernies discales. Il est venu aujourd’hui pour modifier quelques éléments sur la lettre rédigée par une autre bénévole. « Je ne sais pas écrire. Je n’ai pas été à l’école très longtemps. C’est un handicap dans la vie de tous les jours », explique-t-il. Malgré ses nombreuses années dans l’entreprise, il n’a jamais évolué. Toujours manutentionnaire :
« Celui qui sait bien lire, écrire et parler, peut évoluer dans une société. Moi, je n’ai pas pu. »
Pourtant, il a beaucoup travaillé. Même trop. À tel point qu’il n’a pas pu suivre une formation de langue et d’écriture à laquelle il avait le droit.
La surcharge de travail, c’est aussi ce qui a empêché Ana-Maria, originaire du Cap-Vert, d’apprendre à manier le stylo. Cette amie de la chanteuse Cesária Évora – « comme tous les Cap-Verdiennes », s’amuse Christine – est arrivée en France en 1977. Pour apprendre à écrire et à lire, Ana-Maria allait dans une association. Elle n’a fait que trois séances : « Je travaillais tôt le matin, je finissais tard le soir. Je n’avais pas le temps ». Deux hernies discales, une sciatique et un AVC plus tard, elle fait toujours appel à « une personne de confiance » pour rédiger ses papiers administratifs. Aujourd’hui, Ana-Maria veut écrire aux assurances pour qu’une de ses amies reçoive un capital obsèques, et s’occupe d’elle en cas de décès. Sa famille ne vit pas en France. Une tâche impossible pour la retraitée, surtout quand l’administration use d’une langue bien à elle. Christine s’indigne :
« Quand c’est écrit “la copie de votre adhésion citée en référence”, comment voulez-vous qu’ils comprennent quoi que ce soit ? »
Elle relèvera un quart d’heure plus tard une autre phrase alambiquée dans la demande de logement de la jeune femme victime de violences conjugales : « Dernier document reçu postérieurement, relativement à la procédure d’expulsion ». La bénévole soupire. Mais elle ne lâche rien. Elle sait qu’elle est devenue indispensable pour ces exclus du système administratif.
(1) Le prénom a été modifié.
Photo d’illustration en Une. Tous droits réservés.
 Soutenez
Soutenez