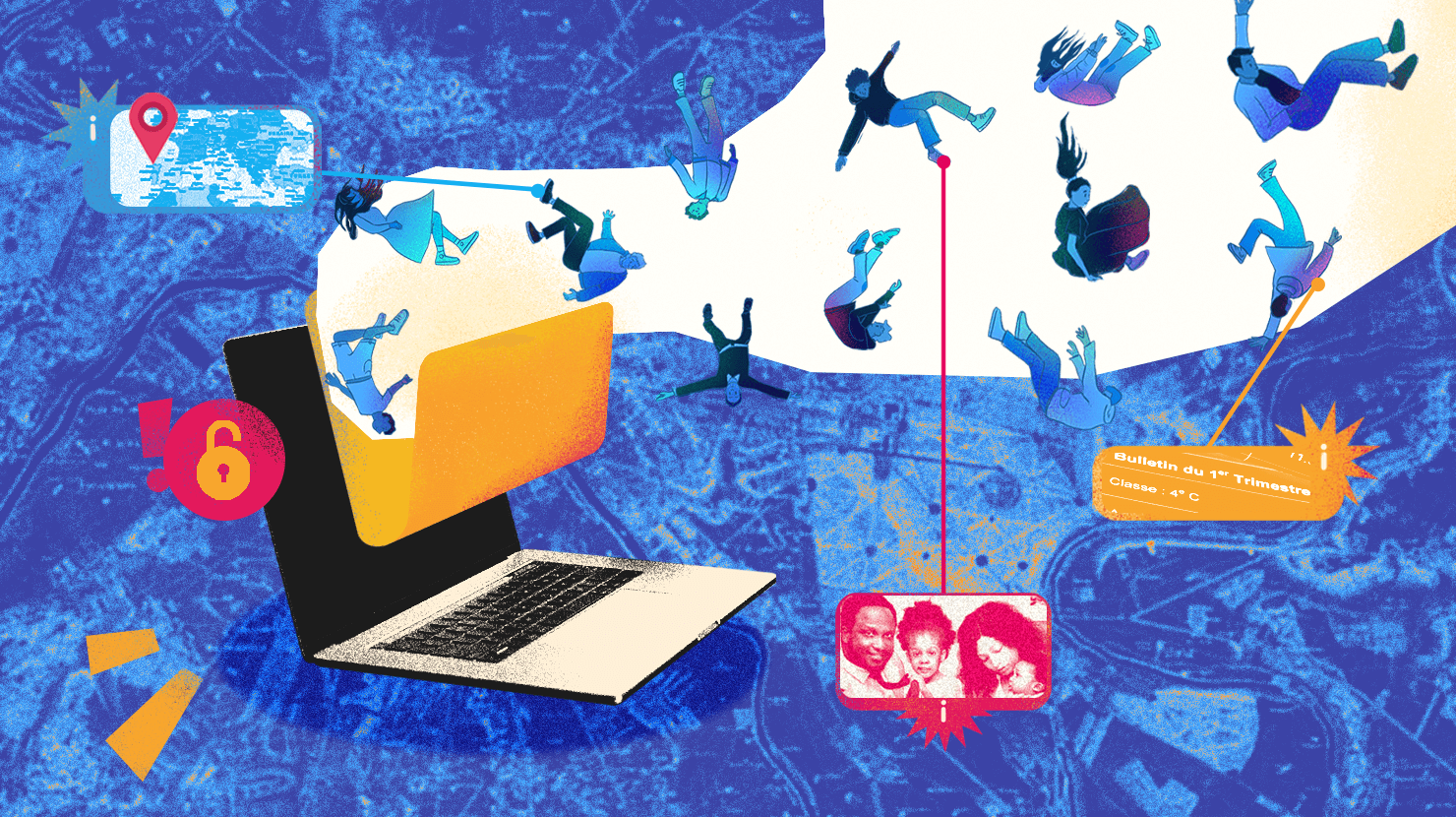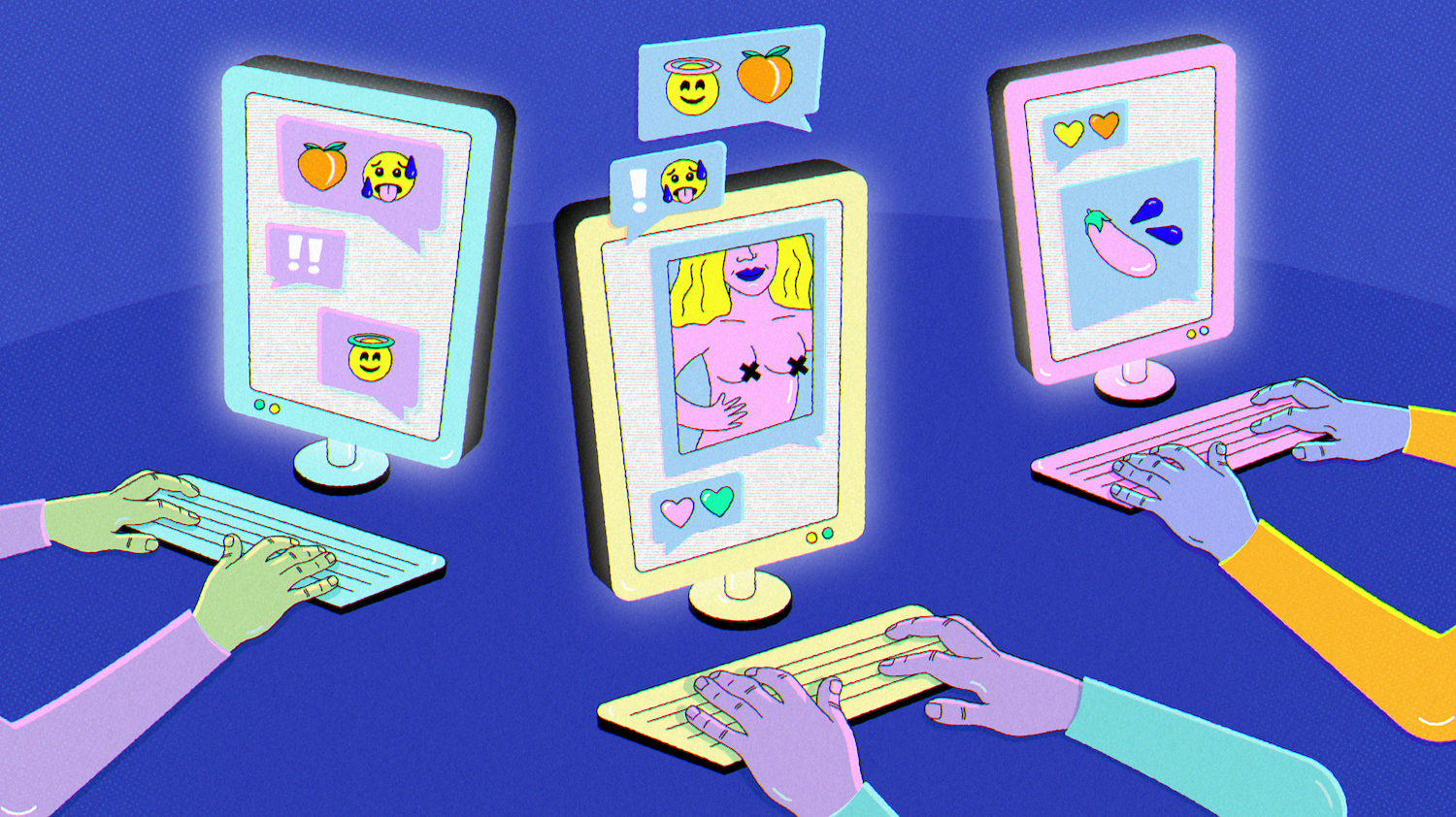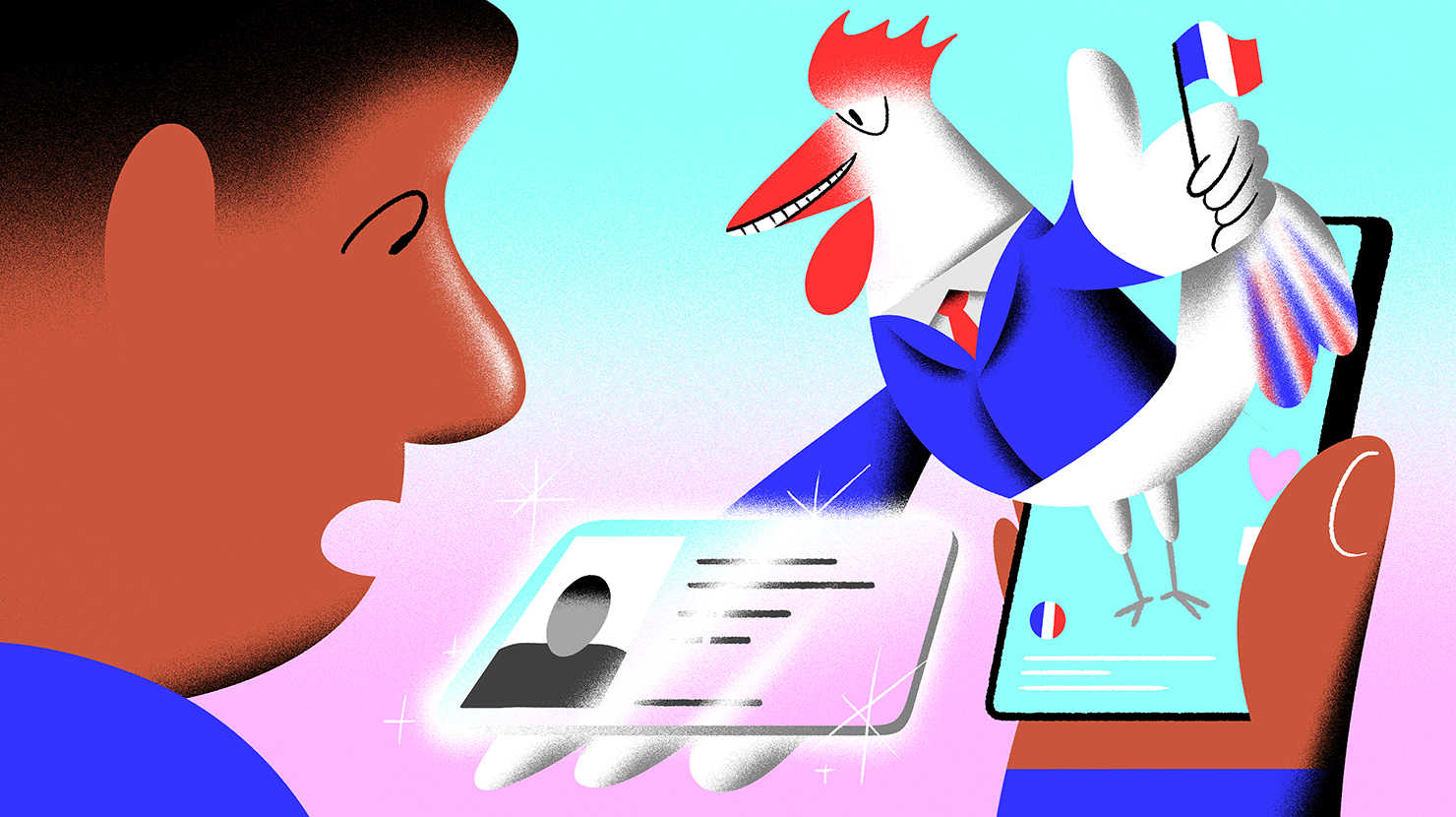Dans les années 80, la culture graffiti a la cote sur les murs de Paris. La pratique n’a pas encore gagné les galeries d’art et est à l’heure « vandale ». Luc, alias Comer, est l’un des prophètes de cette sous-culture. Il y consacre tout son temps et pose son nom sur les rames de métros et de RER avec ses comparses. Par son histoire, le journaliste Karim Madani raconte dans son livre Tu ne trahiras point (Éditions Marchialy) le parcours de ces meneurs du graffiti parisien, et celle de leur procès désormais connu sous le nom de « procès de Versailles ».
Car pour contre-attaquer face à ces artistes des tunnels, la police a créé la cellule gare du Nord et lui a alloué des moyens jusque-là réservés à la répression du grand banditisme. En 2001, un immense coup de filet entraîne l’interpellation d’une soixantaine de prévenus.
StreetPress publie en partie le troisième chapitre de Tu ne trahiras point
La cellule gare du Nord. Les locaux sont étroits, gris, déprimants, mais étrangement propres. Quelques taches de sang maculent les sols et les murs, ainsi que des centaines d’inscriptions laissées par les gardés à vue. « Comer ! On t’attendait », lâche un lieutenant de police, un sourire ironique aux lèvres, quand le graffeur se présente à l’accueil. Le flic l’appelle par son nom de graffeur. Luc ne tique pas, garde un visage impassible. « Comment ? »
Le flic grimace. « Arrête de nous prendre pour des chèvres. » Le commissariat est organisé comme une ruche. Un conduit étroit qui dessert des alvéoles exiguës. Les flics sont occupés à taper des dépositions et le bruit des claviers maltraités forme comme une espèce de mur sonore contre lequel votre crâne encore ensommeillé vient violemment rebondir. « Écoutez, je ne sais même pas pourquoi je suis là », répond Luc. Le flic regarde les pompes de Luc un moment et répond.
« Alors, prends le temps de la réflexion parce que tu vas rester un petit moment avec nous. »
La notification de garde à vue est sèche. Les flics sont sur les dents parce qu’ils n’ont pas réussi à serrer le graffeur dans son logement rue de Fécamp. Luc doit se délester de ses lacets et de sa ceinture. Fouille au corps rapide. Il reste serein. Il sait qu’il en a pour quarante-huit heures, soixante-douze au maximum avant la présentation devant le magistrat. La version qu’ils ont concoctée des semaines plus tôt avec Laurent tient la route. Ils ont eu le temps d’y penser parce que le mot clé dans la rue c’était « serrage imminent ». Ils sont deux amateurs de graffiti qui ont pris des photos et évolué dans le milieu afin de publier un beau livre sur le sujet.
Des gardés à vue tuent le temps derrière d’épaisses vitres en plexiglas. Luc est escorté au fond d’un étroit corridor qui donne sur des petits bureaux dans lesquels les flics procèdent aux interrogatoires.
Merle et son équipe sont des vétérans de la lutte contre les atteintes aux biens et aux personnes. Ils ont lustré leurs armes contre le grand banditisme. Le procureur de Paris leur a demandé de monter une cellule anti-graffiti dans la précipitation, avec des effectifs réquisitionnés dans différents services de police judiciaire. Leur unité se nomme la cellule gare du Nord. Les bureaux ressemblent à une boutique de vente de matériels de graffiti. Ils exposent des objets saisis lors des perquisitions : bombes, marqueurs, photos, vêtements, appareils-photo. Ça en jette. Ça pourrait même impressionner un néophyte de la garde à vue. Les flics sont hyper documentés. Une brigade éclairée, avec des agents amateurs d’art, de fins connaisseurs du graffiti. La vérité, c’est que la plupart ne pourraient pas faire la différence entre une esquisse de Basquiat et un gribouillis fait à l’arrache par Picasso. À part Merle. Lui, il est fasciné par les graffeurs.
Merle, c’est une énigme. Qui est ce flic à la tête de cette brigade ? L’homme traque les graffeurs la journée et semble hanter des forums de graffiti la nuit, sous caféine et pseudonyme. Merle est obsédé par ces types, qui le craignent en retour.
Le dispositif est un peu pompeux. Un peu prétentieux même. Ils ont mis les moyens: filature, écoutes téléphoniques, commissions rogatoires nationales et internationales. Les chefs d’inculpation – du genre association de malfaiteurs en lien avec une entreprise criminelle – impliquent des peines de prison plus sévères, des commissions rogatoires plus drastiques, des libertés fondamentales foulées sur l’autel du tout-sécuritaire.
Exactement comme pour les beaux mecs du grand banditisme, les terroristes, les barons de la came, et pour cause : certaines huiles des renseignements généraux et de la DST (Direction de la Surveillance du Territoire) avancent une idée qu’en banlieue, graffeurs et trafiquants de shit pourraient constituer l’arrière-boutique d’une nébuleuse djihadiste. Les tours du World Trade Center ne sont plus que d’énormes montagnes de gravats et toutes les agences de renseignement du monde se mettent à se pencher sérieusement sur le terrorisme islamique. Vous imaginez un instant un kamikaze avec une ceinture d’explosifs qui aurait, juste avant de passer à l’acte, passé son après-midi à voler des bombes aérosol au BHV pour peindre des fresques chatoyantes dans un dépôt de la RATP ?
La garde à vue de Laurent est sur le point de s’achever. Quarante-huit heures de privation de liberté dans le bide, ça fait plutôt mal. Difficile de dormir sur une banquette de ciment dans une cellule glaciale. Vous êtes dépendant des flics pour manger (s’ils ont assez de compassion pour vous apporter un café froid et deux spéculos) et pour pisser. Sans montre, vous perdez vite la notion du temps. Pas étonnant qu’on vous enlève votre ceinture et les lacets. Des gens fragiles pourraient nourrir des idées tordues. Les geôles de la République, c’est le Moyen Âge.
Mais les flics n’ont toujours rien. Ils demandent un renouvellement de la garde à vue de Luc. Vingt-quatre heures de plus. C’est rien qu’une formule creuse pour le substitut du proc’ à l’autre bout du fil, entre deux bâillements, au chaud dans un lit bien douillet vu l’heure tardive.
« Bon, tu veux rien dire ? On va organiser une confrontation avec ton pote, menace un des flics de Merle.
— OK. Pas de problème », soupire Luc.
Quand Luc pénètre dans le petit bureau surchauffé, il est d’abord saisi de voir Laurent en état de prostration. Et pourtant l’homme est un bloc de granit sur pattes. Grand, solide, on devine qu’il s’est fait un nom depuis le préau, à grands coups de lattes. Un gars qui a mis beaucoup de gens à l’amende, comme on dit dans la rue, pour décrire ces face-à-face brutaux ou le plus fort, le plus dur et le plus déterminé l’emporte. « Ça va ? » demande Luc à son gars sûr.

La couverture de Tu ne trahiras point, aux éditions Marchialy. /
Un flic aboie quelque chose. Le principe d’une confrontation, c’est que les gardés à vue n’ont pas le droit de se parler directement. Ils donnent leurs arguments aux flics qui les répercutent et les ventilent aux deux parties en circuit fermé. Pour éviter toute forme de pression ou d’intimidation.
« Tu le connais alors ? demande un des lieutenants à Luc.
— Ouais. C’est mon pote. Laurent. »
Luc donne le véritable prénom de son gars, celui inscrit sur sa carte d’identité.
« C’est pas la question que je t’ai posée. Est-ce que tu connais ce type en tant que taggeur ? »
Luc ne se laisse pas bousculer.
« On taggait à l’époque, y a très très longtemps. Il signait Leeroy, je crois. » Luc essaie de communiquer avec Laurent. « Ça va, mec ? »
Laurent ne répond pas.
C’est la première garde à vue de Laurent. La première véritable garde à vue. Pas les quelques heures passées dans un hôtel de police pour des infractions mineures. Aujourd’hui, il est resté quarante-huit heures. Avec des chefs d’inculpation plutôt monstrueux pour ce genre d’affaires.
Luc est menotté par mesure de sécurité. C’est aussi l’une des règles de la confrontation.
« C’est un pote d’enfance, je vous dis », lâche Luc. Un des lieutenants s’emporte. « Arrête de te foutre de notre gueule, maintenant ! » Il montre du doigt Laurent.
« Et toi, Banania, va falloir que tu nous aides un peu, là. »
L’affiche de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et le Code de déontologie de la police nationale doivent probablement être punaisées dans les chiottes.
« Répète un peu ce que tu nous as dit », aboie le flic à Laurent.
Laurent n’ose pas regarder Luc.
« Est-ce que tu reconnais le taggeur Comer, ici présent dans ce bureau ? interroge le flic.
— Oui, c’est lui, murmure Laurent d’une voix à peine audible.
— J’entends rien, hurle le flic.— Oui, c’est bien Comer, du crew OBK. »
Des particules de sidération flottent dans le bureau. Elles obstruent les poumons et le cerveau de Luc.
« Vous reconnaissez en cet individu le chef des OBK ? poursuit le lieutenant.
— Oui. C’est le chef des OBK. »
Luc hallucine littéralement. Des bribes de souvenirs affluent à sa mémoire. Le bon vieux temps. L’adolescence. Les métros. Les bagarres.
« Ho, tu m’écoutes, là ? » La voix grave du flic ramène brutalement Luc dans la salle d’interrogatoire. « Ton pote t’a formellement identifié. » Cette fois, c’est Luc qui reste silencieux. « Tu reconnais que t’es Comer, des OBK ? T’as plus trop le choix, non ? » Luc se met à insulter Laurent.
« Mais t’es dingue, c’est pas moi Comer, rien à voir avec les OBK, qu’est-ce que tu racontes putain ? »
Difficile de parler avec les mains quand elles sont entravées par deux petits arceaux de métal, alors Luc bombe le torse, balance sa tête d’avant en arrière, invective les flics, shoote une chaise. L’équipe de Merle lui saute dessus, l’oblige à rester assis. Des bruits de barreaux de chaises cognent contre les étagères, la respiration saccadée des lieutenants, leur haleine chaude et aigre dans la nuque du suspect. Luc redescend. Inutile de gaspiller de l’énergie. Il en aura besoin plus tard, parti comme c’est.
« Je ne reconnais rien. Vous racontez de la merde, il raconte de la merde aussi », crache Luc en désignant Laurent d’un coup de menton.
Le disque va tourner en boucle. Les sillons sont usés, les flics aussi. Luc retourne en cellule. Des bribes de l’interrogatoire bourdonnent et cognent dans son esprit, comme des abeilles prises au piège dans un verre qu’on vient de retourner.
Laurent est un pote d’enfance. S’il affirme que Luc est bien Comer, ça ne peut qu’être vrai. C’est ce que les flics pensent. C’est ce que le juge pensera aussi. Si Luc persiste à affirmer que Laurent ment, les choses pourraient tourner en sa défaveur. C’est quoi le plan B ?
Luc doit avouer que c’est bien de son nom de taggeur qu’il s’agit. Pour le reste, il invoque le code pénal et le sous-alinéa : les tablettes de la prescription ! Les délits dont il est accusé sont prescriptibles au bout de cinq ans. Lorsque l’interrogatoire reprend, les flics montrent des signes de fatigue. Luc entame sa trente-neuvième heure de garde à vue. Il est pressé d’en finir maintenant. « Oui, OK, c’est moi Comer. »
Les enquêteurs lâchent des petits rires satisfaits. « Mais je suis chef de que dalle, on n’est pas un gang, juste des amis d’enfance. » Un des flics fait défiler une série de photos. Un paquet de signatures : Acro, Lacriz, Step, Smeo, autant d’alias et d’avatars révélés par Laurent.
« C’est vieux. Ça date de 1994, tout ça. Peut-être 1995 ou 1996, à tout casser. »
Les enquêteurs lui montrent une série de photos déconnectées de tout contexte spatio-temporel. Ils ne savent pas qui les a prises, où elles ont été prises et surtout quand elles ont été prises. Quelle expertise faut-il pour dater un graffiti sur un train ? La RATP a pris des photos, mais bien après que les graffitis ont été réalisés. Comment certifier qu’un graffiti a été exécuté en 2000 et pas en 1997 ? Beaucoup de trains ont été complétement nettoyés, ce qui a abouti à la destruction involontaire d’un grand nombre de preuves.
Les documents défilent sous les yeux de Luc. Les flics ont compilé leur matos: photos, vidéos, pages de magazine, tout ce qu’ils ont pu récupérer pendant les perquisitions. On lui attribue même des signatures qui ne sont pas les siennes. Les procès-verbaux sont à peine plus élaborés que dans un enfer bureaucratique d’un ex-satellite de l’empire soviétique dans les années 1970. C’est une technique policière vieille comme le 93, rue Lauriston. Tiens, voilà la question et voilà la réponse qu’on veut entendre. Allez, tu n’as plus qu’à l’écrire, signer et on t’offre un café et une cigarette. Mais Luc n’est pas né de la dernière pluie d’acrylique.
Les flics déchirent rageusement les PV et les jettent à la poubelle. Ils veulent du trafiquant de shit de cité HLM, pas des jeunes types insérés dans la société et qui ont gribouillé leur nom sur les murs. Sur les cinquante-six gardés à vue que les flics verront défiler, les profils sociaux sont variés, parfois atypiques. Des types issus de la classe moyenne, quelques mecs de cité et des rejetons de la classe dominante. Un fils de magistrat. Le fils d’un dirigeant de la SNCF. Pas de djihadiste.
Quarantième heure de garde à vue. Luc relit ses propos. Ça se rapproche de plus en plus de la vérité. Il y a une amélioration, mais c’est encore truffé d’inexactitudes, d’incohérences, de malentendus, de double sens. Sens imagé ou littéral ? Ça peut faire une sacrée différence devant un juge. Entre braquer une banque et rêver de le faire, avouez qu’il y a une peine à deux chiffres, non ?
Quelques clichés sont plus compromettants que les autres : ils émanent de plaintes de la SNCF. Luc fait mine de les ignorer.
Un des enquêteurs lui sort une vieille antienne, très en vogue dans les années 1980 : les taggeurs et les graffeurs seraient des membres d’une organisation criminelle issue des cités, organisation constituée en gangs, à l’américaine. Chaque gang aurait son propre « tag », sa signature qui identifierait des territoires, des turfs bien précis sur lesquels il régnerait en maître incontesté. Pire, dans certains secteurs, les maisons « taguées » seraient des endroits repérés pour de futurs cambriolages.
La cellule de Merle fantasme à mort. Paris, c’est pas Los Angeles, mec.
A lire aussi
Photo d’illustration en Une tirée du livre de Comer : Marqué à Vie, via le site Drips
 Soutenez
Soutenez