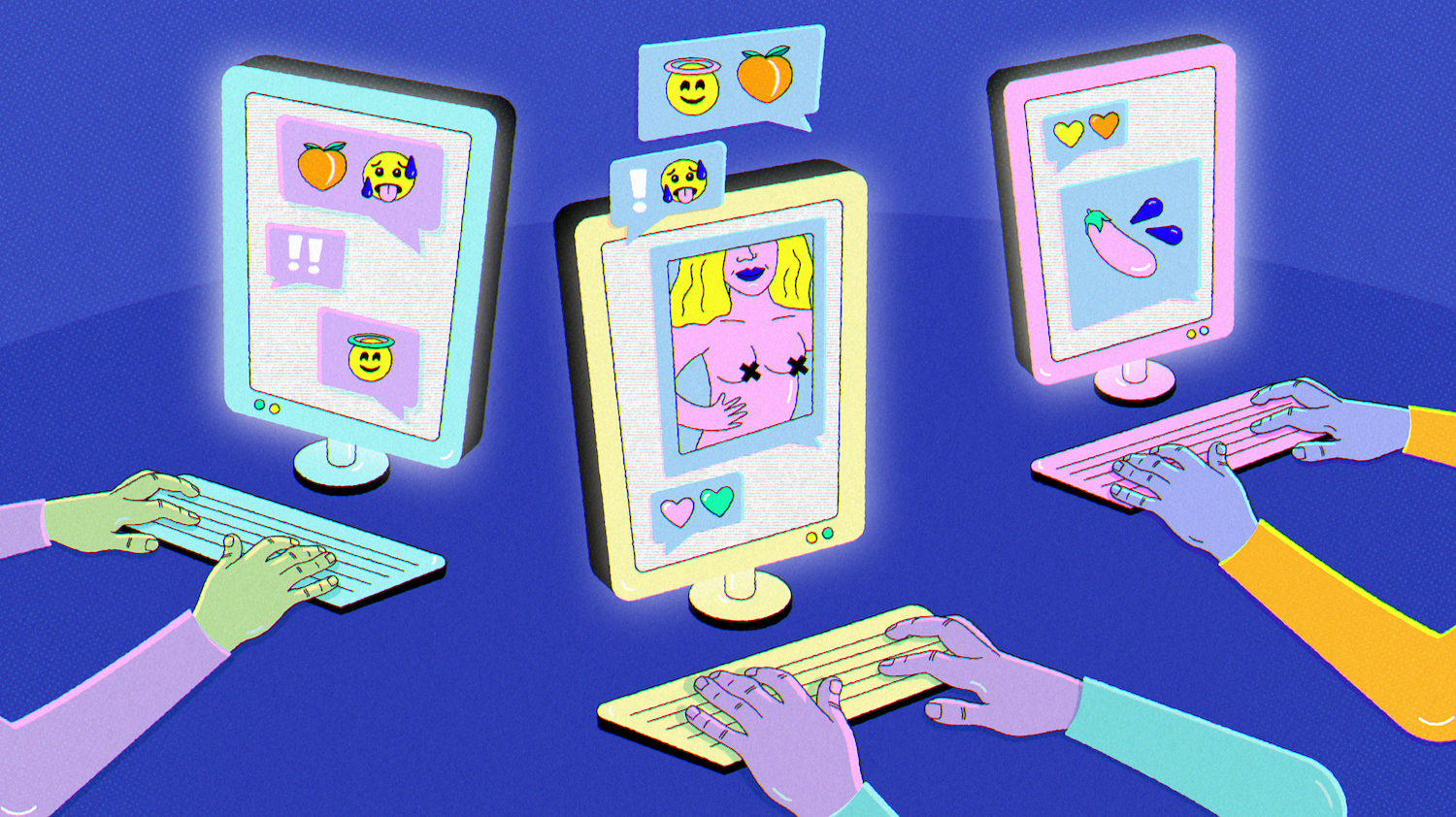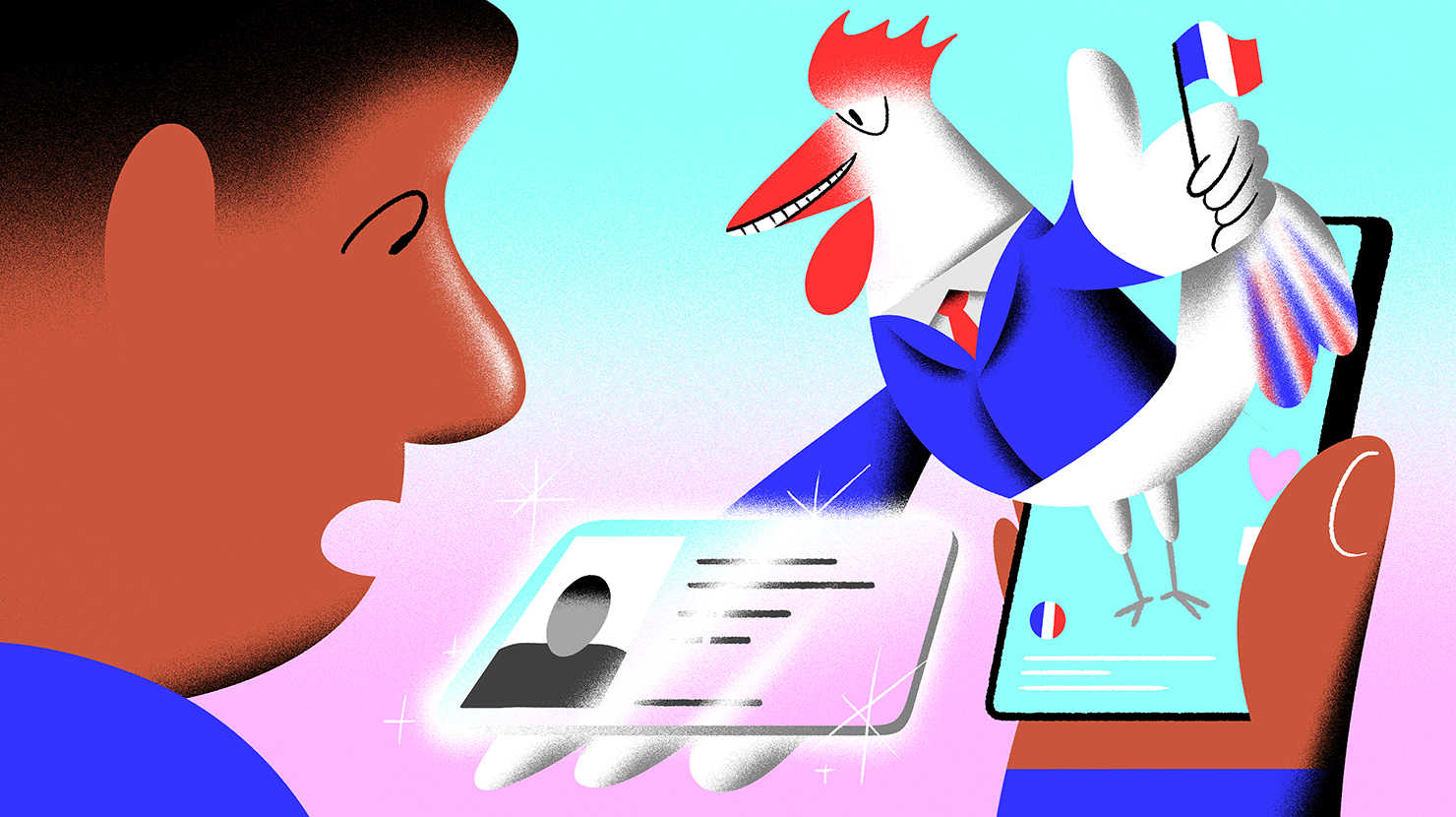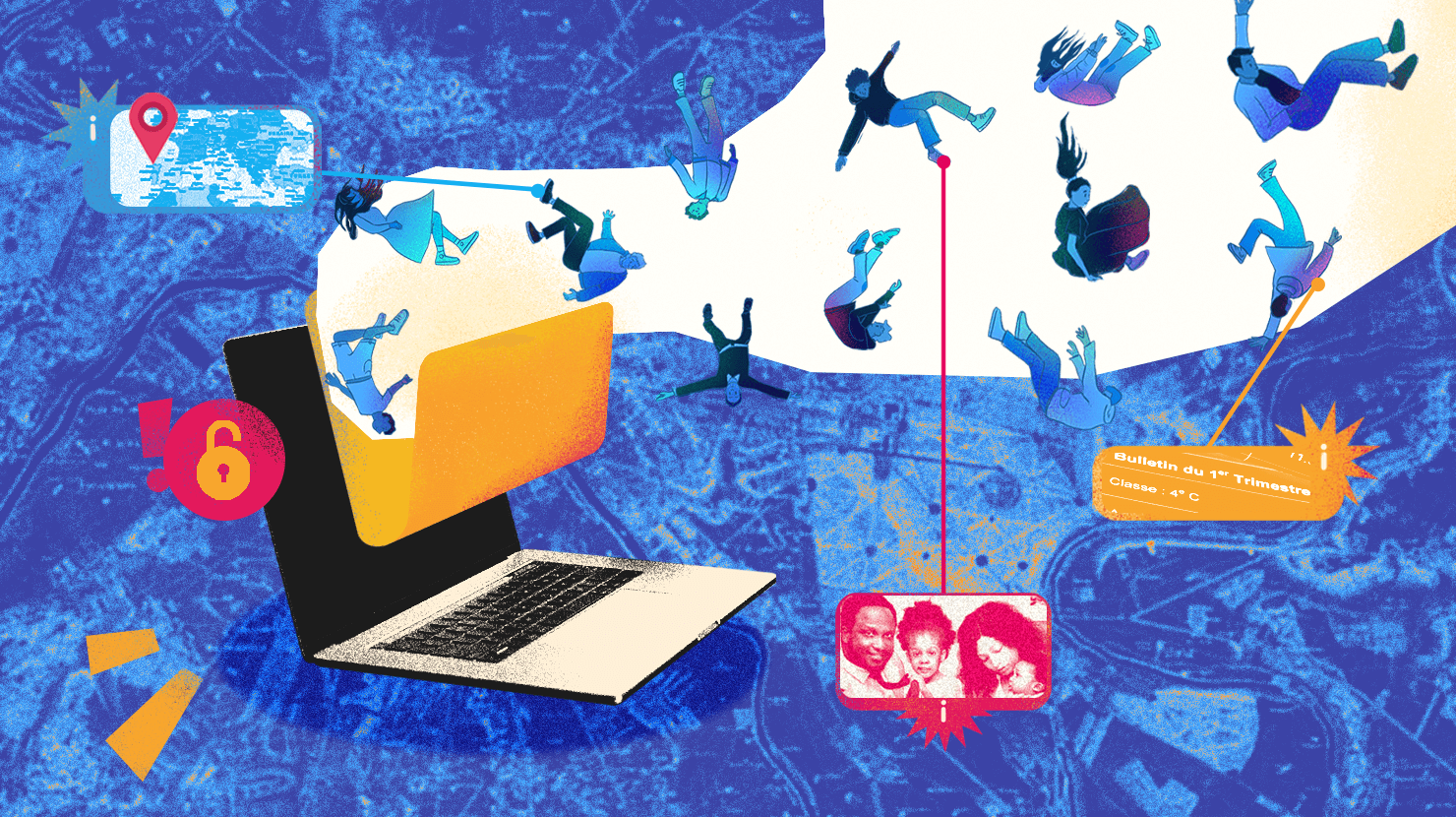« À quel moment mettre un jeune de 16 ans seul à l’hôtel, ça va l’aider ?! C’est une manière de se débarrasser de nous… » Chris a 17 ans. Le grand garçon enfoncé dans un épais manteau noir, d’où dépasse juste une chaîne dorée, est en colère. Il fait partie des 320.000 enfants et jeunes majeurs à faire l’objet de mesures de protection à l’ASE, l’Aide Sociale à l’Enfance. Près de la moitié d’entre eux sont retirés à leurs parents et placés dans des familles d’accueil, des foyers encadrés par des éducateurs ou autre lieu de vie. Mais il y a aussi ceux qu’on appelle en protection de l’enfance « les incasables » :
« Nous on vit dans des hôtels sociaux. On y envoie tous les jeunes qui foutent le zbeul et ne supportent pas la collectivité. C’est mon cas. »
De son parcours, Chris ne dit pas grand-chose, si ce n’est qu’il a été retiré à ses parents il y a dix ans. Il a encore quelques liens avec sa mère et son frère, balaie-t-il. De 7 à 16 ans, il est placé en foyer. Et puis, il y a un an et demi, il atterrit à l’hôtel. « Au début j’aimais bien ne plus avoir d’éducateur sur le dos. Mais en fait, la vie quand t’es tout seul, c’est vraiment dur… » Bien loin d’un l’hôtel classique, ces établissements accueillent des personnes en situation d’urgence : des familles précaires, des exilés, des SDF, et, donc, certains jeunes pris en charge par l’ASE. Chris raconte sa vie difficile en autonomie, les conditions sanitaires déplorables et sa peur de tomber malade. Après un temps, il finit par se confier sur son agression. Dans l’hôtel précédant où il vivait, en Seine-Saint-Denis, il se retrouve témoin de vols et de trafic de drogues. Pudiquement, il raconte son rapt par des jeunes du quartier, qui cherchaient à le faire parler, l’ont fait monter de force dans un camion, tabassé et laissé en sang dans une rue. Ce qui a entraîné son changement d’hôtel par l’ASE.
La détresse de ces enfants serait connue des différents services de l’ASE, et des départements dont ils dépendent. L’entourage d’Adrien Taquet, secrétaire d’Etat à la Protection de l’enfance, promet que ces jeunes hébergés en hôtel sont « une grande priorité ». En attendant, Chris se sent lâché. Tout comme Killian, Abduraman et Jasmine.
L’insalubrité
« Mon éduc’ m’a dit que l’hôtel était sale, mais qu’il n’avait pas le choix pour l’instant. » Killian a 17 ans. Il a été placé dans un hôtel social de Nîmes, dans le Gard, à l’automne :
« Je comprends qu’on me mette là si on n’a pas le choix. Je préfère ça qu’être dehors, comme ça m’est arrivé. La galère, je connais. J’ai appris à me débrouiller. »
Déscolarisé, Killian a été renvoyé de son foyer, mais refuse de dire pourquoi. Il explique avoir passé deux mois à la rue, assurant qu’il n’a pas réussi à joindre son référent en protection de l’enfance, avant, finalement, d’être placé à l’hôtel. S’il est conciliant, le jeune homme qualifie tout de même l’établissement de « nul ». « L’hygiène ! Il y a des tâches partout sur les draps, de l’humidité et du moisi dans les couloirs. Rester confiné là-dedans ce n’était pas possible ! » Alors il squatte chez des amis, tant qu’il peut. Une solution qui lui permet de continuer à « faire son propre argent », comme il dit. Le jeune homme n’a ni allocation ni revenu. « Je vends de la beuh, c’est comme ça que je vis. Je prends des risques et j’assumerai les conséquences. J’arrêterai de vendre quand j’aurais une aide. Mais là, je n’ai pas le choix. » Selon les départements, les allocations peuvent varier, mais un mineur placé à l’hôtel reçoit en moyenne 450 euros par mois, parfois accompagnés de tickets repas, à hauteur d’un par jour, à utiliser dans les restaurants alentour.

Dans certains hôtels sociaux, des punaises de lit prolifèrent dans les matelas. / Crédits : Lola Fourmy
Abduraman, lui, a été logé dans quatre hôtels différents depuis son arrivée en France, il y a deux ans et demi. Sa voix est calme quand il raconte sa fuite du Mali – « parce que ma famille n’était pas très gentille » –, sa traversée du Maroc, de la Méditerranée, puis de l’Espagne. L’exilé de 18 ans assure que son hôtel dans le Val d’Oise, où il vit le confinement, est de loin « le moins bien » où il a été placé. Le jeune homme énumère : sa chambre est une petite pièce sale, le papier peint est arraché, l’humidité crée des moisissures sur les murs, il n’y a qu’une douche et un WC pour tous les habitants de l’hôtel.

Dans certaines salles de bain, le papier peint se décolle à cause de l'humidité et des moisissures. / Crédits : Lola Fourmy
Même expérience pour Chris qui, après son agression en Seine-Saint-Denis, a été placé dans un hôtel de Paris. « Franchement, au début j’avais plus peur d’attraper le Covid ici qu’à l’extérieur ! » Le jeune homme a changé quatre fois d’hôtel ces dix-huit derniers mois. Dans cet hôtel parisien, il dénonce des conditions d’hygiène déplorables : « Déjà, il y a des souris et des cafards qui grouillent partout », commence-t-il. « Et dans nos chambres, il fait vraiment froid. On n’a pas de couette. Les plaids qui servent de couverture ne sont jamais lavés. » Dans sa chambre, il a un lavabo. Mais les sanitaires sont communs. « C’est des toilettes turques et on est au moins 40 à se les partager à mon étage. » Il ajoute :
« Des fois je préfère aller chier au Grec en face qu’ici. C’est plus propre ! »
Plus en sécurité dehors ?
Dans l’hôtel de Chris, les douches sont dans une cour extérieure qu’il faut traverser pour remonter dans les chambres. Difficile avec les températures actuelles d’éviter les coups de froid. L’adolescent est tombé vraiment malade pendant le premier confinement. « On a pensé que c’était le Covid mais le test était négatif », complète Cindy (1) l’éducatrice qui le suit. Elle fait partie d’une association qui intervient en complément de l’ASE.
Chris avoue ne pas respecter le deuxième confinement. « J’ai tenu une semaine ! Mais quand j’ai vu que tout le monde sortait j’ai craqué ! Vous imaginez rester enfermé dans cette chambre, tout seul pendant un mois ? C’est une cage, on est des prisonniers. » Alors il sort, brave l’interdiction, écope d’amendes qu’il ne peut pas payer et continue « ses activités ». « Aucun des jeunes que l’on suit en hôtel ne respecte le confinement. Certains, très angoissés, se sentent davantage en sécurité dehors », raconte Cindy, l’éducatrice. Elle poursuit :
« D’autres sont en errance. Typiquement, on a un jeune qui vivait dans un hôtel où il y avait de la prostitution et du trafic de drogues. Il était en situation d’addiction. Le confinement a été la goutte d’eau qui fait déborder le vase. Il a tenté de se suicider. Aujourd’hui, il est hospitalisé… »
L’association où travaille Cindy est basée en Seine-Saint-Denis. Et parfois, elle regrette le manque de réactivité de l’Aide Sociale à l’Enfance. Pire, elle parle de mise en danger. « Il y a un hôtel, avec lequel on ne voulait plus travailler parce qu’il est sale », raconte-t-elle. Son association signale au département le problème. « Le lendemain, ils ont placé une autre fille de l’ASE dans la même chambre. Avec des tâches sur le sol, un frigo tout noir, des sanitaires crades. Surtout, c’est une jeune fille sur laquelle on a des suspicions de prostitution. La laisser dans un hôtel où il y a les mêmes problématiques, c’est la mettre en danger. »

Dans les chambres mal isolées, il fait froid et humide. / Crédits : Lola Fourmy
C’est dans ce contexte qu’il y a un an, Jess, 17 ans, confié à l’ASE, a été mortellement poignardé par un autre jeune dans l’hôtel où ils étaient logés, à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine. Le gouvernement avait alors saisi l’Igas (Inspection générale des affaires sociales), pour réaliser un audit complet sur les conditions de prise en charge des enfants dans des lieux non-autorisés sur l’ensemble du territoire national. Un rapport qui, dit-on dans l’entourage du secrétaire d’Etat à la Protection de l’enfance Adrien Taquet, sera publié avant la fin de l’année. « Nous avons besoin de cet état des lieux pour mener une stratégie plus globale. » Tout en rappelant que la protection de l’enfance est une compétence des départements. « C’est de la mauvaise foi ! », s’agace Mamédi Diarra, lui-même passé par l’ASE et aujourd’hui président de Repairs! dans le Val de Marne. Dans cette association d’entraide, des anciens enfants placés accompagnent des jeunes encore à l’ASE ou tout juste sortis, ainsi que les pupilles de l’Etat :
« Moi je pense qu’il y a un manque de volontarisme au sommet de l’Etat pour imposer un cadre et des contrôles au département. »
Il poursuit : « Nous, on demande que les jeunes ne soient plus placés à l’hôtel. Il ne faut pas rêver ! Les hôtels ne sont pas des Accor. Ils sont plutôt cachés au-dessus d’un PMU ! Personne n’accepterait de mettre ses propres enfants là, c’est juste indécent ! ».

La peinture des plafonds se fissure à cause de l'humidité. / Crédits : Lola Fourmy
Le département du Gard – garant de l’hôtel où se trouve Killian – n’a pas souhaité répondre à nos questions, avançant des contraintes d’agenda. Le département du Val d’Oise – où se trouve Abderaman – n’a jamais donné suite à nos mails. En revanche, celui de la Seine-Saint-Denis – dont dépend Chris – ne nie pas la situation d’insalubrité de certains de ses hôtels :
« [Une fois alertés] nous réagissons immédiatement par des inspections sur place. Il est hors de question que nous puissions continuer à financer des hôtels qui ne remplissent pas leurs obligations vis-à-vis des personnes hébergées ! »
Le département de la Seine-Saint-Denis reconnaît que ses structures d’hébergement d’urgence sont saturées, souligne l’arrivée importante de MNA (mineurs non accompagnés) – 1.700 pris en charge actuellement – et affirme vouloir développer d’autres formes d’accueil, notamment des colocations et de nouvelles places en accueil familial.
À LIRE AUSSI : « Pour les migrants mineurs, le cauchemar est permanent »
Solitude
« À l’hôtel, je n’ai plus personne derrière moi qui m’aide et me soutiens. Je me sens isolé », se livre Chris. Une situation partagée par la plupart des jeunes interrogés. « En ce moment, chaque jour, je me dis que c’est dur. C’est surtout difficile de se retrouver seule », confie Jasmine, 18 ans. Elle est prise en charge par l’aide sociale à l’enfance depuis l’âge de 14 ans, pour échapper aux violences sexuelles et psychologiques de sa famille. Après les familles d’accueil, les foyers, les hôtels, elle vit aujourd’hui dans un studio « impeccable », situé dans un hébergement dégoté et payé par une association de protection de l’enfance qui ne ressemble en rien à l’hôtel social où elle était placée auparavant. Elle dispose maintenant d’un coin cuisine, de sanitaires propres et d’un environnement sécurisé.
Pourtant, rien n’efface les traumatismes et le besoin de soutien. « Quand je rentre chez moi, je suis livrée à moi-même, il n’y a pas de repas chaud qui m’attende sur la table et personne pour prendre soin de ma santé. Et être seule me fait cogiter, je me demande pourquoi mon père ne prend pas de mes nouvelles par exemple ». Elle affirme que son éducateur ASE ne la contacte jamais. Désormais, c’est l’association qui la prend en charge et qu’elle rencontre une semaine sur deux qui est son seul repère. Difficile pour l’adolescente d’avancer dans ses démarches de scolarisation ou de confier ses angoisses. « J’ai peur pour les jeunes » confie Mamédi Diarra, de l’association Repairs!. Il raconte comment le confinement a accentué les difficultés de ces jeunes à trouver des formations ou du boulot :
« On essaie de se faire connaître et de les aider. Mais ceux qu’on n’a pas encore capté restent très seuls. »
« Je sors plus que pendant le premier confinement », confirme Jasmine, qui poursuit :
« J’ai trop besoin de liens sociaux. Si je reste enfermée avec uniquement les réseaux, je me dis que je ne sers à rien et que je n’arriverai jamais à m’en sortir. »
Selon Martial Nutte, bénévole de Repairs!, mais lui côté Val-d’Oise, « les éducs de l’ASE font le maximum. Mais ils manquent de moyens financiers et humains. Ils sont démunis ». Il poursuit :
« Quand on voit le nombre de dossiers par personne – parfois une quarantaine – il est impossible de voir chaque jeune suivi, ne serait-ce qu’une fois par mois. Et ce n’est pas faute d’en avoir envie… »
S’en sortir
À 18 ans, Abduraman vient d’obtenir un contrat jeune majeur. Le dispositif de prise en charge peut être proposé par le département à certains jeunes de l’ASE. « Et son éducatrice s’est battue pour ça ! », explique Martial Nutte. Il suit le jeune Malien, en complément de l’ASE, depuis maintenant plus d’un an. Il a observé l’exilé isolé s’accrocher. Et ses efforts ont payé : il a trouvé un apprentissage. Le boulanger en formation rentre souvent après minuit du travail. Mais il raconte ne pas trouver le sommeil :
« Je ressasse. Je me demande pourquoi tous mes amis ont été relogés, mis en foyers et pourquoi moi je suis toujours là. Tout ce que je veux, c’est partir d’ici. »
« En tant qu’enfant placé, on n’a pas du tout les mêmes chances que les autres jeunes », assure Jasmine, la Parisienne de 18 ans. Elle a été plusieurs fois déscolarisée. Militante et passionnée de cinéma, elle a pourtant des plans et rêve d’une carrière de documentariste. « Je n’ai aucune base dans la vie : pas d’accès à la culture, personne pour m’aider à m’inscrire à la fac, je n’ai même plus d’accès aux soins ! Si je dois aller chez le médecin en ce moment, c’est moi qui dois payer. »
Elle se bat, voudrait s’en sortir, mais elle sent qu’en ce moment sa santé mentale est en danger. Pendant le premier confinement, elle a fait deux tentatives de suicide. « Je sais que je ne suis pas totalement sortie de ça, c’est un combat », explique Jasmine. La jeune femme confie son envie de consulter un psychiatre, mais explique ne pas en avoir les moyens. S’ajoute la honte de demander davantage d’aide à l’association qui la suit. Amère, elle répète :
« On n’a pas les mêmes chances depuis toujours. Je me souviens du lycée. Je me disais que les autres avaient tout. Et que je n’avais rien… »
(1) Les prénoms ont été modifiés
 Soutenez
Soutenez