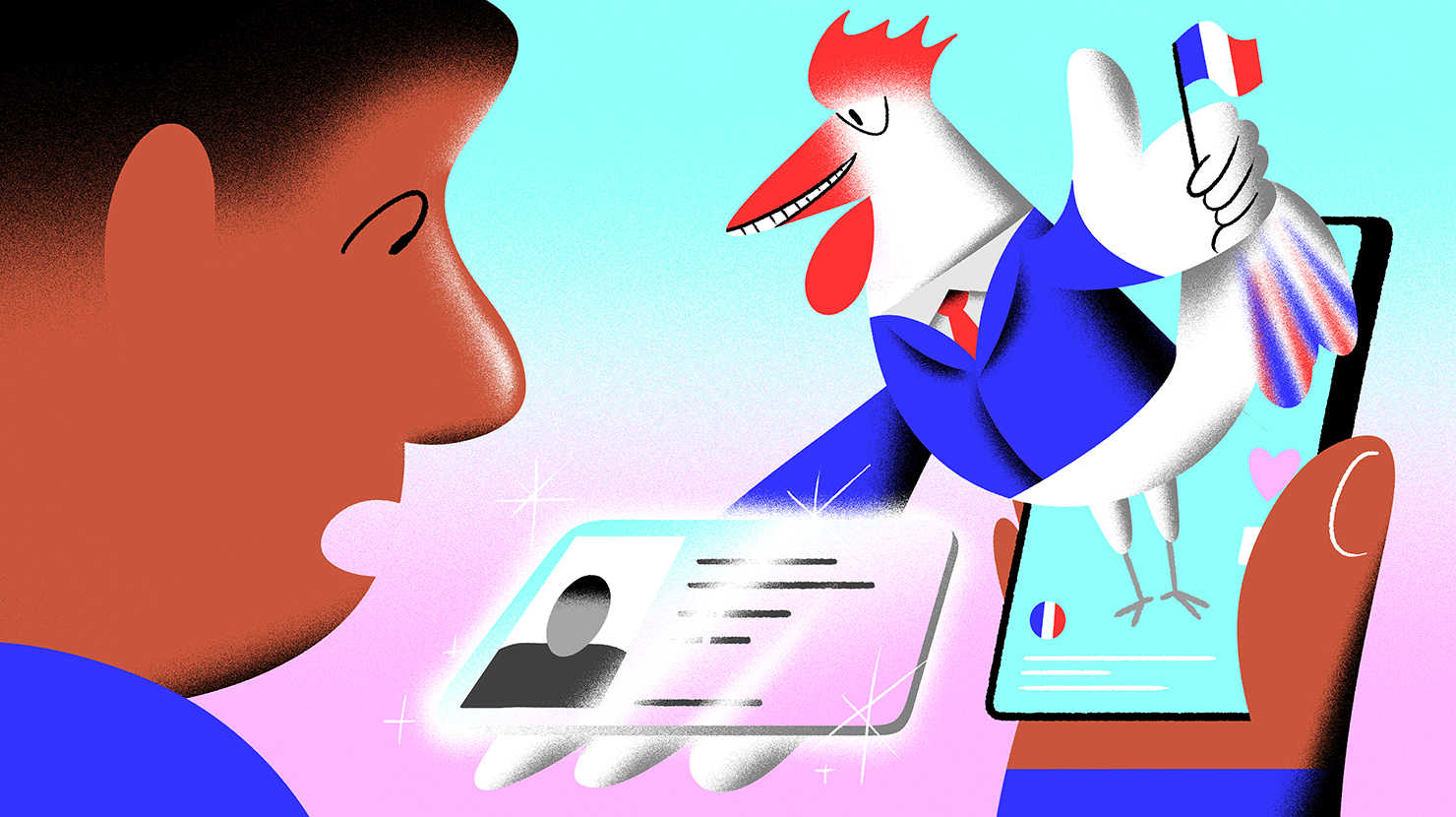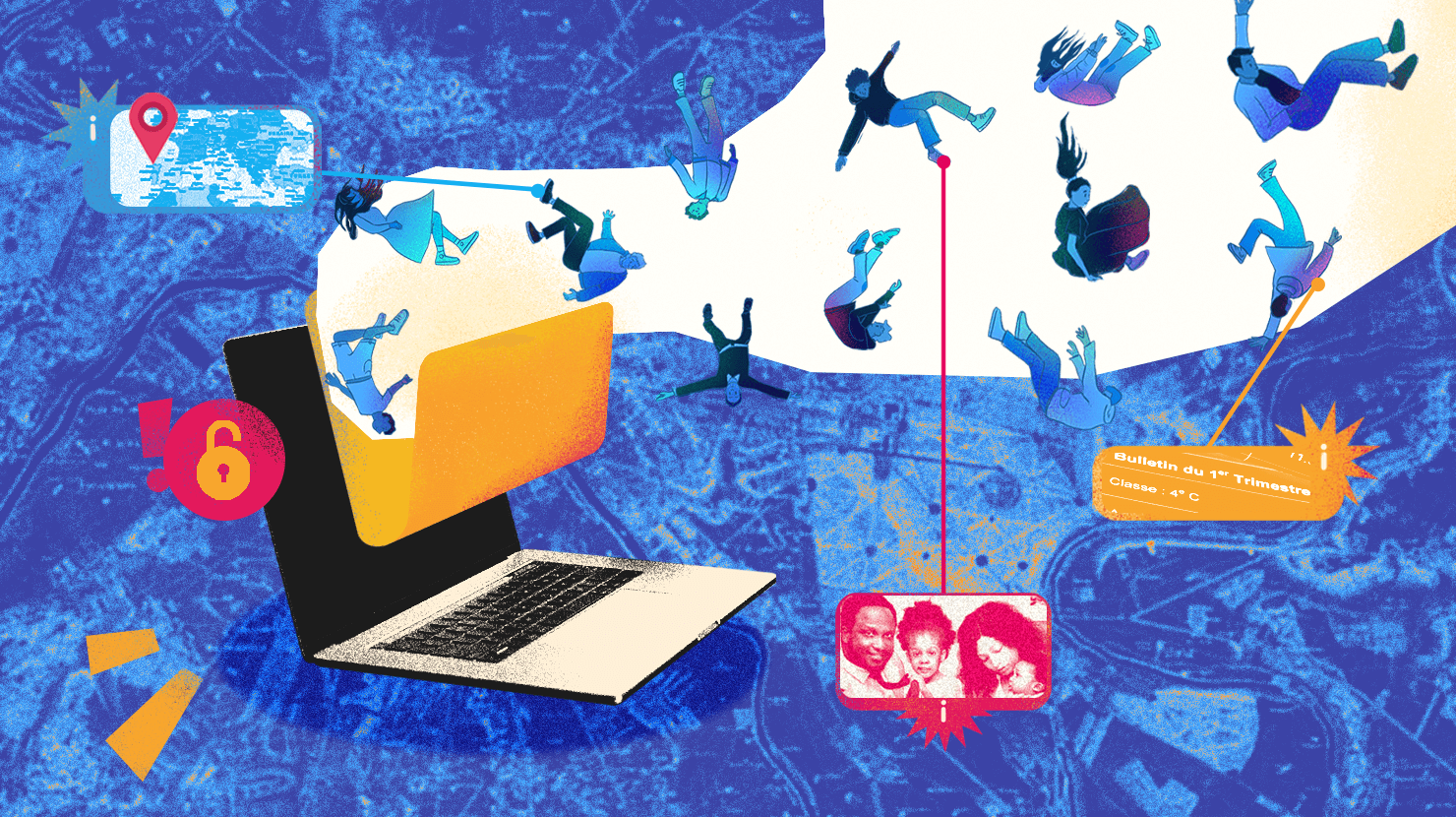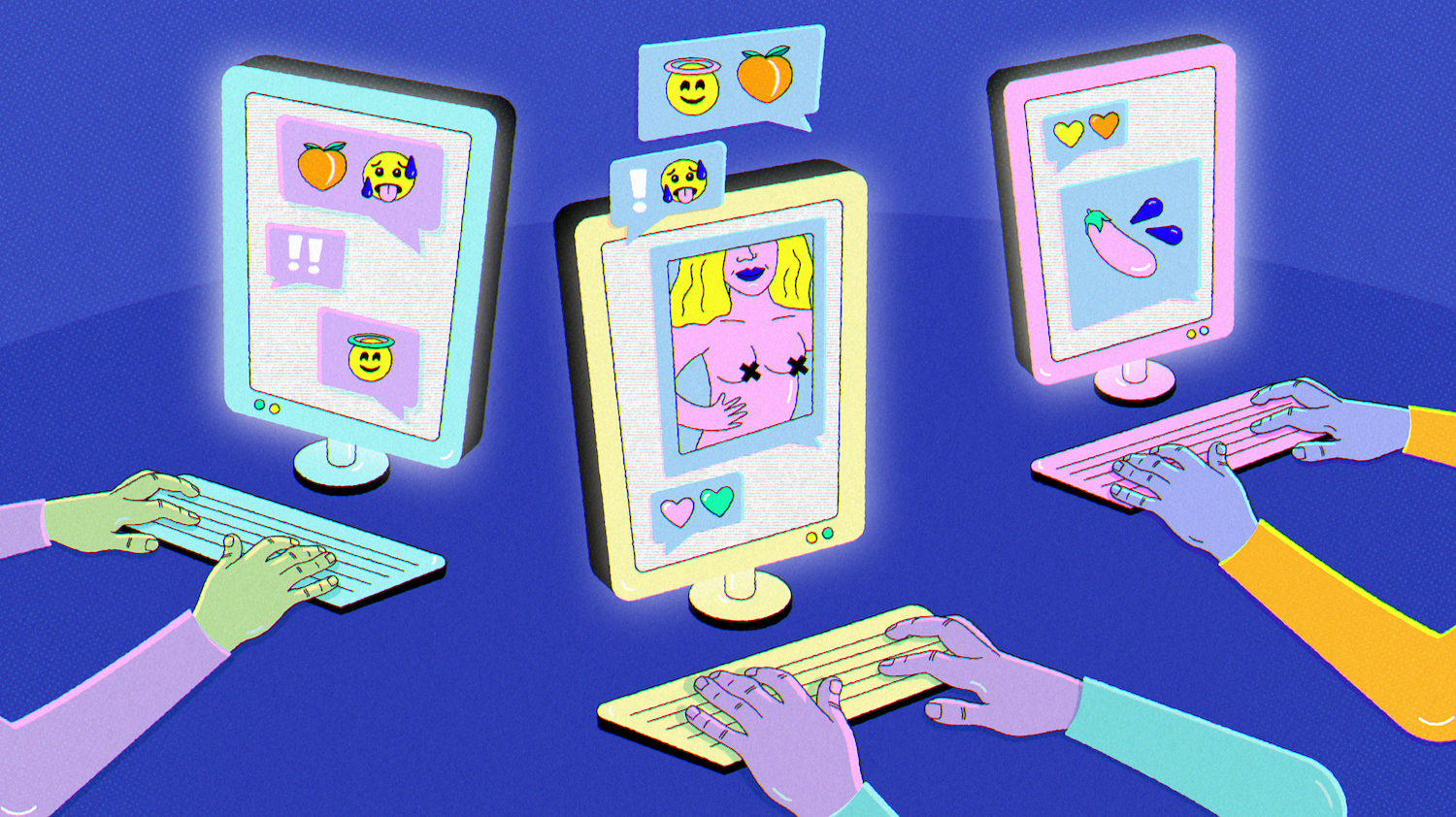« La France est en guerre », lançait François Hollande au lendemain des attentats du 13 novembre 2015. Pourtant, dans ses campagnes de recrutement, l’armée vend du rêve. La réalité décrite par les deux journalistes Justine Brabant et Leïla Miñano, dans Mauvaise troupe (Les Arènes) est moins rose. Les jeunes engagés finissent désabusés par la cadence infernale des opérations qui s’enchaînent. Il y a Sentinelle, où les soldats découvrent l’absurdité des patrouilles constantes. Pour certains, comme Timothée, c’est « l’opération de trop » qui le fait déserter après un burn-out. Il y a aussi les « opex » [opérations extérieures] comme Sangaris, en Centrafrique, mal préparées où de nombreuses exactions ont été commises. Certains soldats en reviennent traumatisés.
L’enquête est parsemée de témoignages qui expliquent les dérives de l’armée française. « On a cherché à garder les histoires qui représentaient quelque chose. Ce ne sont pas des faits divers ou des cas isolés. C’est symbolique », affirme Leïla Miñano. Souleymane et Ali racontent par exemple comment ils ont été renvoyés de l’armée pour une sombre histoire de caisse à munitions remplies de drogues, consommées principalement par les officiers, à Canjuers, le plus grand camp militaire de France et d’Europe. Un marchand centrafricain, Toubi, explique lui comment des militaires du 2e RIMa l’ont torturé dans leur camp, en représailles d’un vol. « Ils ont mis un sachet sur ma tête et ils ont rempli d’eau par en haut. C’était comme si je m’étouffais. Ça a pu durer trois minutes », témoigne ce dernier.
Il y a aussi le récit de Romain ou Idriss, militaires traumatisés après leurs passages à l’armée, qui finissent par braquer un Cash Converter ou une bijouterie. « J’avais besoin d’adrénaline et de tout ce que je ne pouvais plus faire à l’armée », raconte Idriss, ancien para.
Ce n’est pas la première fois que les deux journalistes s’embarquent sur ce terrain, loin de là. Leïla Miñano a co-écrit une enquête sur les violences sexuelles à l’intérieur de l’armée française : la Guerre Invisible. Justine Brabant, elle, est l’autrice d’un livre sur les combattants du Kivu, au Congo, Qu’on nous laisse combattre, et la guerre finira. Ensemble, elles ont réalisé avec un collectif de journalistes l’investigation Impunité Zéro, sur le viol comme arme de guerre.
Cela fait quelques années maintenant que vous travaillez toutes les deux sur l’armée. Quand est-ce que vous avez pris la décision de faire ce livre ?
Leïla : Après Impunité Zéro et l’enquête sur des accusations de viols faites contre l’armée française durant l’opération Sangaris. À cette occasion, on avait eu accès à des procès-verbaux et découvert qu’il y avait des jeunes et très jeunes qui étaient derrière ces potentielles exactions. Ça nous a énormément interpellé car on s’est dit qu’ils pourraient être nos frères, nos cousins…
Justine : Il y a un bouquin qu’on a trouvé hyper-intéressant sur l’armée américaine, qui s’appelle Irregular Army de Matt Kennard. Il raconte comment ils ont fait face à un gros besoin de recrutement, juste après le lancement des guerres en Irak ou Afghanistan. Comment ils ont baissé leurs critères et fait de la retape dans les écoles en filant des bourses pour ensuite aller à l’armée, en recrutant même des gens qui avaient un passé néonazi. C’était intéressant et pertinent de transposer la question en France et voir quels ont été les effets sur l’armée française. Surtout depuis 2015, quand l’État français s’est déclaré en guerre contre le terrorisme.
Vous racontez que des militaires font des burn-outs à cause de Sentinelle. Le fait que le soldat ne peut pas s’exprimer et qu’il n’y a pas de syndicats sont des facteurs supplémentaires à leur précarité ?
Justine : L’armée ne peut pas se permettre d’avoir des syndicats qui puissent expliquer l’envers du décor. Il y a une crise de recrutement : 15.000 soldats doivent être recrutés chaque année car 12.000 partent. Si l’armée ne fait pas d’autocritique et ne souhaite pas voir sortir des informations sur ce qui ne va pas, c’est parce qu’ils savent probablement que ça va dissuader des gens de s’engager. C’est pour ça que c’était important de donner la parole à deux anciens recruteurs. Je crois que ça n’a jamais été fait jusqu’à présent. Ils expliquent que c’est difficile, qu’ils ont des quotas…
Leïla : C’est aussi quelque chose qui rend vraiment service au gouvernement et aux institutions dans le cadre de l’opération Sentinelle. Ça donne des hommes et des femmes à peu de frais pour patrouiller dans nos rues. On ne leur paye pas d’heure supplémentaire et ils n’ont pas le droit de faire grève. C’est leur conjoint qui va manifester dans la rue.
Vous expliquez que, face à ce travail rébarbatif de patrouilles avec Sentinelle, certains tombent dans les addictions. Comme la drogue.
Leïla : La drogue est un vrai problème dans l’armée, qu’elle essaie de cacher par différents biais. On a pu accéder à de nombreux tests de dépistage et des questionnaires remplis par les soldats – tout est très documenté à ce niveau-là. Dans l’armée de terre, les jeunes fument deux fois plus de cannabis que sur la même population en France. C’est trois fois plus pour les « usagers problématiques ».
Vous expliquez que cette drogue permet aux soldats de compenser les stress post-traumatique (SSPT), qui sont mal pris en charge par l’institution.
Justine : On montre, dans une certaine mesure, que la tolérance vis-à-vis de la drogue, comme les exactions qu’ils laissent passer, sont des soupapes pour l’encadrement. Les chefs peuvent dire : « On les laisse fumer un joint parce que ça les détends ». « On les laisse cogner un coup car ça évitera peut-être de plus grosses bavures ». C’est vraiment une institution qui ne peut pas effectuer un suivi psychosocial et lâche du lest. Ils ne vont pas renvoyer des gens pour un joint car former un militaire prend du temps et de l’argent.

Justine Brabant est journaliste indépendante au sein du collectif Les Journalopes. Elle a écrit Qu'on nous laisse combattre et la guerre finira, sur les combattants du Kivu au Congo. / Crédits : Christophe-Cécil Garnier
Il y a aussi une justice de classe. On raconte une histoire qui se passe à Canjuers, le plus grand camp militaire français et européen. Une caisse à munition est retrouvée avec 20.000€ de drogues à l’intérieur. Il n’y avait pas que du cannabis mais aussi de la cocaïne. À la fin, ce sont les jeunes militaires, qui viennent des quartiers nords de Marseille, qui sont sanctionnés. Les officiers qui consommaient massivement, aux dires de l’un des témoins, s’en sont sortis.
Cette affaire n’a jamais été dévoilée dans la presse ?
Leïla : Non jamais. Quand on découvre cette affaire, je suis dans le cabinet d’un avocat pour une histoire de désertion et il me raconte ça. Lui-même était étonné que ce ne soit pas sorti. Les audiences sont publiques – après, il n’y a jamais personne. Que nous quoi ! (rires). L’institution devait être très contente que ça ne se sache pas. C’est très mauvais pour l’image.
Est-ce que vous avez constaté d’autres cas où le soutien psychologique a manqué ?
Justine : On raconte l’histoire d’un militaire français en Centrafrique qui a tiré sur un civil. Quand il rentre, il se sent mal et dit à son chef qu’il a peut-être un SSPT et qu’il ne se sent plus de porter l’uniforme. Ce à quoi son chef répond : « Pour la France, tu es mort, tu n’es plus rien ». Ça montre qu’il reste une sorte d’esprit de corps un peu viril où aller chez le psy est une faiblesse.
Leïla : Les militaires sont pourtant des gens qu’il faut prendre en charge, parce qu’ils peuvent potentiellement représenter un danger pour la société. Il y a Paul, par exemple, qui revient du Mali et qui a pris cher là-bas avec son unité. Mais on dit à son unité que, si elle va se plaindre au psy, ils seront virés. Donc quand ils remplissent leur questionnaire d’évaluation à la fin de leur mission, lui et ses camarades mettent « RAS » [Rien à signaler]. Pour d’autres, le manque de suivi psychologique les a amené à braquer des banques ou des commerces.
L’un d’eux, Idriss, se retrouve à pointer naturellement les policiers avec son arme lors du braquage d’une bijouterie.
Leïla : Oui, les braqueurs nous ont tous répété la même phrase qu’on leur a inculqué, alors qu’ils ne se connaissent pas : « Quand on te pointe, tu pointes ». Ils ont des réflexes militaires qu’ils ont appris après des années de formation. La société se retrouve face à des machines de guerre. Heureusement, ils ont des éclairs de lucidité qui font qu’ils n’ont tué personne.
Justine : On parle d’un défaut de prise en charge psychologique mais on montre aussi qu’il y a un défaut de prise en charge financière à certains moments. Quand ils sont déclarés inaptes, blessés psychologiquement ou physiquement, l’armée est censée leur donner une pension. Mais parfois le « tribunal des pensions militaires » leur refuse.
Leïla : J’ai fait plusieurs sessions de ce tribunal et c’est terrible de voir la façon dont l’armée tente de grappiller chaque euro. Sur une personne qui a des acouphènes parce qu’elle a sauté sur une mine, elle va lui dire que ses problèmes au dos ne sont pas liés. Donc on donne 100€ à la place de 200. C’est bien loin de ce qu’on leur a vendu dans les clips de pubs. C’est vraiment triste. Tu vois des éclopés qui pleurent à la barre, car ils prennent ça comme un défaut de reconnaissance de leur service. Cette dernière gifle c’est le poing final qui les fait encore plus plonger derrière.
Pour les militaires français, l’opération Sangaris en Centrafrique semble avoir été un tournant. Pourquoi ?
Justine : Depuis 2012-2013, il y a une accumulation d’opérations sans précédent. Il y a le Mali qui est devenu une opération globale au Sahel, la Centrafrique, Sentinelle… On a tiré sur la corde et c’est en Centrafrique qu’elle était proche de rompre. C’est décidé rapidement et c’est une catastrophe logistique sur les premiers mois. Ça a aussi été une guerre très particulière, où les combats se sont faits à l’arme blanche. Visuellement, c’est très fort. La guerre c’est toujours moche et dégueulasse, c’est sûr, mais voir des gens décapités, des cadavres mutilés, ça a des effets très néfastes.
(repitw) Leïla : Ils sont hantés par les images de civils ou d’enfants touchés. Ça a été la guerre la plus traumatisante depuis que le SSPT [syndrome de stress post traumatique] est mesuré dans l’armée française. % 12 des militaires envoyés en Centrafrique sont revenus avec des SSPT, officiellement, contre 8% en Afghanistan. Les spécialistes disent qu’il y en a certainement plus car le choc ne se déclare pas forcément dès le retour.
Cette impréparation a eu des conséquences sur les populations locales ?
Justine : Certainement. Il y a aussi l’impuissance qu’ils ont ressentie. Ils devaient par exemple remettre tous les prisonniers aux autorités centrafricaines mais ils ont rapidement compris que ces derniers n’avaient pas les moyens de les garder. Ils avaient l’impression que les prisonniers étaient libérés quelques jours plus tard. D’où le fait de décider d’être des « justiciers » par la suite, même si ça n’excuse rien.

Leïla Miñano est journaliste au sein du collectif Youpress. Elle est également membre du consortium de journalistes Investigate Europe et secrétaire générale du média Disclose. / Crédits : Christophe-Cécil Garnier
Leïla : Par ailleurs, tous ne le deviennent pas. On raconte cette histoire d’un marchand tabassé dans l’enceinte de l’Alliance française, où deux hommes essaient de s’interposer et sont envoyés baladés. Tout le monde ne participe pas à ces crimes de guerre. Car c’en est un.
Certains ne s’en rendent pas compte…
Leïla : C’est ça qui est frappant. Alors qu’ils n’auraient pas tolérés ça en France. Si des militaires ligotent un marchand français parce qu’il leur a volé 200 euros et qu’ils le tabassent, ça fait la Une de tous les médias. Si des militaires arrivent dans un restaurant et disent à la serveuse : « Viens on va faire une passe pour deux euros dans un coin », ça fait scandale. C’est un vrai problème de formation dans l’armée française : pourquoi ils se disent qu’ils peuvent le faire avec une Centrafricaine et pas avec une Française quand ils tournent avec Sentinelle ? Il y a une déconnexion. On est dans un autre pays donc on a les mains un peu plus libres.
Pour l’histoire du marchand, il y a eu des condamnations ?
Leïla : Certaines carrières ont pu être freinées mais on est face à un crime de guerre où les auteurs n’ont pas fait un seul jour de prison. Pas un seul n’a été auditionné par la justice. Personne n’a pourtant nié qu’il était ligoté à un arbre et qu’il s’est fait tabasser par plusieurs soldats. Dans la procédure, les militaires disent surtout : « Je n’ai pas mis de coup de poing, c’est untel ». L’armée devrait s’emparer de ce type d’histoires. C’est une armée d’État, ce ne sont pas des mercenaires. Les militaires français sont des justiciables.
Justine : On nous dit souvent que les tabassages sont monnaie courante en guerre. Mais c’est aussi ce qu’on disait il y a quelques années sur les questions de harcèlements et d’agressions sexuelles de femmes dans la société. Il faut un changement pour qu’on se dise que ce n’est pas normal. Il y a des mecs qui réussissent à ne pas harceler des femmes dans la rue et il y a des militaires qui réussissent à ne pas tabasser des prisonniers. Pour des armées nordiques, c’est inconcevable de brutaliser des prisonniers. Au Congo, il y a eu une affaire où des soldats français ont vraisemblablement tué un civil congolais après l’avoir tabassé dans le cadre de l’opération Artémis, en 2003. Qui a donné l’alerte ? Des militaires suédois.
C’est également en Centrafrique que se passent des histoires de violences sexuelles, un sujet que vous aviez déjà abordé en 2017 dans votre enquête Impunité Zéro. Est-ce que vous avez fait de nouvelles découvertes dans cette enquête ?
Leïla : Pour nous, c’était super important de revenir dessus. On a eu la chance d’avoir ce mouvement MeToo qui a permis de prendre conscience qu’il fallait faire des vraies politiques de prévention et de vraies sanctions. Mais le MeToo du viol de guerre n’a pas eu lieu encore. Ça fait dix ans que je travaille dessus et on me fait toujours la même réponse : c’est un corollaire de la guerre. Alors qu’on est face à des viols en réunion ou avec actes de barbarie. Un jour, les gens verront la différence entre la prostitution et la « prostitution de survie ». Quand on est une femme ou une jeune fille, qu’on n’a pas de quoi se nourrir et qu’on se retrouve face à un homme en arme qui nous propose une bouteille d’eau, le consentement est vicié. Il n’existe pas.
Dans une précédente interview pour StreetPress, vous estimiez que pour « l’armée française est toujours gênée aux entournures quand on parle de viol et de violence ». C’est toujours le cas ?
Justine : Oui bien sûr. Elle n’a pas intérêt à dire : « Vous allez vous retrouver sur des théâtres d’opérations qui seront des boucheries, vous allez croire que vous êtes les rois du monde et violer des mineures ». Elle ne veut pas qu’on sache que ça peut être le quotidien d’une recrue en 2019.
À LIRE AUSSI : Enquête sur les viols impunis en temps de guerre
Leïla : Et pourtant l’armée française a un pouvoir incroyable. Elle pourrait expliquer qu’avoir recours à la prostitution sur un terrain de guerre ne doit pas exister pour telles raisons. Ça ne coûte pas grand chose de faire ça alors qu’actuellement, on les forme sur les maladies vénériennes. Ils pourraient également sanctionner pour l’exemple.
Est-ce que vous avez subi des pressions de l’armée en écrivant ce livre ?
Leïla : Oui, quand on a envoyé nos questions à l’armée, à la fin de l’enquête, on a reçu un mail où ils citaient le code pénal et les peines qu’on pouvait prendre face à telle information qui relevait du secret-défense. C’est clairement de l’intimidation par rapport à certaines informations qu’on publie. Par ailleurs, je suis secrétaire générale de Disclose. Il y a à peine quelques mois, la moitié du comité éditorial était devant le parquet antiterroriste. Ce n’est pas rien. Là, il va encore se passer des choses certainement. L’atmosphère actuelle ne sent pas très bon. Il y a des journalistes autorisés et d’autres qui ne le sont pas. Nos demandes de reportages sont refusées ou ils changent d’avis in extremis quand ils demandent l’avis à la haute hiérarchie. Le ministère des Armées est le deuxième budget de l’État, avec 35 milliards d’euros en 2018 et cette zone-là est une zone sans transparence. Ce n’est pourtant pas une zone de non-droit. C’est nos impôts. Elle doit être sous la responsabilité du politique et les journalistes doivent avoir accès aux informations et ne peuvent pas faire l’objet d’intimidations.
Justine : C’est important de dire aussi que l’armée française fait certes de l’intimidation mais, heureusement, en France, on ne se fait pas tuer pour ça. Car quand on bosse en Centrafrique ou au Congo, pour le coup des journalistes se font tuer.
Leïla : Mais j’étais révoltée de recevoir un mail d’intimidation de l’État. Ce n’est pas une milice. Ils connaissent le jeu médiatique. Ils savent que notre jeu est d’aller chercher des infos et eux de répondre ou non. C’est le jeu de la démocratie.