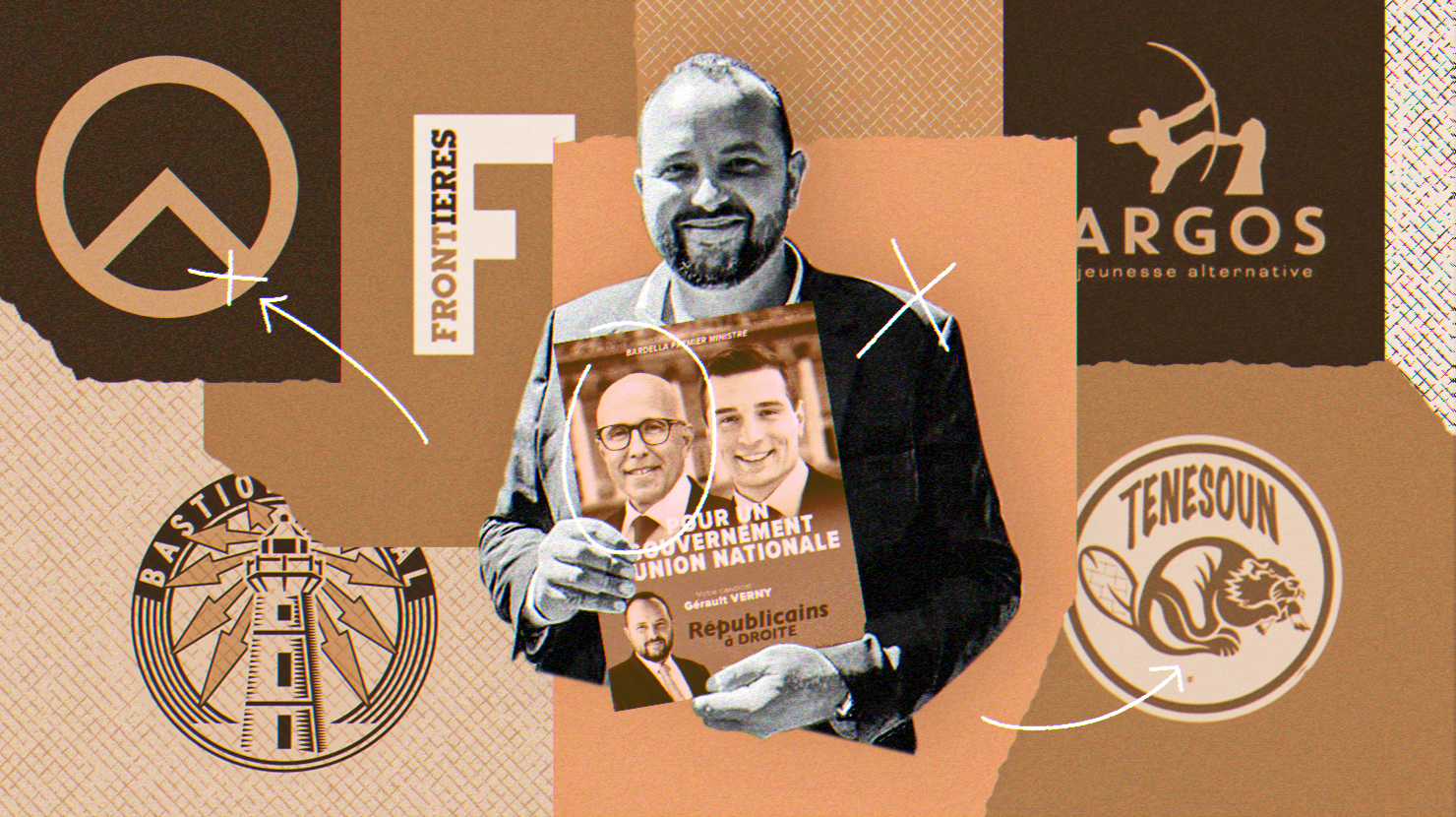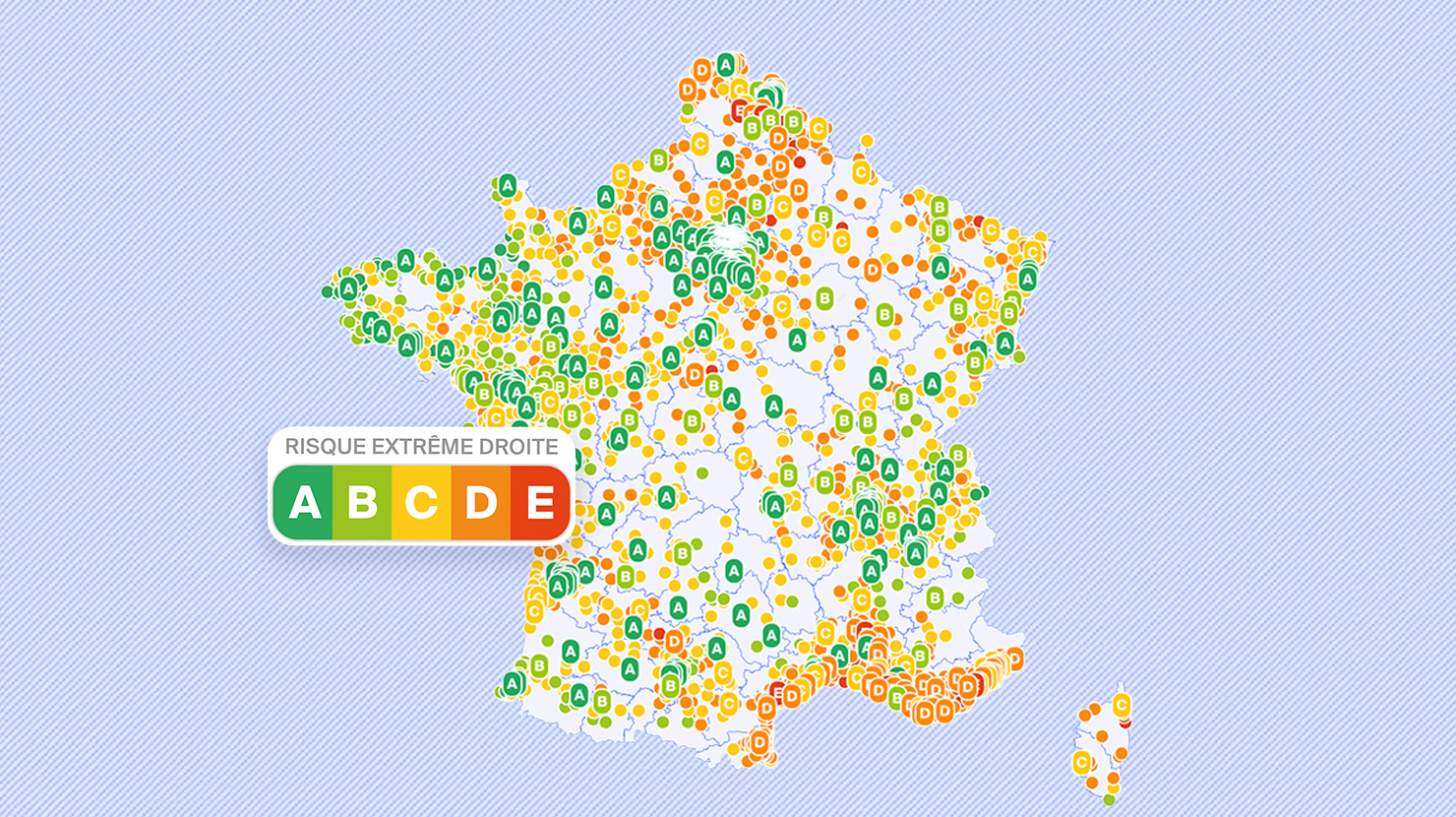« Tata, il faudrait que je te demande quelque chose. Je voudrais écrire un livre sur le métier de nounou. » Timothée de Rauglaudre est journaliste indépendant – et contributeur régulier à StreetPress et Vice, notamment. Pour son livre Premières de Corvée, il a demandé à celle qui le gardait enfant, Souad, de raconter son corps abîmé par des années d’un travail répétitif et mal rémunéré. Si le soir elle s’occupait de Timothée et ses frères, elle se chargeait du ménage la journée. Elle lui a longuement parlé de ses douleurs, obligée de continuer malgré la reconnaissance de son handicap. Pour cet ouvrage, Timothée a interrogé une dizaine de travailleuses domestiques sur leurs conditions de travail. Rahma est atteinte du syndrome du canal carpien : « À force de faire le ménage, les veines commencent à mourir ». Quant à Eugénia, elle « rêvait d’être vétérinaire ». Mais, comme sa mère, elle a fini par faire des ménages.
Les corps qui s’usent. Les heures passées dans les bus et les métros pour chaque matin rejoindre les beaux quartiers. Toutes ces femmes, souvent issues de l’immigration, racontent leurs années à s’occuper des enfants favorisés, contre un salaire modeste. Mais aussi les liens qui les unissent à ces enfants biens nés. Un bouquin pour donner une visibilité à ces travailleuses, « au croisement de tous les systèmes de domination ».
Rejoignez l’équipe StreetPressEnsemble, on finance un média libre, utile et engagé🔜 Peut-être plus tard
Je suis déjà donatrice ou donateur
Comment est née l’idée de ce livre ?
Je suis journaliste depuis un an, et les thèmes qui m’intéressent relèvent des questions dites sociétales, comme le féminisme, l’immigration ou des sujets plus sociaux. En 2017, dans le cadre de mes études, j’ai rencontré Rahma, qui a travaillé dans le nettoyage toute sa vie et qui a arrêté à 45 ans à cause de ses problèmes de santé. Je me suis rendu compte qu’il y avait beaucoup de points communs avec Souad, la femme qui m’a gardé toute mon enfance, mais aussi avec d’autres nounous que je croisais. Alors j’ai eu envie de raconter le parcours qui amène à faire ce métier mal considéré, majoritairement occupé par des femmes précaires.
Pourquoi avoir structuré ce livre en deux parties : l’une témoignage et l’autre plus politique ?
Le point de départ était de donner la parole à une population complètement invisible, et c’est pour ça qu’il fallait absolument laisser ces femmes raconter leur vie. Si elles avaient des portes-paroles dans les médias, qui soient elle-mêmes des travailleuses domestiques, j’aurais très certainement écrit ce livre autrement.
Dans cette démarche, j’avais été marqué par Leïla Slimani. Dans Sexe et Mensonges, elle écrit sur la sexualité des femmes au Maroc. Elle fait une sorte d’enquête et donne la parole aux femmes. Son autre livre, Chanson Douce, parle d’un fait divers aux Etats unis, où une Dominicaine avait assassiné les deux enfants qu’elle gardait. Elle raconte la lutte des classes qui se joue à domicile.
Après, tout un ensemble de sociologues, de politologues, d’économistes m’ont permis de ne pas rester sur un témoignage brut, afin de mettre en perspective la situation sociale de ces travailleuses. Je voulais aussi réfléchir aux conditions nécessaires pour que les choses changent, et à ce que les pouvoirs publics et les militants pourraient faire pour améliorer la situation.
Comment as-tu abordé ton sujet ?
Je voulais vraiment laisser un maximum de place aux témoignages et à l’enquête. Ne pas mettre trop de chiffres, ou de concepts très théoriques et militants pour rester accessible. J’aurais trouvé dommage que seules des personnes familières avec les concepts du féminisme décolonial puissent le comprendre. Pour autant, ce sont souvent des féministes aguerries qui s’intéressent à mon ouvrage. J’ai notamment beaucoup discuté avec Françoise Vergès [chercheuse en sciences politiques et militante féministe décoloniale]. Mais j’ai vu qu’il avait aussi touché des femmes Gilets jaunes, a priori plus éloignées du monde universitaire. C’est quand même avant tout une question sociale : dans leurs témoignages, la précarité est vraiment ce qui est le plus flagrant.
Existe-t-il des mobilisations sociales des travailleuses domestiques ?
La mobilisation, en France, est assez récente puisque le premier syndicat autonome des travailleuses domestiques a été créé en 2012. C’est le SNAP, Syndicat national des auxiliaires parentaux. C’est un mouvement qui n’a pas le poids nécessaire pour être dans une logique de revendication, donc pour le moment ça reste un syndicat d’accompagnement.
Le problème c’est que ces travailleuses sont isolées sur leur lieu de travail. C’est donc difficile de créer une dynamique collective. La secrétaire générale du syndicat disait que leurs nouvelles adhérentes n’ont pas encore cette mentalité de mobilisation collective. D’un autre côté, le patronat est très structuré depuis longtemps et très influent auprès des pouvoirs publics.
Quand est-ce que tu as pris conscience du « rapport de domination » qui existait avec Souad qui te gardait ?
Enfant, on n’a pas du tout conscience des rapports sociaux. Et dans les milieux bourgeois, c’est normalisé d’avoir une domestique chez soi. C’est au cours de mes études que j’ai réalisé que Souad était au croisement de tous les systèmes de domination : femme, issue de l’immigration, pauvre… Et c’est en essayant d’aborder la question sous un angle politique que je me suis rendu compte qu’il y avait deux univers qui se rencontraient à travers son métier : celui de la grande bourgeoisie et celui des travailleuses. Et cette rencontre induit un rapport social de domination.
Pourquoi, à plusieurs reprise, interroger les travailleuses avec les enfants qu’elles ont gardé ?
Dans le cas de Mariam, par exemple, je voulais aborder la relation affective qui se créée entre la travailleuse domestique et l’enfant qu’elle garde. C’est vrai qu’elle ne m’aurait peut-être pas dit la même chose si je l’avais interrogée toute seule. Mais globalement, rares étaient les nounous qui critiquaient de manière virulente leurs employeurs. Ces travailleuses ont intégré le rapport à leurs employeurs qui peut être parfois violent, elles ne se plaignent pas. Elles peuvent perdre leur travail facilement, puisque beaucoup d’employeurs ne respectent pas leurs droits. Être ainsi exposée empêche certainement de remettre en cause ce rapport de domination.

Timothée de Rauglaudre est journaliste depuis un an. /
Crédits : Joséphine Duteuil
Il n’est pas question de violences sexuelles, pourtant on sait que ça existe. Pourquoi ?
Il y a une femme qui m’a parlé de violences sexuelles subies dans le cadre de son travail, mais j’ai choisi, à sa demande, de le taire . Je pense que ça mériterait d’être creusé car effectivement, dans l’espace privé du domicile, il y a encore plus de difficultés qu’en entreprise, à les évoquer. Et même en entreprise, elles ne sont pas épargnées. Des employées de la société ONET en avaient témoigné mais c’était bien avant #metoo et c’était passé relativement inaperçu.
Dans ton livre, tu évoques le film Fatima qui raconte le quotidien d’une femme de ménage en horaires décalés. Qu’as-tu pensé de sa réception médiatique ?
Dans la fiction, on arrive à raconter des histoires touchantes, mais ensuite on échoue à en faire un débat public. Comme si ça devait rester confiné à la sphère privée ou à l’imaginaire. Typiquement, ce que je critique dans mon livre c’était cette séquence d’On n’est pas couché [émission de France 2 animée par Laurent Ruquier]. En 15 minutes, personne ne demande à cette femme [l’actrice principale, Soria Zeroual, était femme de ménage, comme le personnage qu’elle incarnait] de parler de ce qu’elle a vécu. En revanche, Yann Moix lui demande : « Est-ce qu’à cause de votre religion vous vous êtes dit que c’était mal de passer à l’écran ? ». C’est affligeant…
Cette question du voile n’est pas évoquée dans ton livre…
Je les ai toujours vu faire le ramadan, la prière… Je ne sais pas si dans les rapports individuels avec leurs employeurs, il y a de l’islamophobie. En tout cas elles n’en ont pas parlé spontanément dans les entretiens. La question du racisme au sens individuel, je ne l’ai pas tellement abordée. La politologue Caroline Ibos, dans Qui gardera nos enfants ? raconte comment lors des entretiens d’embauches, il y a une série de préjugés racistes qui apparaissent, selon la provenance géographique.