Le Cello, Paris 17e – Margaux se souvient avec précision de sa première fois. C’était un jour de janvier, l’année de ses 15 ans. Elle avait décidé de sauter le pas avec celui qu’elle aimait depuis des années. Au moment de la pénétration, le plaisir cède immédiatement la place à une douleur insoutenable. Un coup de poignard dans l’entrejambe. « Mon copain s’est alors interrompu et cela a jeté un froid », rembobine la grande blonde un peu speed. A l’évocation de ce souvenir, 15 ans après, un frisson la parcourt. « J’ai perdu du sang pendant près d’une semaine et je me suis un peu inquiétée. » Mais toutes les femmes de sa famille parlent d’une seule voix :
« C’est normal d’avoir mal la première fois. »
L’adolescente avait alors cru son entourage féminin, sans se poser de question. Pourtant, selon Sophie Berville, gynécologue spécialisée dans la vulvodynie, l’inconfort vulvaire chronique :
« Toutes les premières fois ne sont pas douloureuses. »
Mais surtout, après sa première fois douloureuse, Margaux a continué à enchaîner les galères :
« Je me suis mise en couple avec Pierre quand j’avais seize ans et au bout de quelques mois, j’ai eu des mycoses qui revenaient sans cesse. La pénétration me faisait mal, je me sentais coupable et je n’avais plus de désir. »

Selon la dermatologue Clarence De Belilovsky, environ 10% des femmes souffrent de douleurs pendant la pénétration. / Crédits : Aurélie Garnier
Un sujet tabou
Comme Margaux, Marie, Cécile, Virginie, Sophie, Lola et Caroline (1) souffrent de dyspareunie, terme médical désignant la douleur au moment de la pénétration. Elles ont accepté de nous parler de cette souffrance tue et dissimulée, largement méconnue du grand public. Ces maux accompagnent la plupart de ces femmes depuis les prémices de leur vie sexuelle. Selon la dermatologue Clarence De Belilovsky, environ 10% des femmes en souffrent. Mais ces pathologies taboues sont souvent mal diagnostiquées par les praticiens. Certaines ont aujourd’hui réussi à en guérir ou à l’apprivoiser, d’autres au contraire ont capitulé.
Pour Marie, ancienne mannequin aujourd’hui à la tête d’un restaurant à Paris, le problème n’est pas apparu dès sa première fois. « Avec mes premiers copains, je n’avais pas mal », son regard quitte un instant le mien. « C’est quand je me suis mise avec Mathieu que les symptômes sont apparus : je me contractais beaucoup et il ne pouvait que très difficilement me pénétrer. » La brindille aux yeux pétillants marque une courte pause :
« Du coup, je n’avais plus jamais envie de lui. »
Virginie a vécu les mêmes débuts :
« Ma vie sexuelle a débuté quand j’avais 19 ans. Ce n’est que deux ans après que du jour au lendemain j’ai commencé à avoir mal. Comme à chaque rapport j’appréhendais le retour de la douleur, j’ai fini par ne plus avoir de libido. »
Quand les toubibs sèchent
Pour trouver une solution, ces femmes multiplient les consultations : gynécologue, sexologue, dermato… Une longue errance médicale, qui peut renforcer le traumatisme. Sophie, enseignante de 37 ans, en a fait les frais. Dès le début de notre entretien, elle insiste sur le fait qu’elle a été élevée par une mère très féministe. « Ça m’a permis de ne pas avoir de problème à parler de tout ça et de savoir comment je suis faite », sourit-elle. Cette éducation ne l’empêche pourtant pas de se sentir, encore aujourd’hui, bien seule face à sa souffrance. Dès l’apparition des premières douleurs, elle décide de consulter :
« J’avais mycose sur mycose, on les traitait mais elles revenaient sans arrêt et on ne trouvait pas la cause. Alors on me faisait tout le temps changer de pilule. »
Des traitements à répétition qui lui donnent le sentiment d’être un cobaye. « J’ai toujours eu l’impression que pour les médecins, ces douleurs ne relevaient pas de la pathologie mais de l’inconfort », regrette-elle. Elle ajoute :
« Souvent, s’ils ne trouvaient aucune rougeur, ils s’agissaient forcément pour eux d’un blocage psychologique. On m’a déjà dit que je ne devais simplement pas aimer suffisamment mon mari. »
Ces premiers diagnostics, parfois hasardeux, sont souvent culpabilisants.
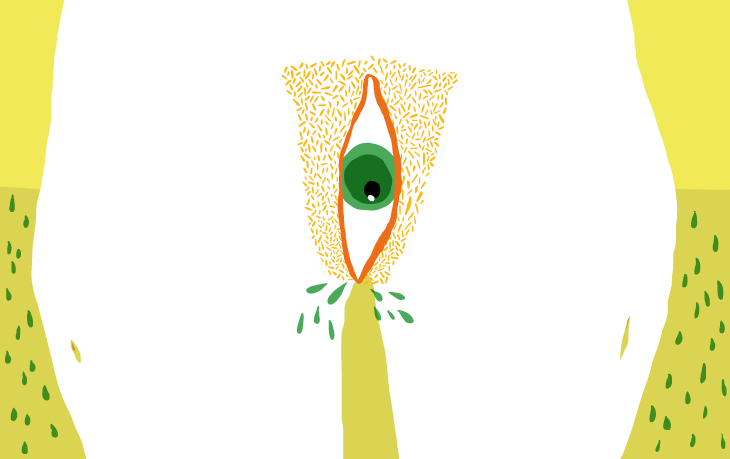
Pauser un diagnostique est très compliqué. / Crédits : Aurélie Garnier
Laetitia est originaire d’Auvergne. L’employée d’un tribunal de la région parisienne, aujourd’hui âgée de 29 ans, reste profondément marquée par sa première visite médicale. Des trémolos dans la voix, elle raconte :
« Lorsque le docteur m’a dit qu’il n’y avait rien, je me suis mise à pleurer. Je suis d’une nature très complexée et stressée et en sortant de chez le médecin, ça a été très dur de me sentir incomprise. »
Même si elle est en voie de guérison, son émotion reste intacte :
« Aujourd’hui encore, j’envie les femmes qui parviennent à avoir une vie sexuelle plus normale et il m’arrive de regretter de ne pas être un homme. »
Ce sentiment de « trahison de son propre corps », comme l’a qualifié Sophie, est récurrent. L’enseignante, malgré de nombreux traitements, pour certains très lourds, est toujours dans l’impasse :
« J’ai même subi une nymphoplastie, c’est-à-dire une réduction des petites lèvres, parce que certains médecins pensaient que ça pourrait m’aider. Mais rien n’y fait et même si j’ai encore du désir, je me sens parfois comme de la marchandise endommagée. »
Ces douleurs ont contribué à faire voler son couple en éclats :
« Mon mari est allé voir ailleurs et derrière, au lieu de la mettre en sourdine, il me rappelait à l’envi que cette femme était une vraie femme. »
La réponse
Face à l’incompréhension d’une partie du corps médical, certaines femmes cherchent des réponses sur la toile. « J’en avais assez de souffrir depuis plus d’une dizaine d’années alors je suis allée chercher des solutions sur des forums », témoigne Margaux. « Et c’est comme ça que je l’ai trouvée. » En septembre dernier, la trentenaire prend rendez-vous avec une dermatologue de la capitale :
« Même si je n’avais aucune rougeur, elle a pris le temps de m’ausculter, de m’écouter et m’a conseillée de faire un traitement en trois étapes associant traitement de fond par voie orale, kinésithérapie et consultation en sexologie. »
Le traitement dit des « 3 M » théorisé notamment par Heidi Beroud-Poyet et Laura Beltran, psychologues cliniciennes et sexologues, dans leur ouvrage Les femmes et leur sexe, ne plus avoir mal, renouer avec son désir, se sentir libre, (Ed. Payot, 2017). Une réponse qui n’a rien d’universelle. En effet, derrière la dyspareunie peut se cacher différentes pathologies bien réelles aux origines variées. L’endométriose par exemple, qui correspond au développement de muqueuse hors de la cavité utérine. Ou le vaginisme, une contraction involontaire des muscles du vagin. Ces douleurs au moment de la pénétration peuvent aussi être la conséquence d’une pilule inadaptée, les effets secondaires d’un médicament (certains antibiotiques notamment). La liste est longue et certains professionnels de santé ont du mal à poser un diagnostic, privilégiant – parfois à tort – l’explication psychologique.
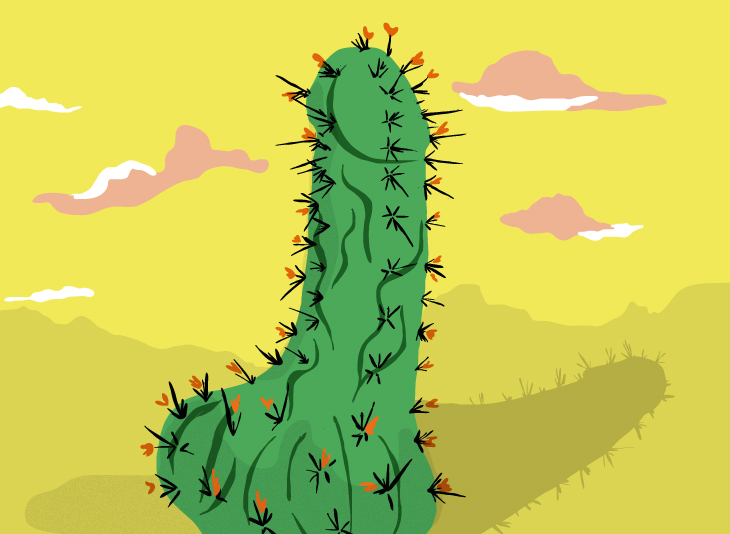
Un diagnostic et des traitements possibles. / Crédits : Aurélie Garnier
« Après des années à accumuler les rendez-vous et traitements en tout genre, j’étais sur le point de baisser les bras », raconte Virgine, originaire du Calvados. Finalement, en 2017, elle dégote un spécialiste à Nantes :
« J’ai été reçue par une équipe pluridisciplinaire qui m’a diagnostiqué une vulvodynie provoquée et ça a été un soulagement de mettre enfin des mots sur ce que j’avais ».
Le spécialiste lui prescrit des séances de kinésithérapie :
« En fait, c’est comme la rééducation du périnée après un accouchement mais dans l’autre sens. Comme j’ai toujours fait beaucoup de sport, dont du vélo et de la gym, j’ai le muscle du périnée très contracté et même porter certains vêtements a pu être douloureux. Pour atténuer les douleurs, j’ai aussi appliqué des crèmes. »
Vivre avec
Certaines de celles qui n’ont pu poser de diagnostic ou trouver un traitement, tentent de vivre avec. Après un début de vie sexuelle sans encombres, Lola 30 ans, a connu ses premières douleurs avec celui qui est aujourd’hui son mari. Pour que leur couple ne pâtisse pas de la situation, ils ont trouvé des solutions ensemble :
bq. « On ne s’autorise qu’une seule position, on met beaucoup de lubrifiant et dans la mesure du possible, on fait l’amour le soir pour que je puisse cicatriser pendant la nuit. »
Une solution qui peut paraître radicale, mais toujours moins, de son point de vue, que de renoncer à une vie sexuelle. Aujourd’hui, elle prend cette situation avec beaucoup de philosophie :
« Un problème en devient un à partir du moment où l’on étiquette comme ça. »
La gynécologue, Sophie Berville se veut rassurante et prône une autre solution pour celles qui n’ont pas trouvé de solution médicale :
« Rien ne sert d’avoir une vision trop centrée sur la pénétration, il n’y a pas que le vagin dans la vie. Et puis l’important c’est de passer un bon moment. »
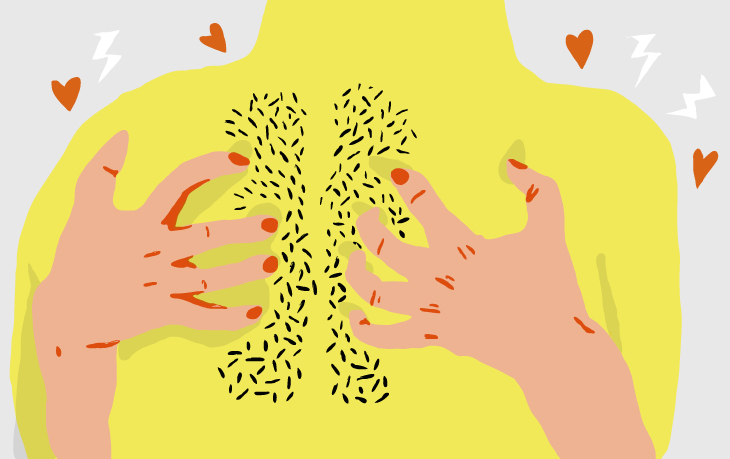
Pouvoir encore faire l'amour... / Crédits : Aurélie Garnier
(1) Les prénoms ont été modifiés à leur demande.
NE MANQUEZ RIEN DE STREETPRESS,
ABONNEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER

