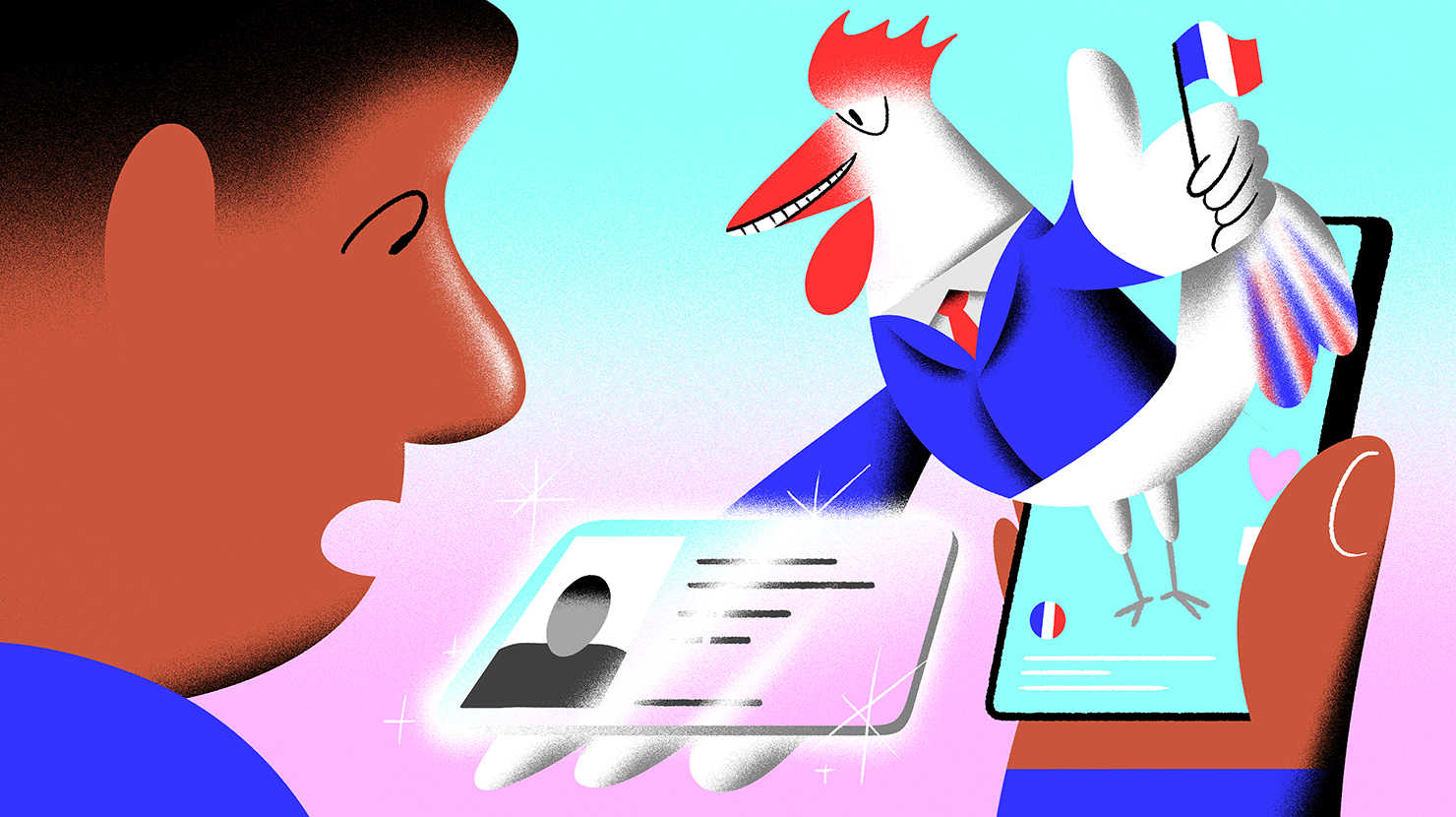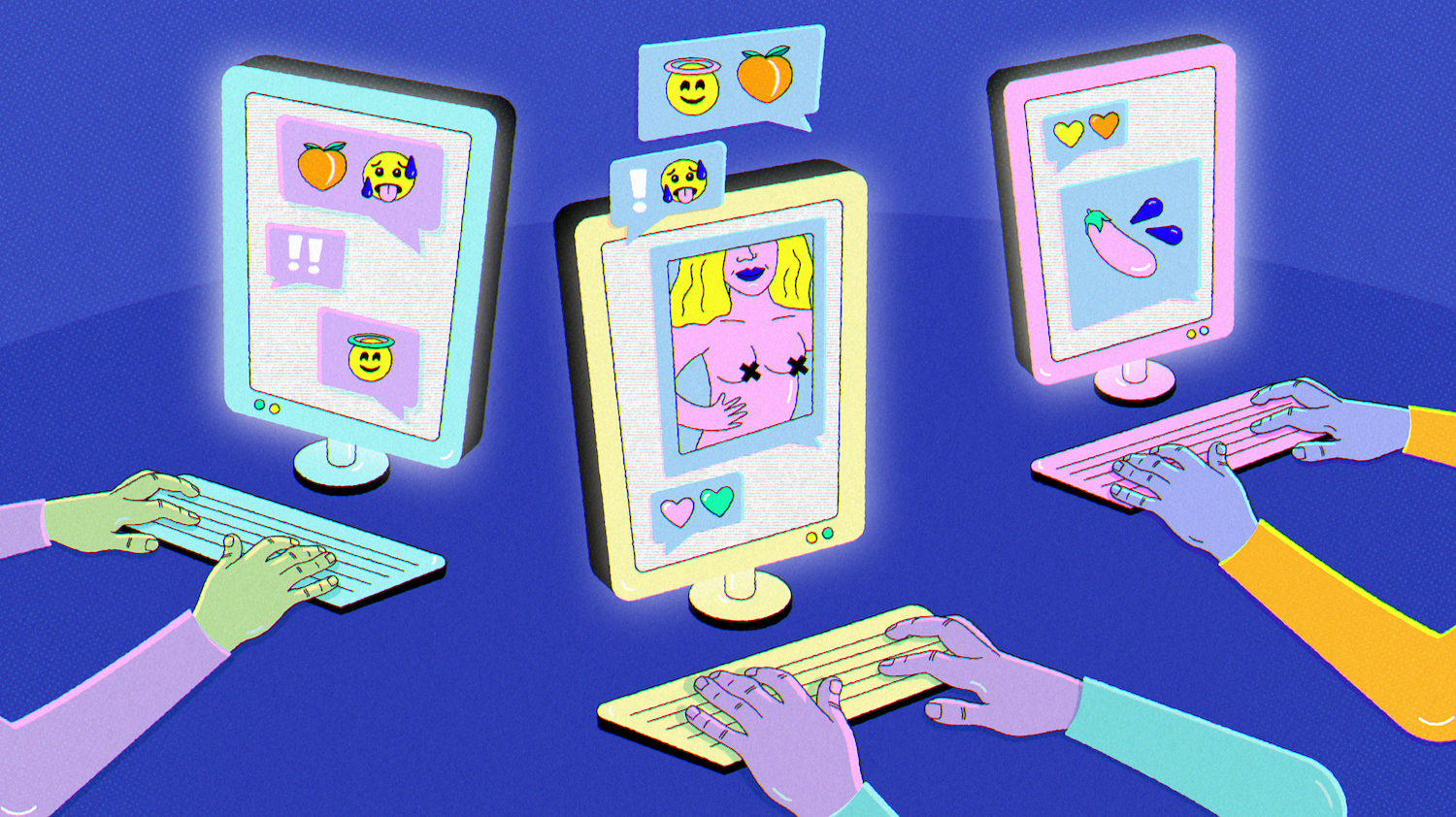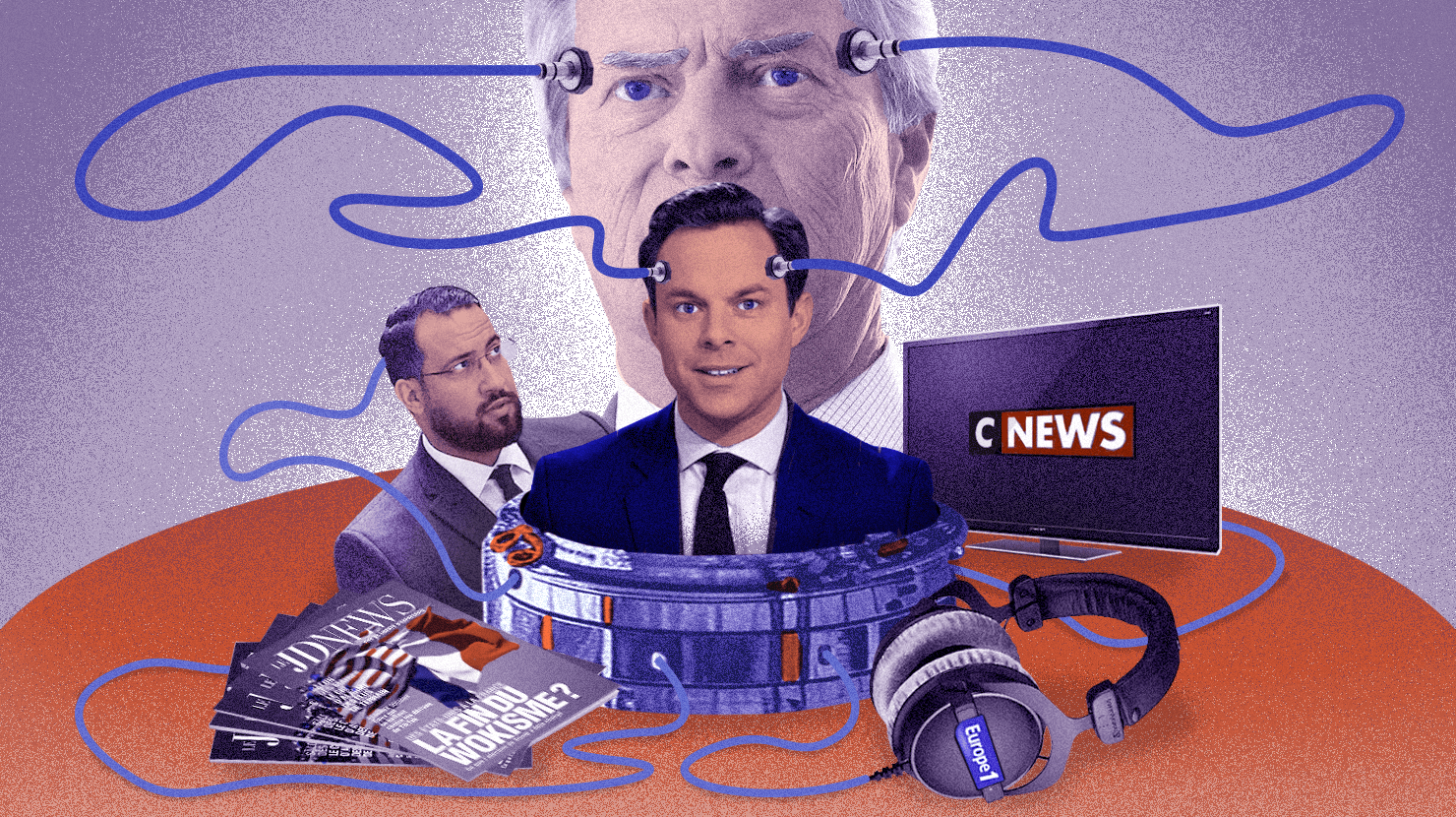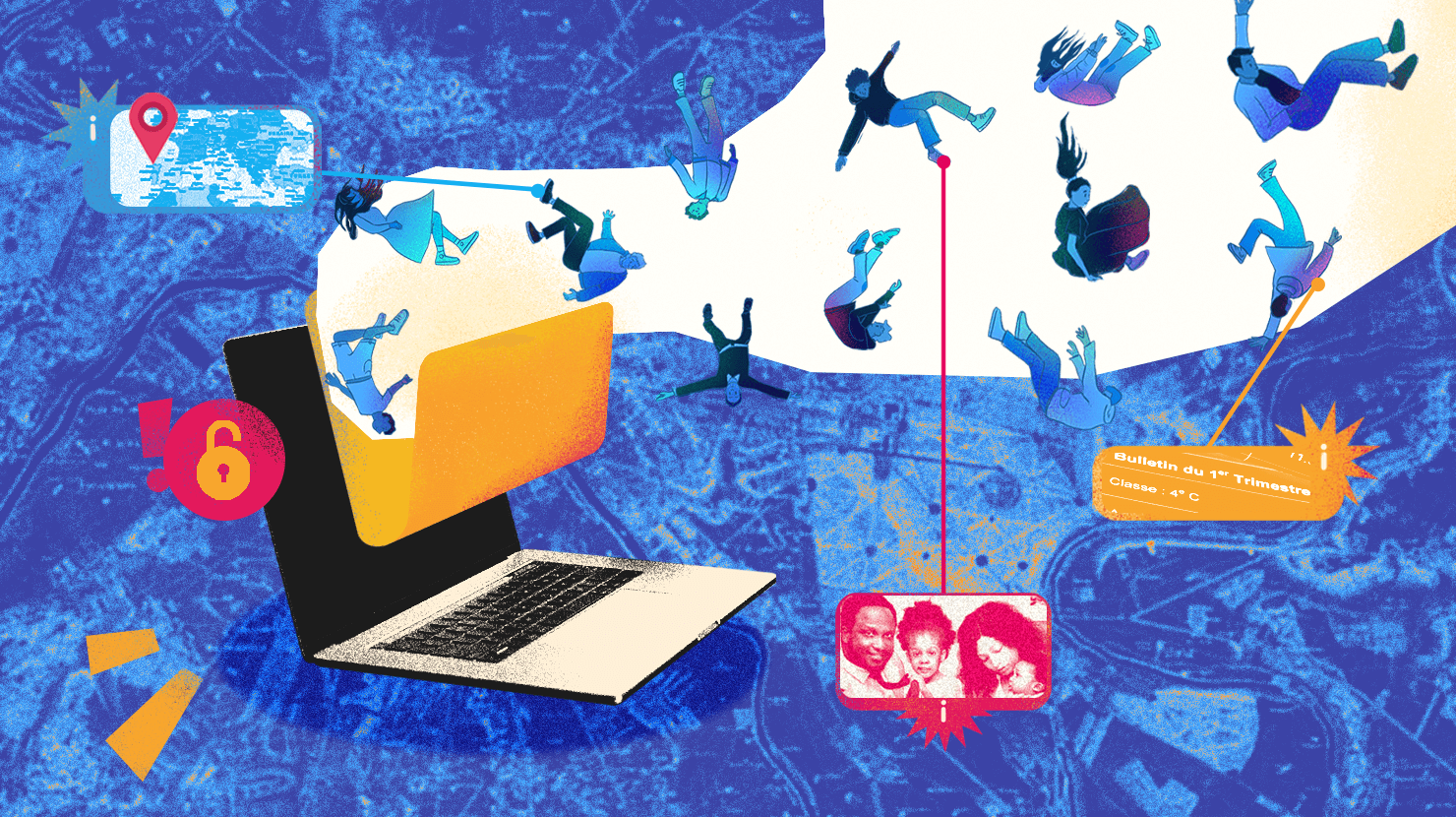J’ai fait un premier test de grossesse. Négatif. Pourtant j’avais un pressentiment, une intuition. J’en ai fait un deuxième la semaine suivante : positif. J’étais enceinte, il fallait que j’avorte. C’était en juillet dernier. Lorsque je l’ai appris, j’étais choquée et triste. J’ai eu honte de moi parce que c’était pleinement de ma faute. Je ne me protégeais pas. J’avais tout simplement joué avec le feu.
Il fallait que je me débrouille seule
Je suis allé voir mon médecin généraliste. C’est mon médecin de famille, il me suit depuis que je suis petite, et il me connait très bien. J’ai eu la sensation de l’avoir déçu. Il m’a clairement fait comprendre qu’il ne voulait pas me suivre pendant cette histoire, qu’il fallait que je me débrouille seule. C’est un mec de province, d’un certain âge. C’est pas tous les jours qu’il doit voir des jeunes filles enceintes passer dans son cabinet. Il m’a simplement dirigée vers le planning familial de ma ville.
Une semaine plus tard environ, j’avais rendez-vous pour la première consultation. Là-bas, c’était très différent. Les femmes ont été extras avec moi. Elles étaient adorables. J’ai eu beaucoup de rendez-vous, peut-être six ou sept, parce que j’en avais besoin. Là, je me sentais prise en charge. C’était vraiment très bien encadré : ce planning est réputé pour être l’un des meilleurs de France. Il y a des médecins, des infirmières, des psychologues, tout ce qu’il faut. Il y a également un suivi psychologique assuré gratuitement pendant des années après, si besoin. Moi je n’ai pas vu de psy. On me l’a proposé, mais je n’en ai pas ressenti le besoin. Les consultations médicales me suffisaient.
J’ai aimé la sensation, même si je connaissais l’issue que ça allait avoir
Entre le jour où je l’ai su et le jour de l’avortement, il s’est passé environ trois semaines. J’ai avorté à un mois de grossesse. J’avais beaucoup de nausées. Ma mère m’a dit :
« De toutes mes grossesses j’ai jamais eu autant de nausées que toi. »
J’ai passé trois semaines dans ma chambre, je ne pouvais rien avaler, puisque je vomissais tout, je ne pouvais pas sentir une odeur, rien. J’ai perdu beaucoup de poids, mais mon ventre était différent. Je le touchais, il était dur. C’était un sentiment étrange. C’est bizarre à dire mais j’ai aimé la sensation, même si je connaissais l’issue que ça allait avoir.

« Ce n’est que quelques jours après l’opération que j’ai réellement pris conscience que je n’avais plus rien dans le ventre. »
Victoria, 22 ans.
J’ai choisi de me faire opérer à l’hôpital, par aspiration, sous anesthésie générale. Il y avait l’option « facile », par voie médicamenteuse. Celle-ci revient à provoquer une sorte de fausse couche et dans ce cas, il n’y a pas d’hospitalisation. Ça me paraissait trop douloureux, je ne voulais pas vivre ça seule chez moi.
Quand je suis rentrée après l’opération, j’étais crevée, je n’ai pas réalisé tout de suite. Ce n’est que quelques jours plus tard que j’ai réellement pris conscience que je n’avais plus rien dans le ventre. J’avais changé quelque chose, j’avais fait un choix. J’ai eu un manque les premiers jours. Lorsque je voyais une femme enceinte ou un bébé, ça me faisait quelque chose. Je suis allé à l’église. Aujourd’hui, tout va bien.
J’ai fait ce qu’il fallait faire, c’est une évidence
J’étais étudiante, j’avais 22 ans, c’était les premiers mois avec mon copain. J’ai fait ce qu’il fallait faire, c’est une évidence. Bien sûr je me suis posée des questions, c’est normal : qu’est-ce qu’il se serait passé si je ne l’avais pas fait ? Comment je vivrais mes futures grossesses ? Je n’ai pas les réponses. C’est un geste qui marque une vie, on ne peut pas l’oublier, c’est impossible. Mais je sais que j’ai pris la bonne décision, je l’ai toujours su. Je sais aussi que j’aurais des enfants plus tard. Au bon moment.
Le jour de l’opération, j’ai rencontré une jeune fille qui était dans le même cas que moi. Je m’en souviendrais toujours. Je partageais ma chambre double avec elle. Elle devait avoir au plus 16 ans. Il y avait ses copines avec elle et j’ai compris son histoire. Ses parents n’étaient pas au courant, elle leur avait dit qu’elle allait en cours ce jour là. Elle avait l’air plutôt bien. Pas triste ni traumatisée. Elle avait surtout l’air très jeune, encore enfantine et pas vraiment consciente de ce qu’elle était en train de vivre.
Le droit à l’avortement est une liberté qui ne peut pas disparaître
Oui, psychologiquement, c’est dur d’avorter. Mais il faut penser à l’avenir. Pour moi, si tu n’as pas les conditions nécessaires pour élever un enfant, ne le fais pas. Ça n’est plus seulement ta vie que tu risques de gâcher.
Je ne pouvais pas éduquer un enfant aujourd’hui, je suis encore entrain de m’éduquer moi même. N’importe quelle mère dira que la première grossesse, c’est toujours la galère. Alors décider de donner naissance alors sans être correctement installée dans la vie, je n’ose même pas imaginer.
Le droit à l’avortement est une liberté qui ne peut pas disparaître. Aucune femme ne dira que c’est facile à vivre. Mais c’est un droit fondamental.
Crédit photos : Denis Bocquet/Flickr
 Soutenez
Soutenez