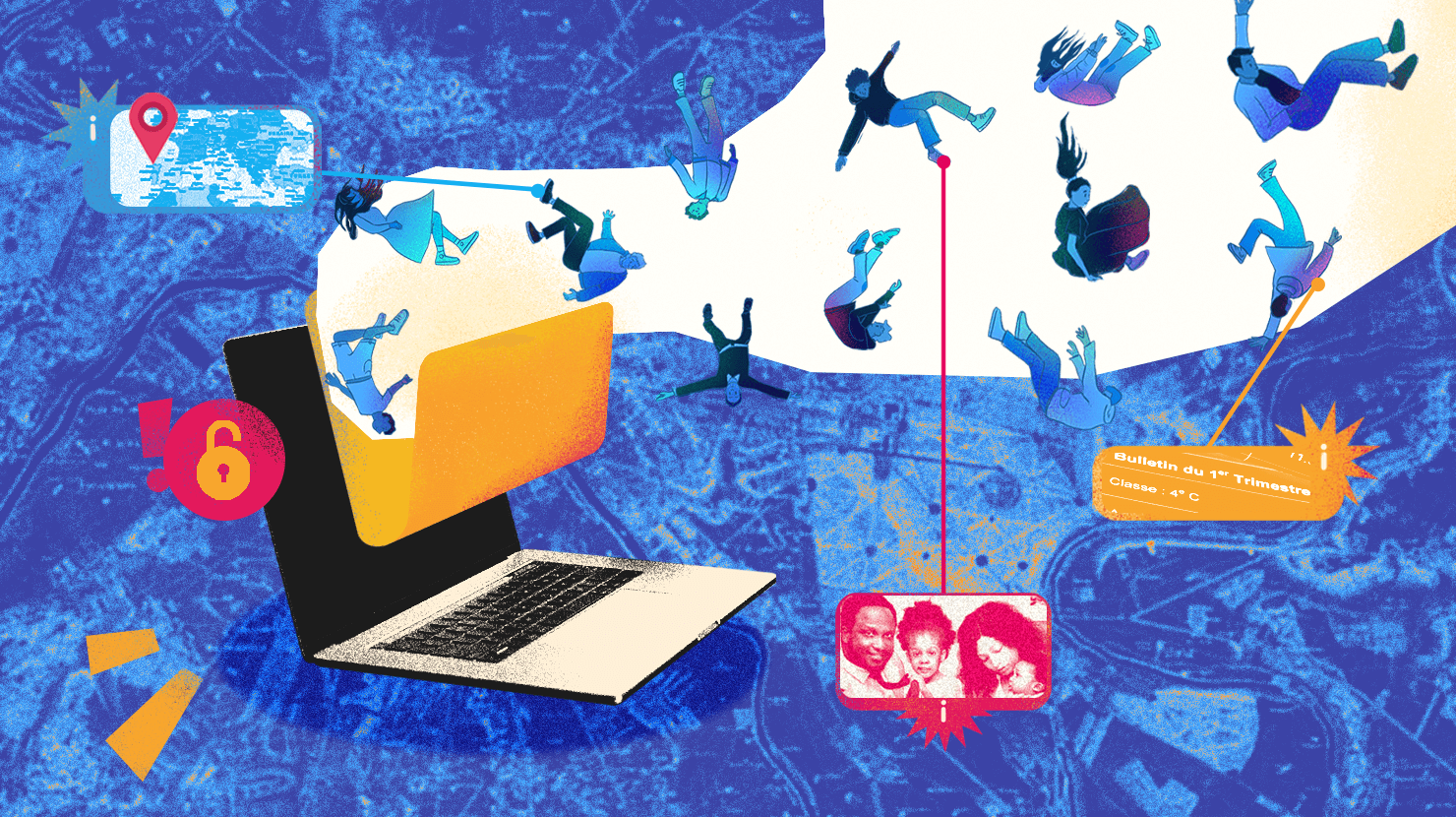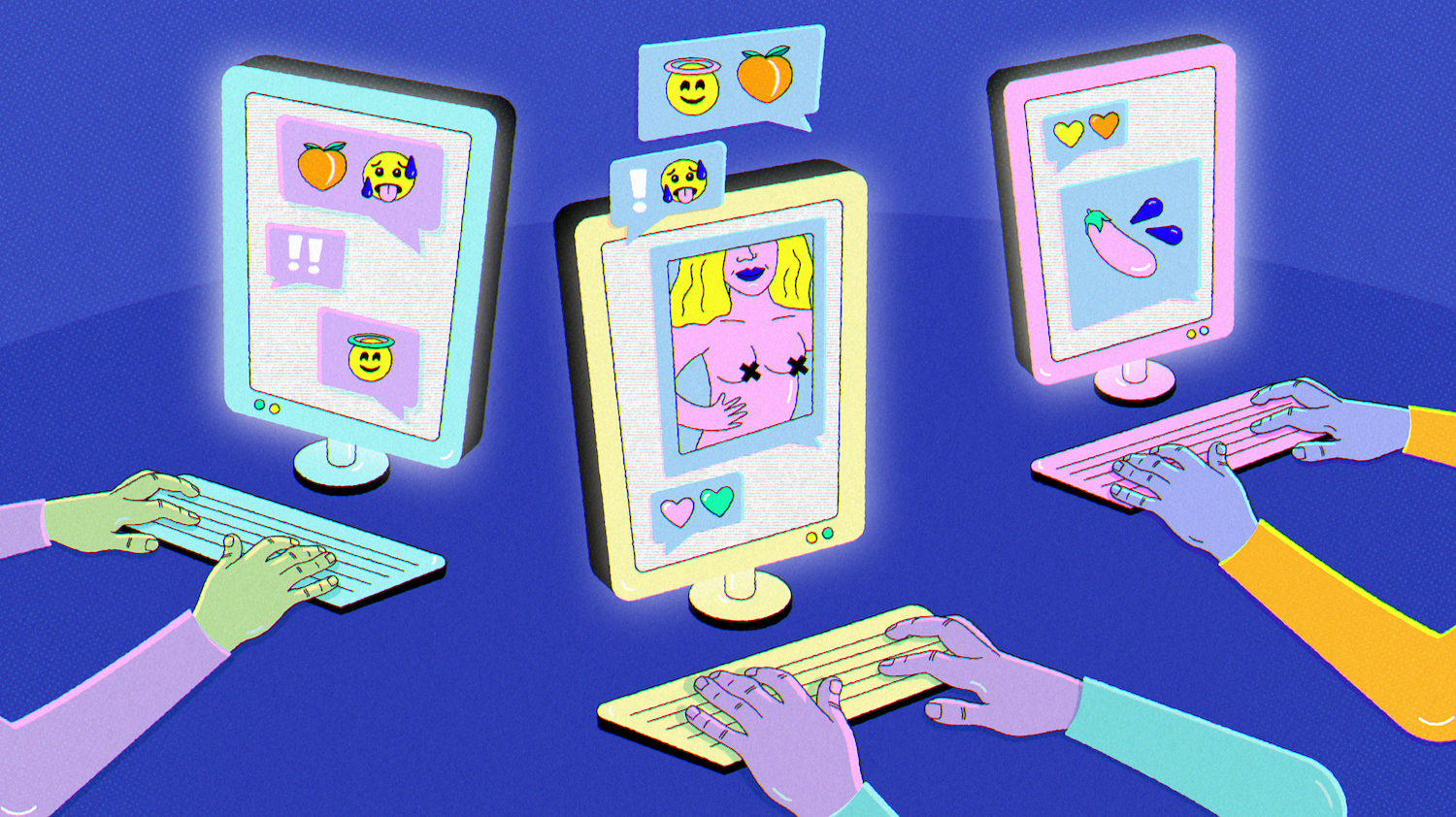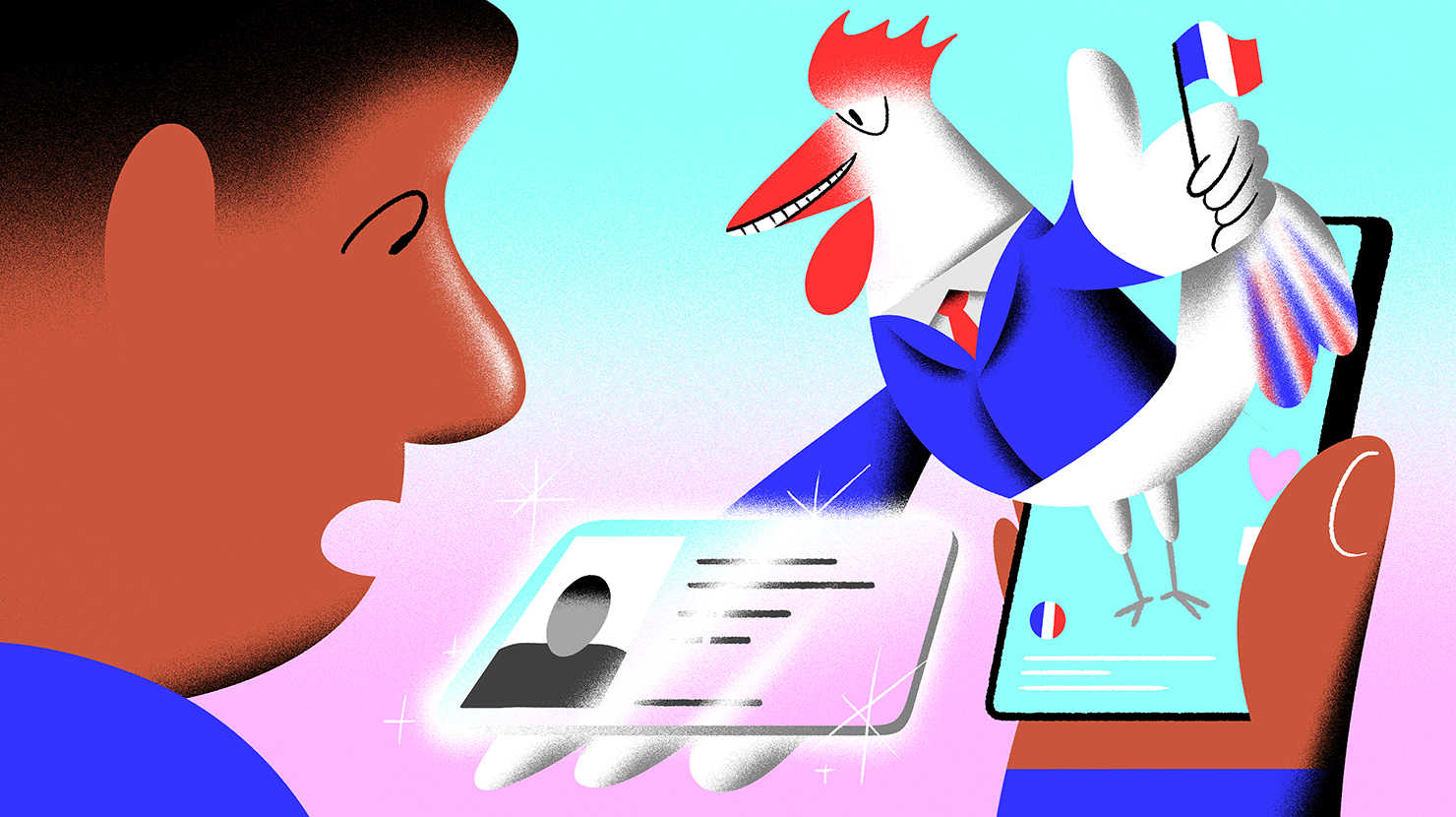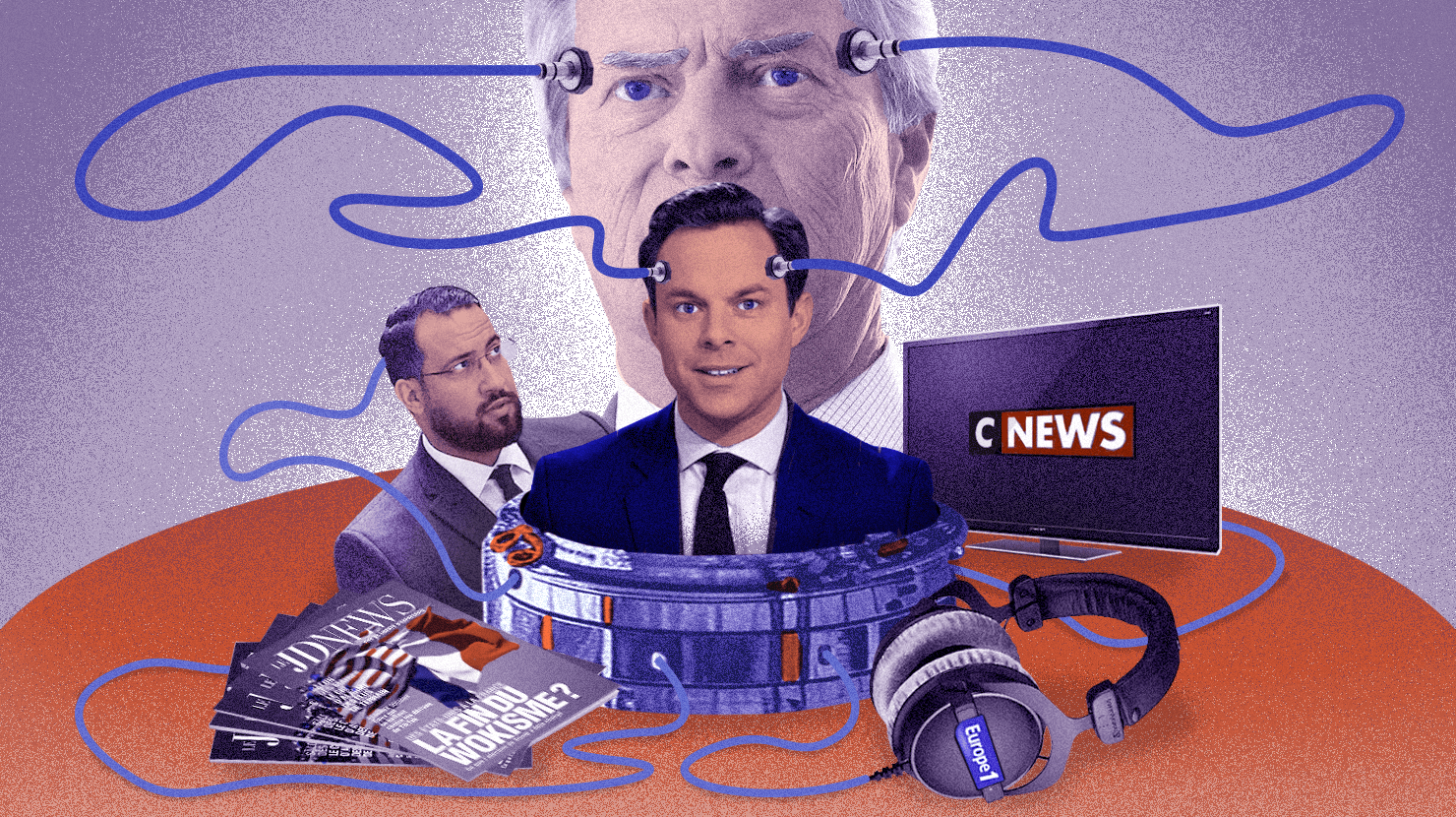« Ma grand-mère en scred’ nous mettait du porc dans nos assiettes », commence Mélissa. « Quand j’ai été assez grande pour lui faire remarquer, elle me mentait en prétendant que ce n’était pas du porc. » La trentenaire de confession musulmane a grandi dans un HLM de Trappes (78) avec sa mère, Somalienne, et ses deux petits frères. Un week-end sur deux, elle est chez son père, qui l’emmène régulièrement chez ses grands-parents en Bretagne. « J’ai coupé les ponts avec eux il y a six ans. Je n’ai pas été à l’enterrement de mon grand-père, c’est pour dire… » Un jour, sa grand-mère lui souffle à l’oreille :
« C’est dommage que ton père se soit marié à une noire musulmane et pas à une Chinoise bosseuse par exemple. »
Quand Mélissa tente de se défendre, on lui rétorque qu’elle est « comme sa mère » : une « sauvage ».
Sofia, Lina (1), Tristan (1) ou Alicia (1) livrent des anecdotes similaires. Tous sont jeunes, racisés et descendants d’immigrés de première ou de seconde génération par un parent. L’autre n’est pas racisé. Ce racisme, qui intervient au cœur du foyer, peut être qualifié « d’intrafamilial » – un terme surtout employé quand il s’agit d’enfants métis. Il est difficilement mesurable. Selon le dernier baromètre du Cran, le Conseil représentatif des associations noires, 10% des discriminations liées à la couleur de peau sont vécues au sein-même de la famille. Pourtant, il marque au fer rouge les identités de chacun et chacune.
Racisme ordinaire
Dans la famille de Sofia, 35 ans, la discrimination passe par des petits commentaires. Une sorte de racisme ordinaire ambiant qui n’est pas toujours identifiable. Un jour, comme souvent, sa mère reçoit des amies à la maison pour le café. Enfant, elle entend ces femmes se moquer de sa grand-mère paternelle qui ne sait ni lire, ni écrire. La famille vient d’Algérie, elle a quitté le pays après la guerre. Sa mère, qui n’est pas racisée, rigole parfois avec ces femmes. « Elle-même ne disait rien de raciste, mais elle ne démentait pas non plus », retrace Sofia. Des années plus tard, elle devient linguiste et rencontre son futur mari, avant de tomber enceinte. Ravie, elle annonce à sa famille qu’elle envisage d’appeler son fils Selim, qui signifie « paix » en arabe. « C’est un prénom de racaille », lui balance son beau-père français. Sa mère ne réagit pas. Encore une fois. Sofia conclut :
« Ce sont plein de petites choses dont on ne se rend pas compte sur le coup. »
Alicia, 25 ans, est Française de son père et Mexicaine de sa mère. Lors d’un voyage au Mexique avec sa famille, son père multiplie les poncifs mexicophobes. « Quand on se promenait dans la rue, il se sentait menacé. Il me disait : “Comme je suis blanc, on va s’en prendre à moi”. » Il critique la culture locale, y compris les traditions qui concernent sa belle-famille. Alicia sent un mal-être monter en elle :
« Mais à cet âge-là, je ne comprenais pas tout à fait ce qui me touchait. »
« C’est toujours sur le ton de l’humour », commence Tristan, 25 ans. « Mais mis bout à bout, ce n’est qu’une répétition de clichés racistes. » Sa mère est fille de Vietnamiens. Elle est née en France après que ses parents ont fui la guerre d’indépendance. Elle rencontre son père à Grenoble en discothèque, dans les années 90. Au quotidien, Tristan entend son père l’appeler « Niakoué » – une insulte asiophobe dérivée du vietnamien, qui veut dire de manière péjorative « paysan » ou « péquenaud ». Lui et sa fratrie sont « les jaunes ». « C’est sans arrêt », raconte-t-il. Des propos qui n’ont jamais été remis en question par sa mère, pourtant concernée par ces surnoms racistes. Aujourd’hui, le jeune cadre s’en indigne :
« L’oncle raciste de la famille, c’est mon père ! »
À LIRE AUSSI : La communauté asiatique en a marre de fermer sa gueule
Injures frontales
Chez la mamie de Mélissa, en Bretagne, les veillées de Noël finissent « toujours en larmes ». Comme ce soir de réveillon où entre deux plats, la grand-mère de Mélissa tient des propos racistes devant ses amis du village. Une après-midi, sa grand-mère l’entend bavarder en somalien avec son frère. Jusqu’à six ans, Mélissa le parle et le comprend parfaitement. La mamie lui ordonne de ne pas employer cette langue dans sa maison. Elle s’énerve si fort que Mélissa n’ose plus utiliser un mot de somalien pendant un an. Aujourd’hui, elle le comprend mais ne le parle pas parfaitement.
Lina, une jeune Lyonnaise franco-algérienne de 25 ans, n’a rencontré sa grand-mère qu’à ses 4 ans. « Elle avait dit à mon père, son fils : “Jamais je ne l’accepterais ton gosse avec son sang de bougnoule”. » Une autre situation particulièrement violente marque sa mémoire d’enfant : lors d’une visite, alors que la grand-mère lui coiffe ses cheveux – « qu’elle adorait car ils sont lisses, hérités de [s]on père », elle lui chuchote dans l’oreille à demi-mot pour que son père ne puisse pas entendre :
« Sale Arabe, sale bougnoule, c’est la faute de ta mère si tu es une Arabe. »
Quand elle parle de ses amis maghrébins, de la culture de sa mère ou de ses autres grands-parents algériens dont elle est particulièrement proche, on la fait taire. « Ça m’a influencée dans la construction de mon identité, ça m’a retranchée dans ma culture algérienne où personne ne me faisait chier », affirme, texto, la Lyonnaise. Dans les souvenirs de Lina, les tranches de vie avec sa grand-mère les plus anodines sont teintées de racisme. Devant le journal télévisé, elle ne cache pas sa haine des Maghrébins et se permet des commentaires sur l’immigration sous le nez de sa petite-fille. C’est la même situation chez Mélissa, la franco-somalienne :
« Devant la TV, ma grand-mère qui assume voter RN, commente qu’il y a trop de Noirs ou d’Arabes en France, que la banlieue et les HLM sont dangereux. Alors que je suis métisse et que j’habitais à Trappes, dans un HLM. »
Enfants non protégés
Au téléphone, Mélissa est émue quand elle raconte l’absence de réaction de son père. « Il n’est pas raciste, lui n’a jamais eu un mot de travers mais il ne nous a jamais défendus. Il était lâche et avait peur de sa mère », raconte-t-elle transie de larmes. « Je l’ai toujours en travers de la gorge. » Elle se reconstruit avec son compagnon, qui a vécu le même racisme, et la religion :
« Ça fait partie de mes traumatismes et ça m’a pris beaucoup de temps de travailler dessus. »
Chez Lina, l’Algérienne, c’est similaire : son père n’a jamais réagi pour la protéger de sa grand-mère. Elle a depuis coupé les ponts avec elle. « Mon père est lui-même raciste. Quelques fois, il a fait des commentaires sur l’immigration des Maghrébins en France devant moi. »
Tristan, le cadre aux origines vietnamiennes, a abordé plusieurs fois le sujet des surnoms racistes avec son père. Ses blagues ne sont pas drôles et elles sont discriminatoires, lui explique-t-il. Sans succès. « Il nous aime, mais il ne peut pas comprendre : il n’a jamais connu le racisme et ne le connaîtra jamais. » Il conclut :
« Nous sommes décolonisés, mais mon père adopte les codes de l’oppresseur. »
Intériorisation
En parallèle, à l’école, Tristan a longtemps subi les moqueries asiophobes de ses camarades, du même registre que celles de son père : « petite bite » ; « tu manges du chien » ; « le jaune ! ». Impossible pour l’enfant de déceler les insultes :
« Je me surprenais à reprendre les mêmes blagues anti-asiat’. J’avais totalement intériorisé le racisme. »
Ce n’est qu’en classe de 4ème, lors de l’intervention d’une association anti-discriminations, qu’il réalise qu’il est victime de racisme autant à l’école qu’à la maison. « C’est compliqué quand ton propre père tient ces propos. Je ne me sentais pas en sécurité chez moi. »
Chez Alicia, la franco-mexicaine, son père supporte de moins en moins la culture de sa femme. Un jour, au supermarché, Alicia « pète un plomb ». « Je ne sais pas d’où ça me vient, mais ma mère me parle espagnol et là, je me mets à lui hurler dessus : “On est en France ! On parle français ici !” ». À partir de ce jour, elle se met à cacher ses origines et sa double culture. Ça l’« aiderait à [s]’intégrer à la culture de [s]on village », se dit-elle. À cette époque, Alicia se surprend à espérer que son frère devienne blond, « comme le garçon de la pub Kinder ».
Héritage culturel
« On m’a confisqué une partie de ma culture en me privant du dialecte algérien », s’insurge de son côté Sofia, la trentenaire franco-algérienne. Elle regrette de ne pas avoir entendu plus d’arabe à la maison, ou même que ses parents ne lui aient pas enseigné. À l’adolescence, la jeune femme tente de renouer avec ses racines. Elle apprend l’arabe et fait le ramadan :
« Ma mère s’imaginait que je me radicalisais. En ont découlé différentes crises qui m’ont poussée à faire les choses en cachette. »
Le déclic est arrivé lors d’une conversation dans la voiture familiale. Son père parle arabe avec sa nouvelle compagne d’origine algérienne – ses deux parents sont divorcés depuis plusieurs années. Curieuse, Sofia demande une traduction. La réaction de son père est expéditive :
« Laisse tomber, ça ne te concerne pas, c’est un truc d’Algérien. »
Un coup de massue qui entraîne Sofia dans des questionnements identitaires. Est-elle vraiment Algérienne ? Depuis devenue maman, exilée en Suisse et mariée à un homme d’origine turque, elle s’est promis de « tout faire pour valoriser les cultures » de ses enfants. « Je fais en sorte qu’ils se sentent autant liés à la culture de leur mère, que celle de leur père, qu’à celle de leur pays d’accueil ».
Que ce soit pour Tristan, Mélissa, Lina ou Sofia, tous ont grandi avec des traumatismes liés aux propos racistes de leurs familles. Ils ont été impactés dans leur rapport intime à leur identité. Parmi les personnes rencontrées, personne n’est parvenu à confronter ses parents pour son manque de protection face aux agressions verbales. Le sujet reste tabou. Enfin, deux des personnes qui ont témoigné dans cet article, ont avoué avoir accepté de nous rencontrer pour pouvoir envoyer l’article aux personnes de leurs familles concernées.
(1) Les prénoms ont été changés à la demande des intéressés.
Illustration de Une d’Aurélie Garnier.
 Soutenez
Soutenez