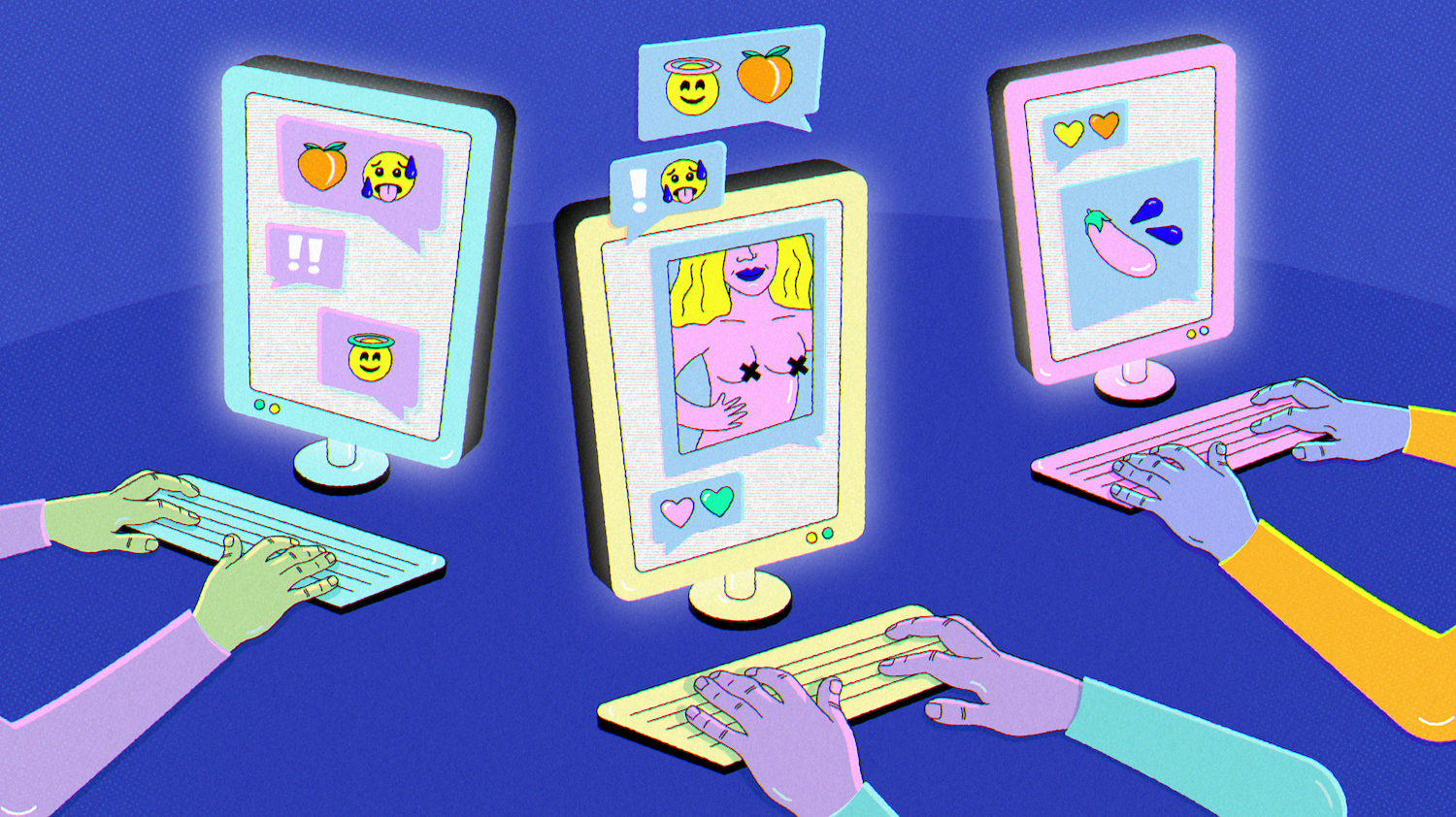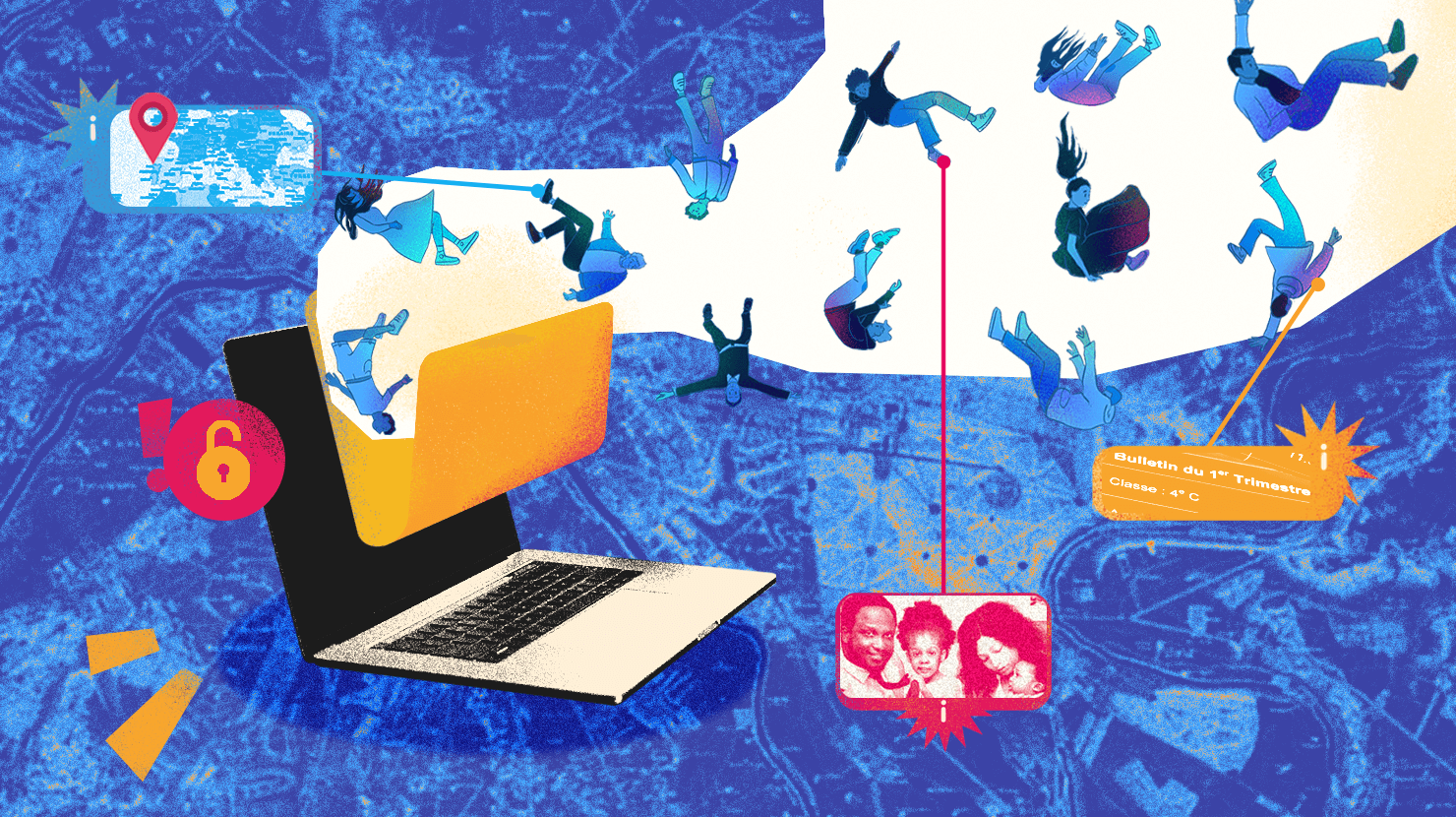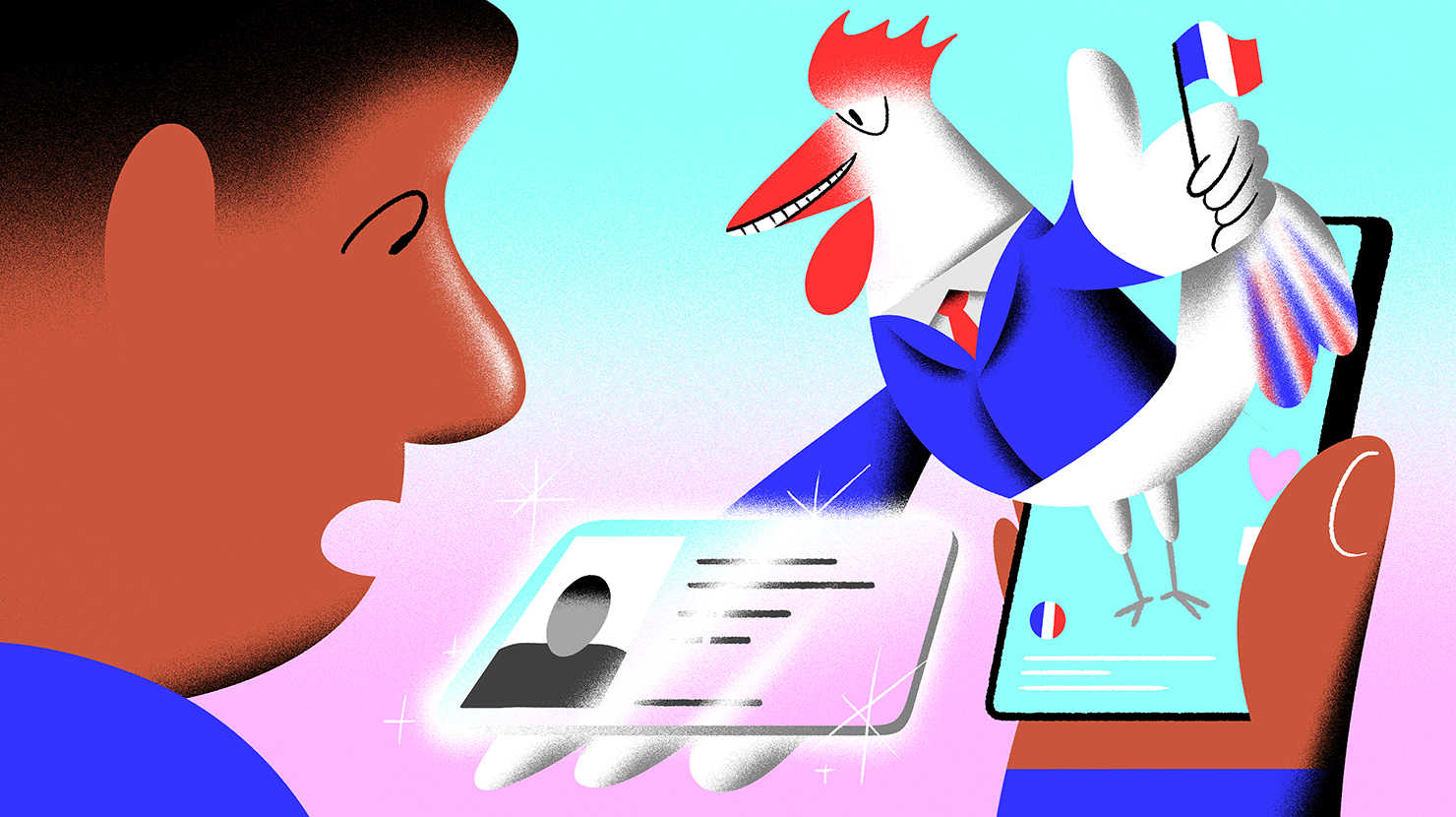Boulevard de Ménilmontant, Paris 20e – « Un Perrier, c’est une très chouette idée », commande le romancier Johann Zarca, pair de lunettes aviateur sur le nez. Le trentenaire a changé. Finies les soirées coke et alcool à traîner dans l’underground parisien pour trouver l’inspiration. Depuis août 2019, il a rompu avec ses addictions. Il s’est rangé. Ses idées sont claires :
« Défoncé, tu te sens surpuissant mais ça te baise le cerveau. Quand tu arrêtes, c’est de la rééducation. Maintenant, c’est trop bien. Ça rend plus rigoureux, plus concentré, plus créatif. »
C’est sobre qu’il a écrit La Nuit des hyènes, un roman cru et sanglant (Ed. Goutte d’Or). Le livre suit une nuit de la vie de Chicha, une prostituée travestie qui a ses habitudes au Bois de Boulogne. Sa dernière nuit.
Les premières pages racontent un début de soirée normal avec ses copines. Les premiers clients, les premiers coups et surtout la défonce et l’alcool. Aux alentours de 1h, elle décide de monter dans la voiture d’un client qui l’emmène à son domicile. Sans le savoir, Chicha vient de tomber dans un piège préparé par trois mecs qui vont lui faire vivre une nuit de calvaire.
Johann Zarca entremêle réel et fiction : Chicha a existé et le romancier l’a rencontrée avant son décès.
Pourquoi Chicha et pas quelqu’un d’autre ?
Comme dit dans le livre, je l’ai rencontré dans un service d’addicto, mais j’ai créé un lien dans un groupe de parole où on allait. J’y vais toujours. Personne ne te connaît mieux qu’un groupe comme ça. Tu lâches ta vulnérabilité, tes failles, tes secrets. Pour créer un lien fort, laisse tomber, c’est monstrueux. Et là, une travailleuse du sexe au bois de Boulogne avec une histoire poignante… Il y a des accointances. Mais sinon j’ai plein de potes dans ces groupes. Après, l’histoire de Chicha est particulière parce que j’apprends un matin via le groupe qu’elle est morte. Forcément, l’histoire te touche de ouf.
À quel point cette histoire est vraie ?
Il y a plein de zones d’ombre, mais la fin du livre est vraie. Le fait que Zyed – le prénom de Chicha dans la vie de tous les jours – se pointe dans le groupe de parole avec la gueule en vrac, un œuf de poule sur la tronche, qu’il raconte ce qui lui est arrivé et qu’il soit mort peu de temps après. Le groupe m’a expliqué qu’une commotion cérébrale serait à l’origine de sa mort. Je n’ai aucune preuve. On m’a dit qu’elle s’est fait embarquer par un mec qu’elle ne sentait pas, puis prise dans un guet-apens. Je ne sais pas combien de gars. J’en ai mis trois. Brûlée à la cigarette, violée, on lui a fait croire qu’elle allait être noyée dans une baignoire. Ils ont fini par la tej là où le mec l’avait récupéré, sur un trottoir du bois de Boulogne. Voilà à peu près ce qui est vrai.
Donc le reste, tu l’inventes ?
Ouais, sinon ça serait une enquête. Ce n’est pas mon but. De toute façon, je suis romancier et pas journaliste. J’ai peu d’éléments donc je brode tout autour. La fiction, c’est 90 pourcents. Même les remerciements à la fin ça mélange le réel et la fiction. Je joue en permanence entre les deux. Prendre une affaire non élucidée avec plein de zones d’ombre. Là, j’ai que ce que le groupe m’a rapporté. Donc, le reste, je le raconte comme je l’imagine.

Le livre suit une nuit de la vie de Chicha, une prostituée travestie qui a ses habitudes au Bois de Boulogne. Sa dernière nuit. / Crédits : Teresa Suarez
La mort, c’est le déclencheur du roman ?
Dans le bouquin, je dis que je voulais faire un portrait d’elle. Ce n’était pas vrai. Ça me donne juste un prétexte. Je trouvais ça marrant d’un point de vue stylistique de m’incruster dans le bouquin avec l’idée de faire un portrait d’elle. Tu suis Chicha et paf, j’apparais. J’aimais bien. Je fais beaucoup ça dans mes livres. Mais, en effet, la mort est le déclencheur du roman. Quand tu apprends que quelqu’un que tu connais s’est fait buter, c’est chaud. Au début, j’étais abasourdi, touché. Après ça devient une obsession. Je me sers de ça pour raconter des histoires. Si je n’avais pas été obsédé par le bois de Boulogne, je n’aurais pas écrit mon premier bouquin.
Pourquoi sa mort n’a pas été médiatisée ?
Surement parce qu’elle est morte chez elle. Est-ce qu’elle est morte d’autre chose, genre overdose, c’est possible aussi. Peut-être qu’il y a une enquête dessus, je n’en sais rien. Peut-être que le bouquin va médiatiser l’affaire aussi. Mais en réalité des meurtres, il y en a beaucoup plus que ça. D’ailleurs, l’année où j’ai sorti Le boss de Boulogne [2014, ndlr], un travesti s’est fait buter au casque de moto. C’est passé inaperçu. Vanessa Campos, des mecs arrivent, ils péta un gun et ils lui tirent dessus. Jessyca Sarmiento, un mec l’écrase en voiture. Donc t’en as qui sont médiatisés et d’autres comme celui-là qui passent sous les radars. Mais si tu parles de tous les faits divers au bois de boubou, t’as pas fini.
Comment tu utilises la fiction dans tes romans ?
Dans mon premier livre, Le boss de Boulogne, seul le bois est réaliste. Dans Paname Underground, des personnages étaient vrais, c’était le bordel complet là-dedans. Dans Chems, tout le monde sentait que je racontais mon histoire. J’ai envie que le lecteur ait l’impression que je lui raconte une histoire vraie. Mais comme c’est faux, tu as l’impression de rentrer dans un truc. C’est ça mon but. Rendre la fiction réelle. Comme s’il avait accès à un truc vrai, hallucinant, justement parce que c’est faux. Mais ce qui est inventé dans ce roman est plausible.

« J'ai envie que le lecteur ait l'impression que je lui raconte une histoire vraie. Mais comme c'est faux, tu as l'impression de rentrer dans un truc. C'est ça mon but. Rendre la fiction réelle. » / Crédits : Teresa Suarez
Tu n’as pas peur qu’on te reproche de te servir d’une histoire vraie pour inventer n’importe quoi ?
Ne lis pas le roman alors. Tu as le droit de mater que des docus et pas des films. Moi, c’est ma liberté d’artiste entre guillemets. Je ne force personne. C’est le genre de truc qu’on peut me reprocher. Mais ce n’est pas un argument méga convaincant. On peut même me dire que je profite d’un fait-div, mais personne n’en a parlé. Donc je le fais vivre aussi. Un oublié de la nuit que je ressuscite.
À l’inverse est ce qu’il y a des éléments de la réalité que tu n’as pas voulu mettre ?
Le vrai nom de Zyed/Chicha par exemple. Des trucs trop persos sur lui qui pourraient niquer son anonymat. J’ai parlé d’inceste, etc. J’aurais pu préciser plus de trucs sur sa famille. D’ailleurs, tout est vrai là-dessus. J’en connaissais mille couches de plus. Mais on ne vient pas dans des groupes de parole pour après l’étaler au grand jour. Encore plus quand t’es mort.
Les chapitres où tu parles à la première personne, où tu fais le portrait du mec qui raccroche de l’underground, il est vrai ?
Ouais, je fais une bonne description de moi-même. Je suis pétri de peur quand je retourne au bois. Quand tu te défonces, t’es un warrior. Là même sans une clope, un joint, un verre, ça réveille tes peurs.
Dans ces chapitres, tu parles aussi de la réalité du Bois de Boulogne. Pourquoi y retourner après huit ans d’absence ?
C’est un endroit où j’ai passé deux piges. Mon premier roman se passe là-bas. Là, je me faisais chier à une soirée. Je me suis dit : « Tiens, je vais aller traîner au bois, voir ce que c’est devenu. » Dans les chapitres où je parle à la première personne, ça se déroule sur une nuit, mais en réalité ça en mélange deux. Par contre, je raconte plus ou moins une vraie session. Une première où j’errais et la deuxième juste après la mort de Chicha pour parler à ses copines que j’avais déjà vues. Je me suis fait envoyer chier.
Tu trouves que le bois a changé en huit ans ?
Objectivement, je pense que ça craint plus pour les travailleuses du sexe. Des lois mégas dures sont passées par là. La pénalisation du client, ça pénalise aussi les prostituées. Le confinement, je ne t’en parle même pas. Une galère totale. Et puis il y a eu le meurtre de Vanessa Campos, Jessyca Sarmiento. Une travailleuse hawaïenne évaporée aussi, une baston à l’arbalète. Tout ça, je le raconte dans le bouquin. Ça s’est précarisé. Je pense que la violence est plus forte. Après, ce n’est pas en une ou deux nuits que je vais le voir.
Finalement, qu’est-ce que tu veux montrer à travers La Nuit des hyènes ?
Je chope les obsessions en vol, et je les transforme. Mais la question du message chez moi est toujours un peu compliquée. Il n’y a rien d’autre que raconter une histoire qui trotte dans ma tête et me dire : « Vas-y, je peux en faire un truc. » Ça fait du bien d’écrire quelque chose qui te mange le cerveau. C’est un besoin. En tout cas, dès que je sors un livre, je tourne la page du sujet. Là, l’histoire m’a perturbé, obsédé, je la mets sur le papier et je passe à autre chose. C’est tout. Il n’y a pas d’autres motivations. Tous mes romans sont comme ça.