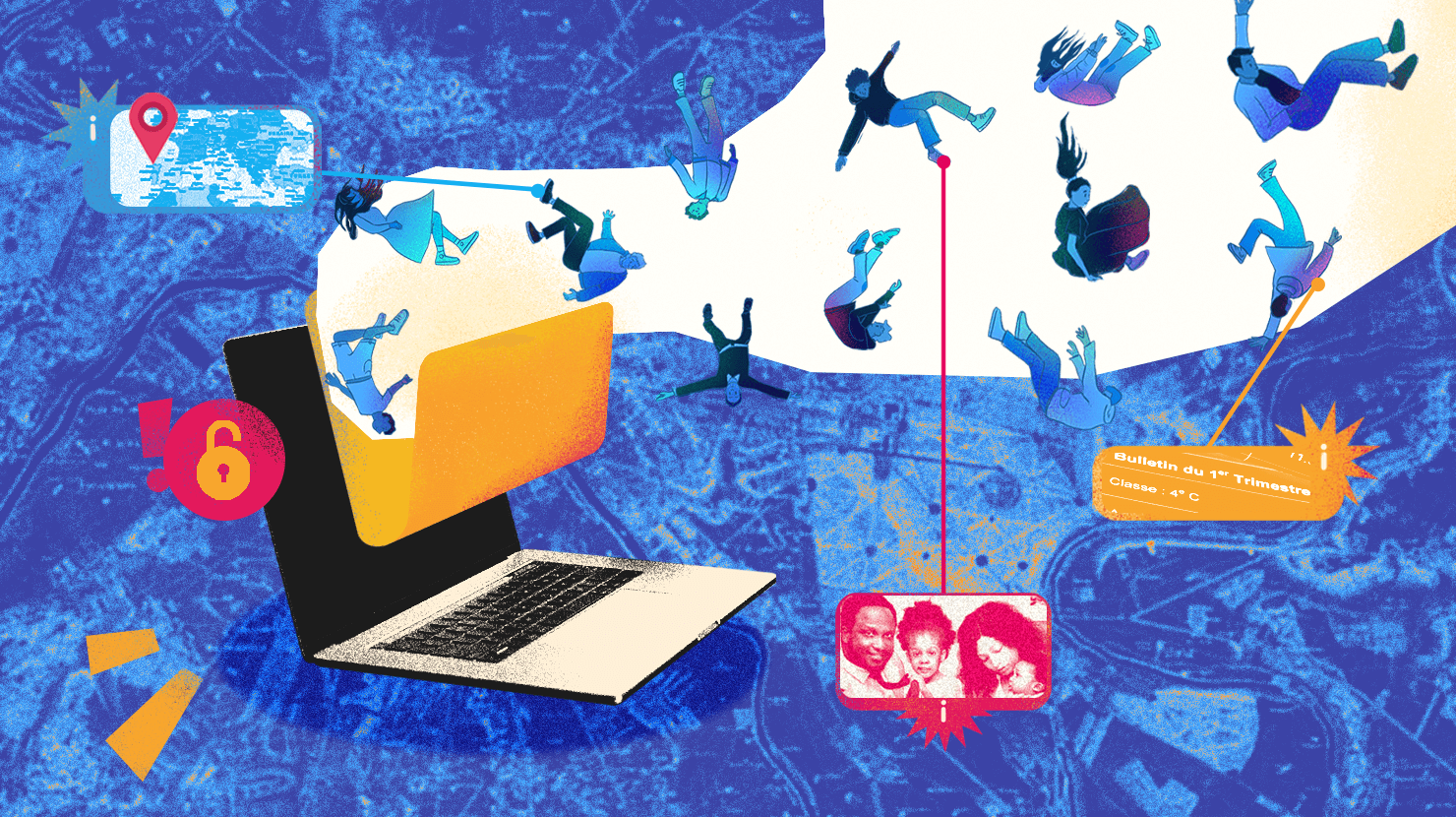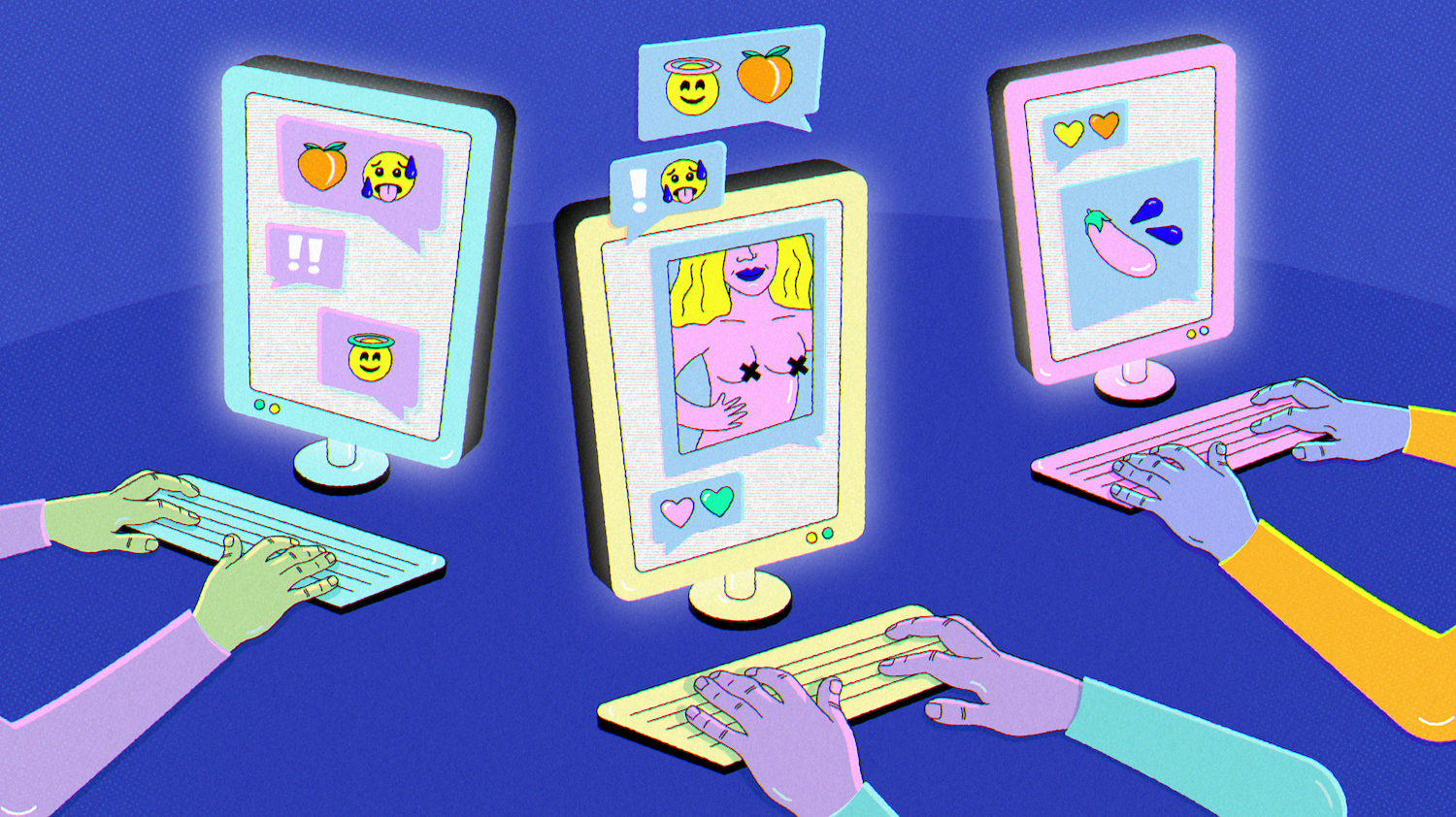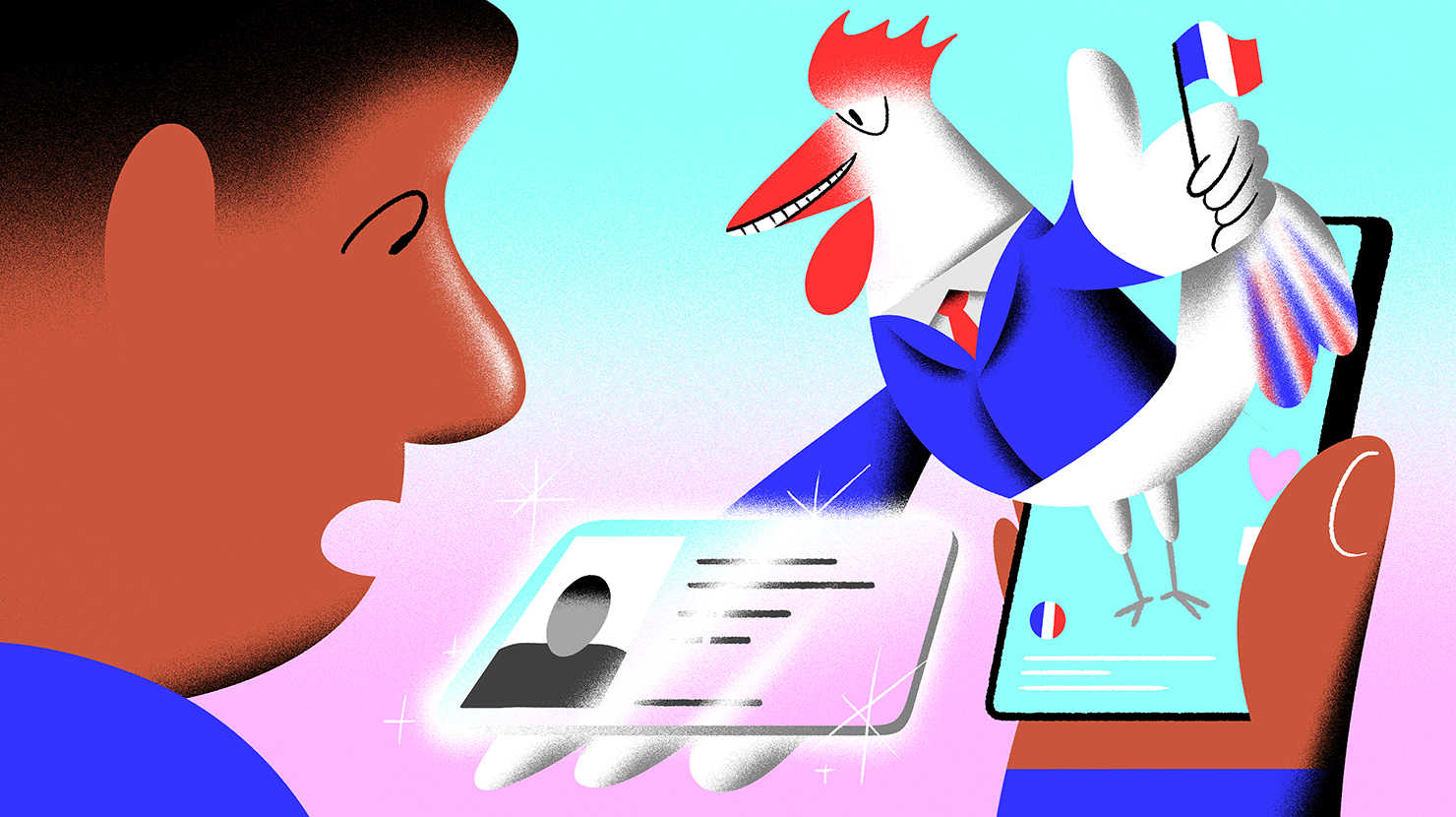Grands boulevards, Paris – Sur la moquette bleue des bureaux laissés à l’abandon, une machine à café est posée. Filimon se sert dans un gobelet en carton. Il fait partie des 80 exilés qui occupent officiellement les lieux depuis le lundi 18 avril. Cette « ambassade des immigrés » est un lieu d’hébergement et d’organisation politique pour les personnes exilées et antifascistes. Caisses de clémentines, briques de lait et brioches s’entreposent peu à peu dans l’espace cuisine. Dans une petite salle, les hébergés récupèrent des dentifrices et du papier toilette.

Les exilés et la Chapelle Debout occupent les bureaux depuis le 18 avril. / Crédits : Clémentine Eveno
La galère de la rue
Parmi les hommes attroupés sur le palier, Filimon se distingue par son calme. Il glisse parfois quelques mots en tigrigna, langue parlée dans le sud de l’Érythrée. Ce trentenaire originaire de Dekhemare – une ville à 40 minutes de la capitale Asmara – est en France depuis 2018 et a obtenu l’asile. Réfugié dans l’Hexagone, voilà huit ans qu’il n’a pas revu sa fille Herran, « cadeau » en tigrigna. Inscrit à la CAF, Filimon suit des cours de français avec Pôle Emploi. Mais cela ne règle pas ses problèmes de logement. Il vient de passer deux ans et demi dans un foyer de l’association Aurore, mandatée par l’Etat, où 60 personnes se partagent deux toilettes.
Mais il a fini dans la rue après avoir refusé un hébergement où il devait encore partager sa chambre avec deux autres personnes. Entre quelques nuits au 115, il a enchaîné les nuits dans le parc Citroën pendant trois mois ou dernièrement dans des campements à porte de la Chapelle. Là-bas, il a vu le pire et anticipe déjà :
« Si dans deux mois les gens qui sont ici sans papier sont de nouveau à la rue, ils finiront à porte de la Chapelle, addicts au crack ou au haschisch. »
Il occupe ce lieu pour revendiquer son droit « à un logement digne ».

Filimon n'a pas revu sa fille depuis huit ans. / Crédits : Clémentine Eveno
La rue malgré le droit d’asile
Il fait nuit depuis quelques heures déjà. Mais ce jour de ramadan, le palier est plus animé que jamais. Quatre vingtenaires débattent dans la langue de l’ethnie Oromo, un peuple d’Ethiopie, assis sur des cartons. Ils ont tous une carte de séjour. Mais ils sont aussi tous en galère de logement. Afaran (1), coupe afro et baskets, est en France depuis un an et demi. Il a officiellement obtenu le droit d’asile mais ça ne l’a pas empêché de dormir « sous le pont de porte de la Villette », faute de logement proposé par l’État français. Le regard dans le vague, il ajoute :
« Tu trouves ça normal, toi ? », interroge alors Mokhtar (1), l’un des amis d’Afaran avec qui il a dormi dans la rue. Ce vingtenaire éthiopien, au collier de barbe fourni, est indigné de devoir squatter des bureaux pour avoir un logement décent. Il voudrait retourner en Oromia, la région de son peuple, « le meilleur endroit d’Afrique » selon lui, dont il vante les montagnes et les forêts. Mais tant que les Oromos se font persécuter par l’État éthiopien, il ne peut rentrer. Alors Mokhtar reste en France. Il ajoute avec colère :« J’ai l’habitude maintenant, c’est devenu normal pour moi. »
« Même ici, je me bats tous les jours pour ma vie ».
Travailleur et mal-logé
Malay est un ami de Filimon. Il est surnommé « le chef » par ses amis pour rigoler. Dans les bureaux occupés, Malay s’organise. Avec ses comparses, il doivent quitter le foyer tôt le lendemain pour retrouver leur assistante sociale. L’homme aux cheveux bouclés a le statut de réfugié depuis 2020 et travaille comme jardinier dans une ville de l’Essonne. Il a signé un contrat de 29 heures en temps partiel imposé.

Caisses de clémentines, briques de lait et brioches s’entreposent peu à peu dans l’espace cuisine. / Crédits : Clémentine Eveno
Lui aussi était dans un foyer, entassé avec de nombreuses autres personnes. Malgré ses 940 euros touchés pour son boulot, il ne remplissait pas les conditions exigeantes des propriétaires d’Île-de-France et n’avait pas de garant. Il espère qu’un jour, il aura enfin un logement social, pour lequel il fait une demande chaque année, sans résultat pour l’instant.
Lieu d’organisation sociale et politique
Rosa (1), le regard concentré, s’active au rez-de-chaussée. C’est une bénévole du collectif La Chapelle Debout. Avec eux, Rosa défend « la liberté de circulation, le droit des immigrés et l’égalité ». Pour elle, les dernières années « ont été extrêmement difficiles pour s’organiser » :
« Il y a peu d’espaces communs dans les foyers ou centres pour demandeurs d’asile, les policiers gazent dans les campements dès qu’il y a un regroupement. »
D’ailleurs, la nouvelle occupation des bureaux a été très vite connue par les forces de l’ordre. Selon un autre membre de la Chapelle Debout, la police est venue juste quelques heures après le début du squat, histoire de se renseigner sur l’occupation. À travers celle-ci, le collectif tient également à pointer le racisme des institutions, en faisant référence à l’arrivée des réfugiés ukrainiens. « Avec eux, tout a été débloqué : logements, droits aux APL… Tout ce qu’on demande, c’est l’égalité », argue Rosa.
Associations et personnes solidaires
Au rez-de-chaussée, dans un petit bureau sur le côté, trois personnes de Médecins du Monde débarquent. Les habitants du nouveau lieu d’occupation se glissent pour avoir une consultation gratuite. Des traducteurs en arabe et anglais sont présents, gilets Médecins du Monde sur le dos. Des cours de français et des permanences administratives vont se mettre en place. James se balade entre les différents groupes. Cet Éthiopien de 26 ans, cicatrice sur le nez, a obtenu l’asile en France après la prison dans son pays d’origine. Il lance des débats en oromo. C’est l’un des seuls qui a pu louer un hébergement en région parisienne, une petite chambre à 400 euros par mois.
Pour lui, c’est important de « soutenir » ses camarades. À sa façon, James veut aussi faire un lieu d’échanges pour des personnes exilées. Dans quelques mois, il ouvre un salon de thé éthiopien. D’ici là, James prie pour que « les autres aient trouvé une solution ».
(1) Les prénoms ont été modifiés.
 Soutenez
Soutenez