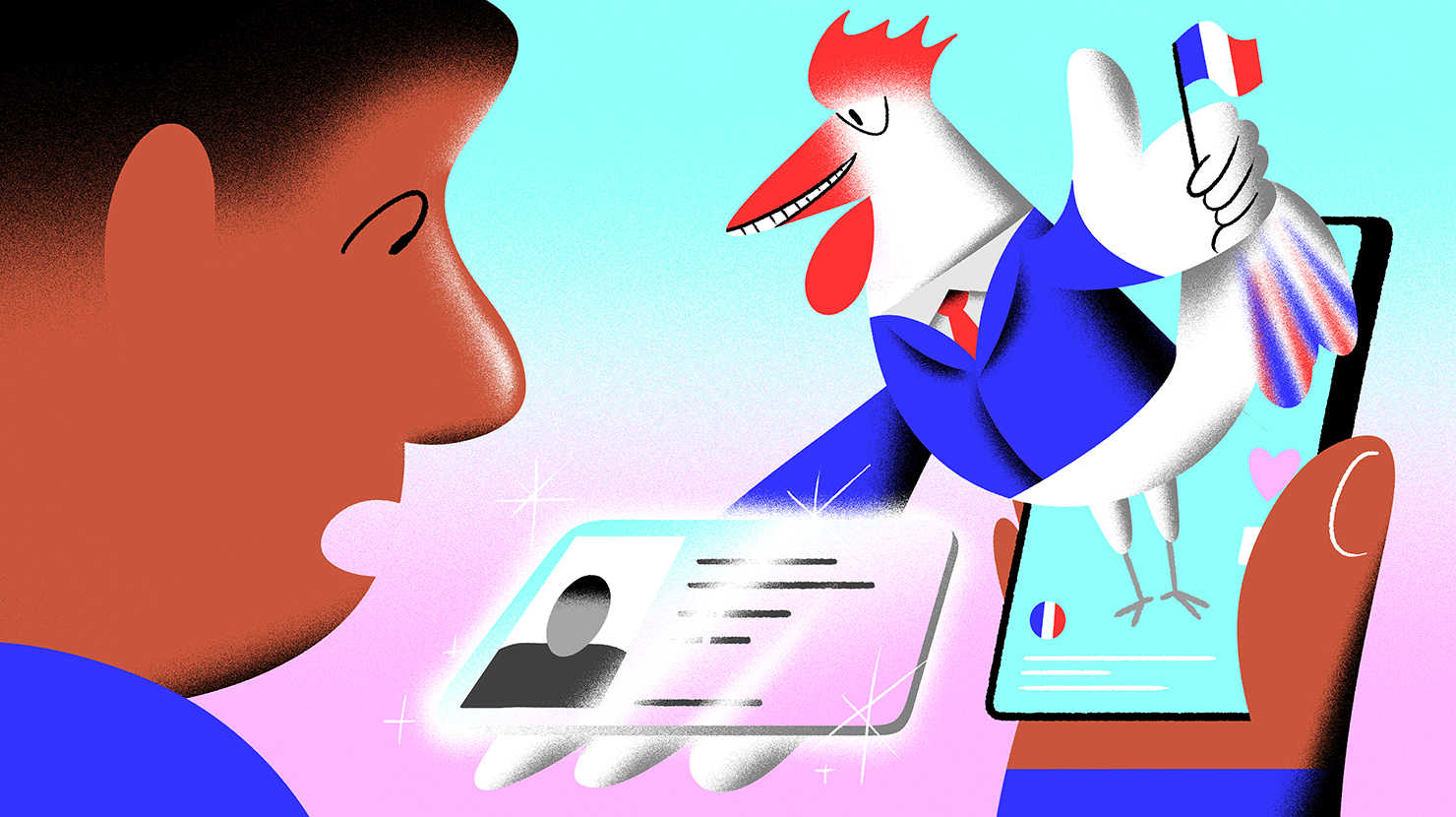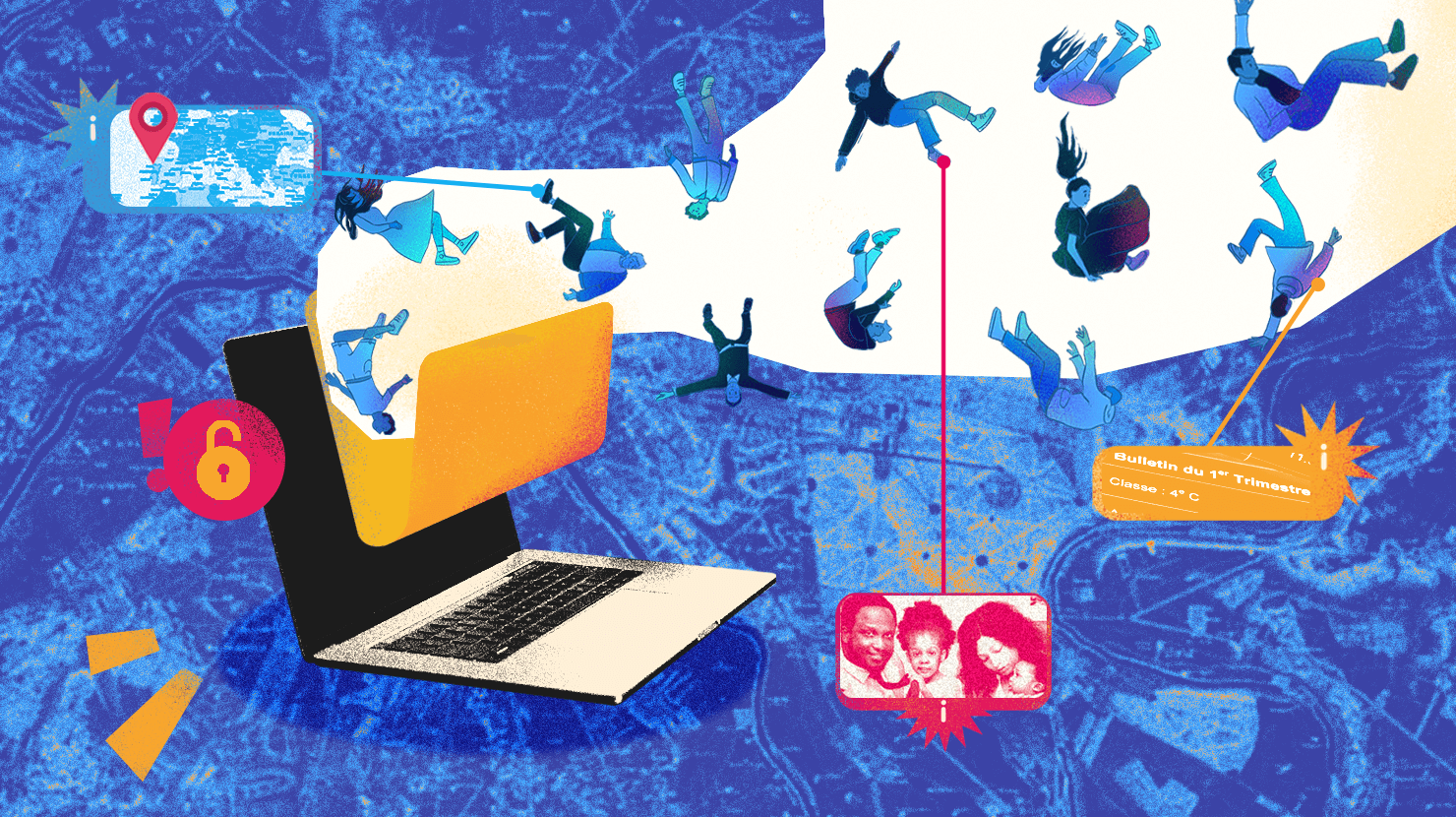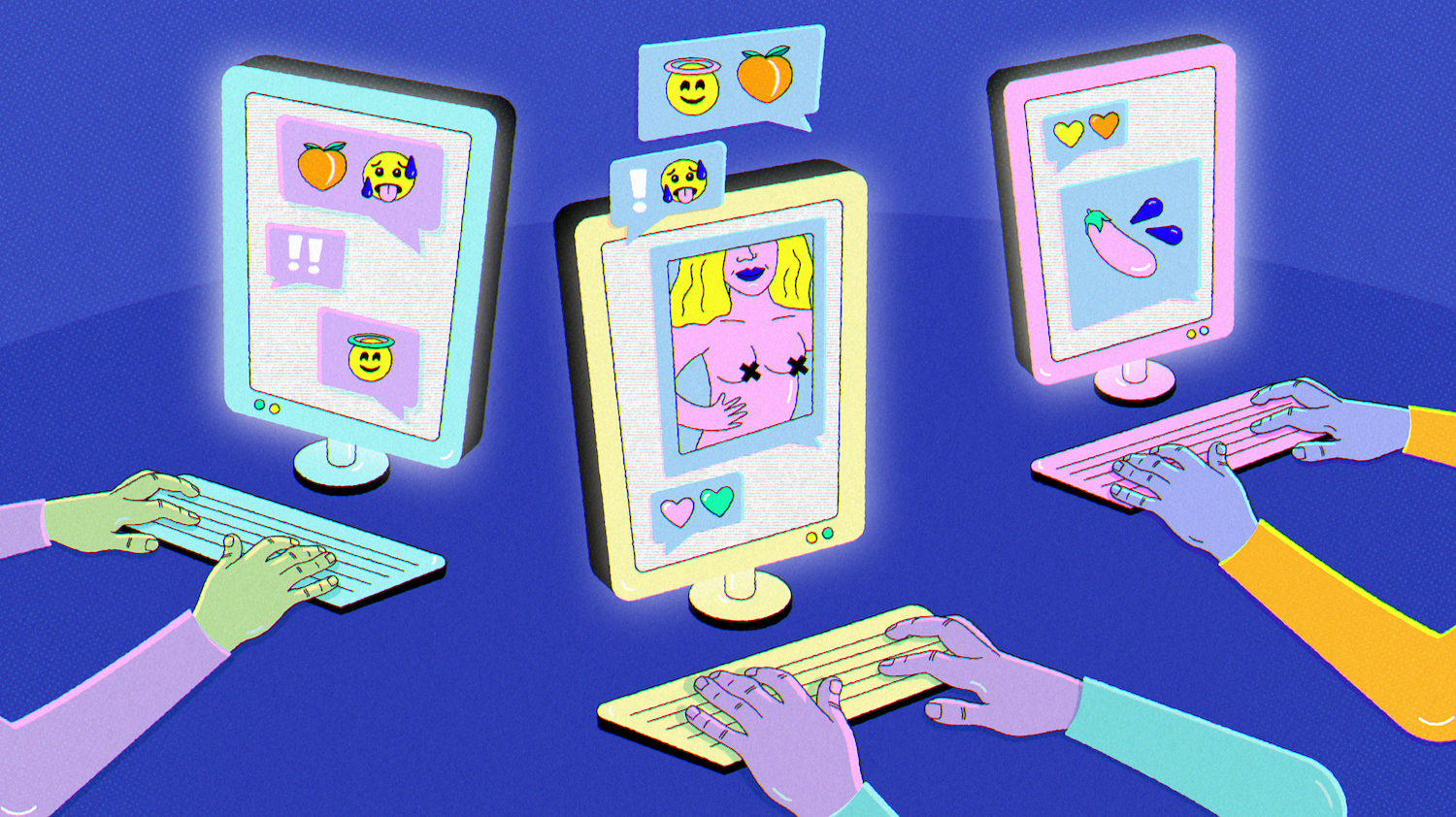Il est midi. Depuis une bonne heure, Ibrahim et moi sommes aux locaux des services spéciaux chargés de la « lutte contre le trafic de drogue, la criminalité organisée et le terrorisme ». Nous nous sommes fait embarquer après un contrôle, alors que nous nous dirigions en moto vers Kaloum, le centre-ville de Conakry. Le motif ? Apparemment, il n’y en a pas besoin. En tout cas personne n’a trouvé nécessaire de nous le signifier. Et mon statut de journaliste, en Guinée pour un reportage qui doit paraître dans le Monde Diplomatique, n’a pas l’air de beaucoup les émouvoir.
Interrogatoire
Au poste, c’est l’usine à racket : des Guinéens, des Asiatiques et des Européens sont dans le hall d’attente. Chacun passe à la caisse avant de partir libre. C’est notre tour. On nous emmène dans un grand bureau. Un filet de lumière passe par la fenêtre éclairant le commissaire, un gros bonhomme en boubou, coiffé d’un chapeau de prière. Il me dévisage, d’un air sévère. D’un signe de main, il nous invite Ibrahim et moi à nous asseoir en face de lui.
« Où vous rendiez-vous ? »
J’explique que je me dirigeais vers l’Assemblée nationale afin d’y rencontrer un journaliste en poste. Le commissaire me demande son numéro. Il l’appelle pour qu’il confirme mes dires :
« Il arrive. »
A cet instant j’imagine que cette histoire touche à sa fin mais l’interrogatoire commence.
« – Vous êtes journaliste alors ?
– Oui. Je fais un article sur… »Il me coupe.
« – Vous avez votre accréditation sur vous ?
– Non, je l’ai oubliée ce matin, mais mon ami, le frère d’Ibrahim, arrive avec.
– Nous allons voir ça. Vous êtes Français ?
– Oui monsieur.
– Vous n’avez pas l’air Français. Vos parents sont Français ?
– Euh oui monsieur, les deux.
« Et c’est quoi ça ? » me dit-il en désignant un visa pour l’Arménie tamponné sur mon passeport ouvert. « L’Arménie », chuchote-t-il. « Humm. » Il saisit alors une grosse loupe qui traîne sur son bureau et regarde une carte du monde accrochée au mur. Je crois bien qu’il cherche à situer l’Arménie.
« – Vous êtes déjà allé en Syrie ? C’est pas si loin de l’Arménie…
– Euh non jamais…
– Vous êtes musulman ?
– Non…
– Moi je suis musulman. Mais un bon musulman, pas comme ces fondamentalistes qui vont faire le djihad… »
J’acquiesce. Il me demande de vider mon sac à dos. De mon bazar étalé sur son bureau il extrait mon enregistreur. Son regard se durcit. « Vous êtes un espion arménien ! » crie-t-il.
« – Quoi !? Mais non je suis Français, vous avez mon passeport entre les mains !
– Cela ne prouve rien ! Ca peut être un faux ! »
Il feuillette à nouveau mon passeport :
« – Je vois que vous êtes aussi allez au Kirghizistan. »
– Oui, pour faire du tourisme.
– Vous avez fait le tour du monde alors. Vous êtes allé faire le djihad là-bas? »
Je nie, éberlué. Le ton commence à monter. Je lui dis de chercher mon nom sur internet. En 30 secondes il pourra vérifier que je suis bien journaliste. Il refuse. Je m’indigne :
« Vous refusez de clarifier la situation ?! Je ne connais même pas votre nom, vous pourriez au moins me dire à qui j’ai affaire ! »
«Mon nom ? », reprend le commissaire. « Non mais je n’ai rien à vous dire, vous êtes chez les services spéciaux du président ici, c’est nous qui posons les questions. »
D’un coup, sans toquer un petit homme en chemise colorée rentre dans la salle. Il se présente comme le supérieur du journaliste en poste à l’Assemblée nationale, celui que je devais rencontrer ce matin. Je respire. Ma situation devrait s’arranger. Et bien en fait non. Il explique au policier que j’aurais dû aller me déclarer à la Haute Autorité de la Communication de Guinée (la HAC) – le bureau gouvernemental de la censure en quelque sorte. Le commissaire, satisfait, revient à la charge :
« Tu es un espion ! Rien ne prouve que tu es journaliste. »
Le journaliste se lève, puis me regarde d’un air hautain. « Jeune homme, vous devriez vous excuser auprès du policier. » Il quitte le bureau en souriant. Je reste bouche bée.
Peu après, mon ami Abdoul toque à la porte. Il présente l’attestation du Diplo, le journal qui m’envoie en Guinée. « Cette pièce ne vaut rien. Il faut un papier de la HAC », dit le commissaire, d’un air triomphal reprenant le prétexte que vient de lui fournir le journaliste de l’Assemblée. Il interroge mon ami pour savoir s’il m’héberge. Abdoul acquiesce calmement. « Vous êtes un patriote guinéen et vous hébergez un espion arménien, peut-être même un djihadiste ? Vous êtes un maillon faible pour votre patrie », lance le commissaire qui décide alors de perquisitionner son domicile. Je suis consterné. Abdoul, Ibrahim et moi, sommes embarqués en direction de notre logement à Keitayah, un quartier très populaire en banlieue de Conakry.
Perquis’
Notre chambre donne sur une petite cour, partagée avec les logements de plusieurs familles. Les officiers y font, sous les regards surpris des enfants allongés sur des nattes, une entrée brutale. Le chef de la patrouille, que les soldats appellent Senghor, nous intime l’ordre de lui montrer notre chambre. Ibrahim s’exécute. Un officier en chemise rose avec un strabisme appuyé fouille nos bagages. Il retourne toute la chambre sans rien trouver. Senghor décide quand même de saisir nos ordinateurs et un autre enregistreur.
L’homme en chemise rose semble particulièrement frustré. Il ordonne ensuite la perquisition de la chambre de notre voisine. Ils y trouvent plusieurs millions de francs guinéens – quelques centaines d’euros – dans un sac en plastique. Ses années d’économie. Senghor s’en saisit, et décide de les ramener au poste. Nous tentons, avec Abdoul et Ibrahim, de le convaincre de laisser l’argent. Peine perdue.
Retour au poste
Vers 15h nous sommes de retour dans les locaux des services spéciaux. Immédiatement, je demande à appeler mon ambassade. « C’est votre droit ! Nous sommes dans une démocratie », me répond le commissaire. Ceci étant dit, il refuse de me mettre un téléphone à disposition. Fallait pas rêver…
Après un certain temps, Ibrahim est libéré… mais les économies de la voisine restent au poste. Je réussis à chuchoter à Ibrahim d’appeler l’ambassade française dès qu’il pourra. Abdoul, quant à lui, est emmené dans un dortoir où des soldats regardent la télé, et moi je suis placé en cellule. « Toi, tu vas passer la nuit au « violon » ! Ça va te calmer un peu », me dit le commissaire. Le violon, c’est une cellule sombre collée au commissariat, pleine de déchets, et infestée de moustique. Je partage le gîte avec un homme enfermé depuis une semaine pour « vente illégale de fusil de chasse ». Il n’a pas pu voir d’avocat, et il ne sait pas quand il va sortir.
La cellule comporte une petite fenêtre munie de barreaux qui donne sur la cour. Je tente le tout pour le tout. Dès que je vois quelqu’un sortir du commissariat, je crie par la fenêtre :
« Je suis un journaliste français, j’ai le droit d’exercer ici ! Laissez-moi appeler mon ambassade ! »
Malgré mes cris, tous les agents qui passent dans la cour m’ignorent royalement. Plus d’une heure est passée quand un homme corpulent en costume s’arrête. C’est le médecin légiste des services spéciaux. Il semble étonné de me voir ici. Il me promet de prévenir l’ambassade :
« En attendant on va te faire sortir de la cellule. Tu n’as rien à faire là-dedans. »
Sur ce, il appelle un garde qui me libère et m’emmène au dortoir. Il est 19h, je ne serai pas resté longtemps ici. Pour le pauvre gars qui est là depuis une semaine, c’est une autre histoire… Dans l’attente de nouvelles de l’ambassade de France, Abdoul et moi sympathisons avec les gardes. Ceux-ci nous confirment que souvent, des gens sont enfermés sans raison. C’est un manège pour que les officiers leur extorquent de l’argent, couverts par le commissaire. Vers 21h, avec l’autorisation des gardes, Ibrahim nous apporte à manger et de l’anti-moustique. Il me dit qu’il a réussi à joindre l’ambassade… Il faut attendre maintenant que la nuit passe.
Le lendemain
Réveil aux aurores. Du dortoir, on peut voir les officiers qui arrivent petit à petit : le commissaire Kaba, Senghor, d’autres soldats présents la veille, mais toujours aucune nouvelle de l’ambassade. Le médecin légiste arrive à son tour. Il me dit de venir dans son bureau :
« Tiens, j’ai le numéro de la consule. Appelle-la. »
Enfin ! Elle décroche. Je lui raconte tout. Elle me dit qu’elle est déjà informée de la situation. Mais sa journée est chargée, dit-elle. Elle fera ce qu’elle peut pour venir. J’ai le sentiment de ne pas être sa priorité.
En retournant au dortoir, nous croisons un homme immense en boubou bleu turquoise. Abdoul me glisse à l’oreille :
« C’est le colonel Tiegboro. C’est lui qui est inculpé pour le massacre du 28 septembre 2009. (1) C’est lui le chef ici. »
Abdoul me dit qu’il faut lui expliquer notre situation. Je lui raconte tout. En guise de réponse il me dit :
« – Donc votre ambassade ne sait pas que vous êtes là ?
– Si monsieur, grâce au professionnalisme de votre médecin légiste. Il m’a laissé prévenir mon consul. »
Le colonel se tourne alors vers le médecin, et lui hurle :
« Pourquoi tu as fait ça? Ça ne va pas ? Qui t’a dit de le laisser appeler? »
Apparemment lui aussi aurait préféré qu’on reste enfermé sans que personne ne soit au courant. Pendant que le docteur se fait passer un savon, le commissaire m’emmène dans son bureau. De son côté, Abdoul est de nouveau assigné au dortoir.
S’ensuit l’écriture du procès-verbal, pendant 4h. 4h parce que le commissaire n’a visiblement pas l’habitude d’utiliser un clavier, et surtout parce qu’il modifie mes déclarations. Aucune mention de l’argent confisqué au voisin, du refus d’appeler mon ambassade, du refus de me dire son nom ou même le motif pour lequel j’étais gardé au poste… Je me bats avec lui sur chaque phrase.
« Pratique illégale du métier de journalisme »
Enfin, le PV est fait. Je n’en suis évidemment pas satisfait. Il est 15h. Et toujours aucune nouvelle du consulat. Je ne sais pas si je dois signer. Le PV ressemble à une farce, et fait passer mes activités pour douteuses. Aucun nom d’officier n’y est écrit et en guise d’intitulé on peut lire :
« Flagrant délit de pratique illégale du métier de journalisme. »
J’obtiens l’autorisation de sortir fumer une cigarette, le temps qu’il imprime le PV. Dans la cour je trouve Ibrahim, venu prendre de nos nouvelles. Je lui demande discrètement son portable afin d’appeler l’ambassade. Je tombe sur le poste de sécurité à qui je raconte mes déboires. L’agent de sécurité me dit qu’il va en informer la consule. 30 minutes après, cette dernière débarque enfin, accompagnée d’un gradé de l’armée française. Ils expliquent qu’ils ont vérifié mon identité auprès de mon employeur et du ministère de l’intérieur et que je suis bien journaliste.
Il leur a fallu près de 24h pour ça ? En 5 minutes tout est arrangé. L’argent est même rendu au voisin. Il manque tout de même 1 millions de francs guinéens, soit 100 euros. Ça aurait pu être beaucoup plus. Enfin, après 30 heures, nous sommes libérés. Nos affaires nous sont restituées. Il manque également une trentaine d’euros de mon sac.
Dehors
Une fois sorti du poste, je raconte à la consule tout ce que le commissaire a refusé d’inscrire sur le PV.
« – Ils m’ont aussi pris de l’argent. Qu’auriez-vous dit si je vous avais dit tout ça dans le bureau du commissaire ?
– Oh, vous avez bien fait de rien dire. Pour l’argent je vous aurais dit de recompter, et que vous vous étiez sûrement trompé. »
Sur ces mots, elle me serre la main et s’en va. Quelques jours après ma sortie, je raconte l’histoire à un journaliste guinéen. Il n’est pas étonné que l’ambassade ne soit pas intervenue plus vite :
« Les autorités françaises ne préfèrent pas mettre leur nez dans ce type d’histoire, parce qu’elles ont peur qu’on les taxe de paternalisme, de néo-colonialisme. »
Il conclut, l’air résigné :
« En Afrique, la France a largement tendance à fermer les yeux sur les pratiques de corruption, à condition que les dirigeants en place ne nuisent pas aux intérêts de ton pays. »
(1) Le 28 septembre 2009, pendant un meeting de l’opposition au moins 157 personnes ont été tuées, des dizaines de femmes violées, plus d’une centaine de personnes ont disparu et 1 253 ont été blessées. En 2012, le colonel Moussa Tiegboro Camara a été inculpé par la justice guinéenne pour sa responsabilité présumée dans ce massacre.
 Soutenez
Soutenez