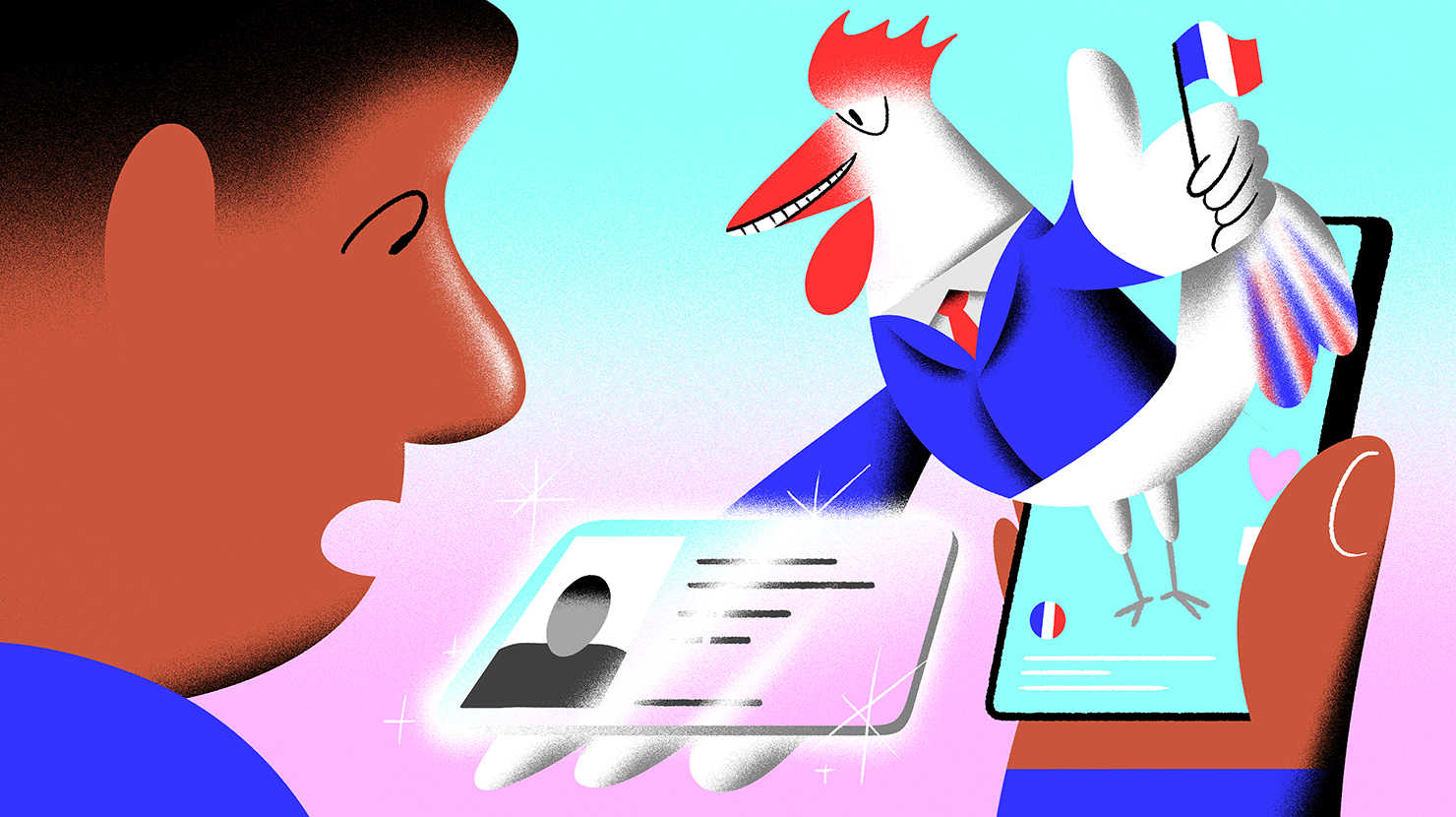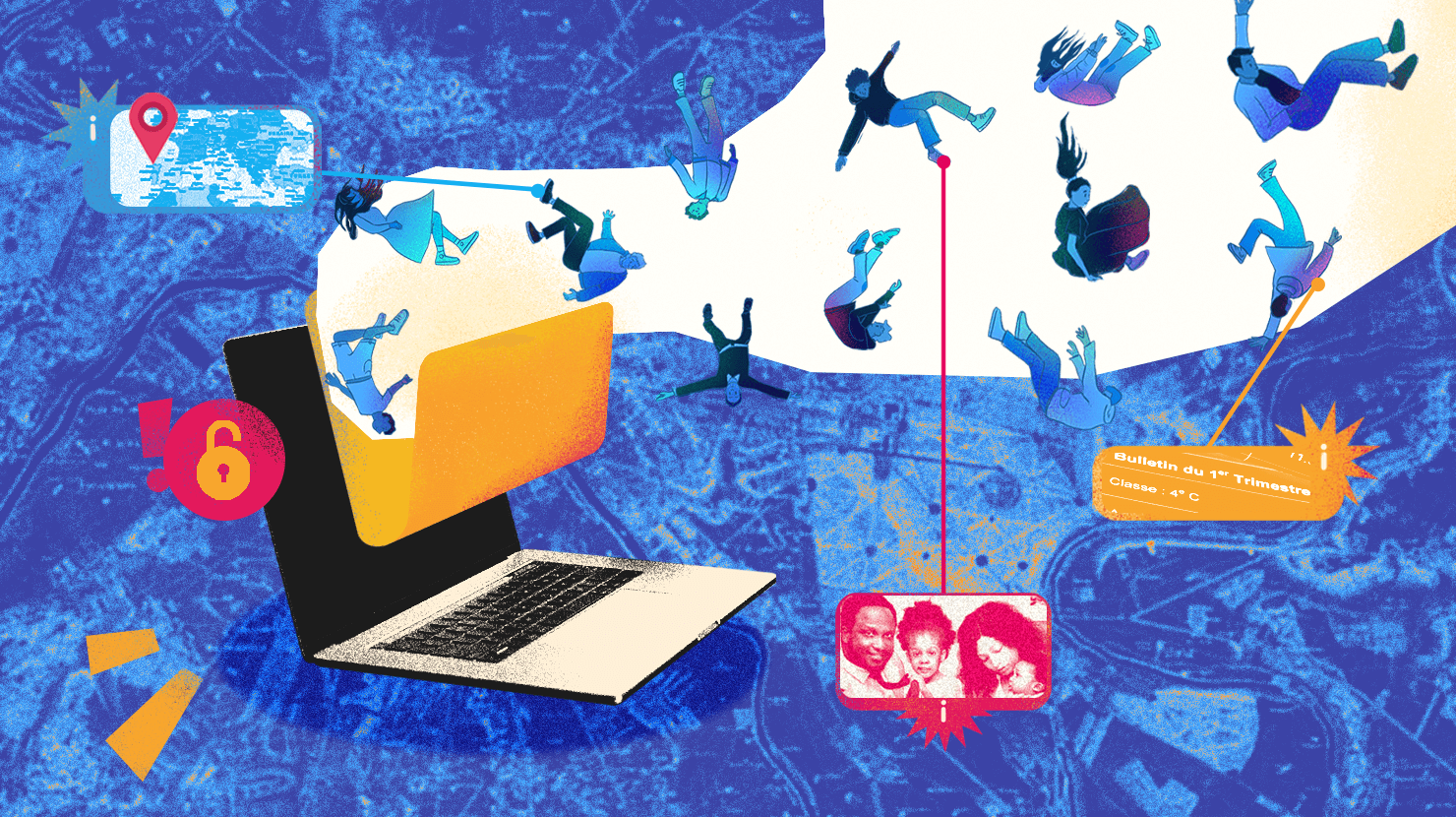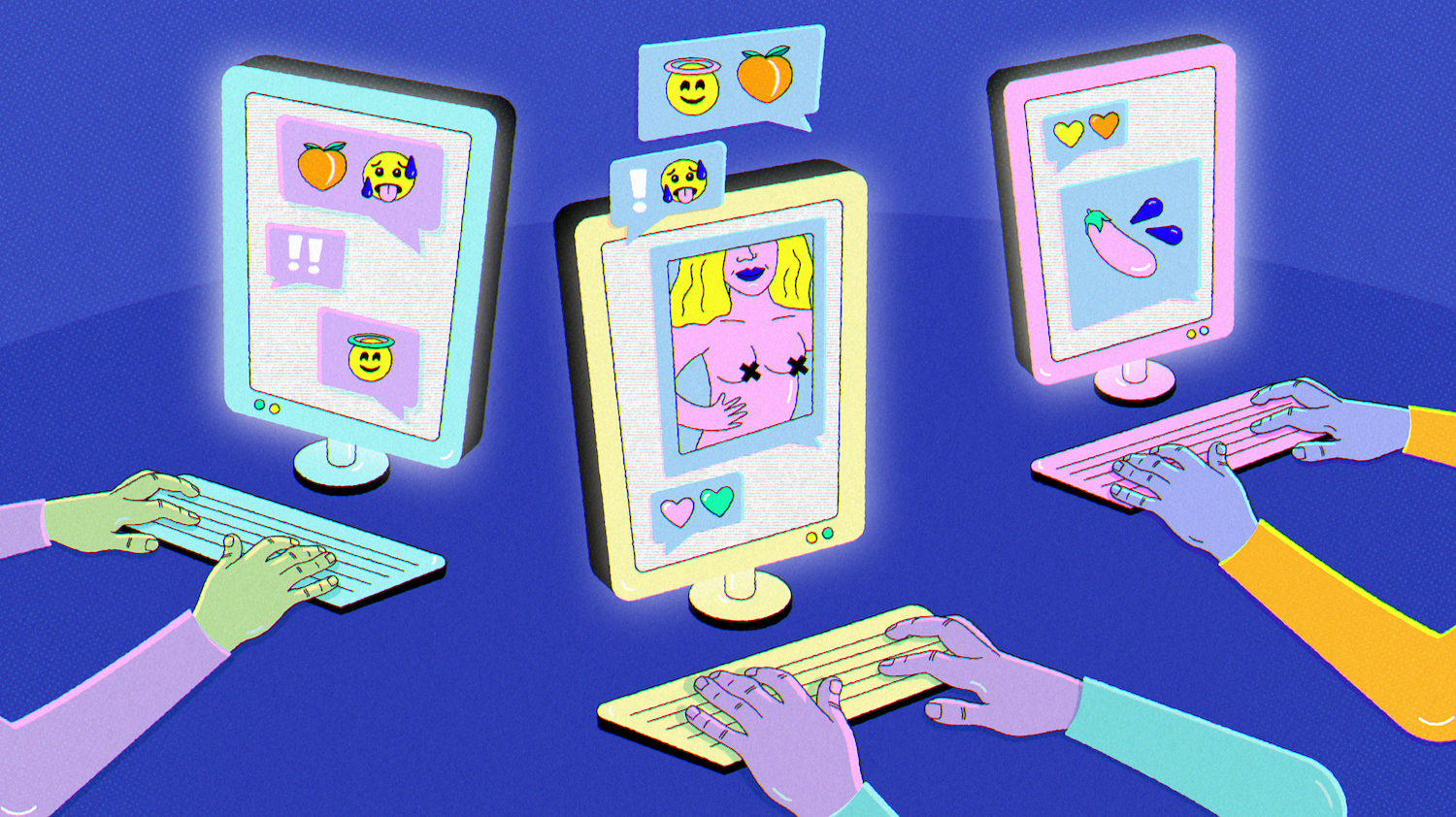« Pourquoi le terme asiophobie n’existe pas ? », s’indigne Sovanara*. Autour d’un jus d’orange, dans un café du 13e, la jeune fille énumère les discriminations qu’elle vit au quotidien :
« En primaire, on me demandait si je parlais français ou on m’appelait “la chinetoque”. »
L’étudiante en cinéma de 18 ans, dont les parents sont nés au Cambodge, regrette « qu’on n’entende pas assez parler de la communauté asiatique en France ». Après une longue période d’hésitations, la jeune femme a créé Sokhanyæ, le premier collectif asioféministe. « Je me sentais seule. Je voulais trouver des gens avec les mêmes aspirations que moi, avec qui je pourrais construire mon militantisme en tant qu’asio-descendante. » Grace Ly, blogueuse et voix forte de la communauté, assure que les lignes commencent à bouger :
« On assiste aux prémices d’un militantisme asiatique. Mais c’est vraiment le début ! J’ai l’impression que depuis un an, les choses changent. »
La mort de Chaolin Zhang, couturier de 49 ans – après une violente agression à Aubervilliers, le 7 août 2016 – est devenu le symbole de la stigmatisation de la communauté asiatique. Les manifestations qui suivent réunissent plusieurs milliers de personnes et font émerger la question du racisme anti-asiatique. « Il y a déjà eu des manifestations ou des procès portés par notre association sur cette question, mais on a rarement mobilisé autant de monde », complète Rui Wang, ancien président de l’Association des Jeunes Chinois de France (AJCF), aux manettes de ces rassemblements. Mais pas facile de dégager des leaders de la contestation.
Dire merci à la France
« Nous avons grandi dans des familles reconnaissantes envers la France. On nous a demandé de respecter le pays qui nous avait accueillis. Il ne fallait pas critiquer », se souvient Grace Ly, qui tient le blog La Petite Banane. Elle est l’une des rares figures à prendre la parole sur les discriminations qui touchent les asio-descendants. La jeune femme aux longs cheveux ébène est fille d’immigrés cambodgiens. Rescapés de la guerre civile et des Khmers Rouges, ses parents entament une nouvelle vie en région parisienne dans les années 70 :
« Enfant, j’avais l’impression d’être un cliché vivant ! Mes parents ont eu tous les métiers les plus clichés : ils ont ouvert successivement un restaurant chinois, un autre japonais, une épicerie, un vidéo club, un pressing… Ajoute à ça qu’ils avaient un accent. A l’école, on m’appelait ‘la fille de Jackie Chan’. »

Grace Ly tient le blog La petite banane. / Crédits : Pierre Gautheron
L’enfant en vient vite à la conclusion « qu’être blanc c’est beaucoup mieux ». « Les filles belles étaient blanches, pas asiatiques », insiste-t-elle comme si elle revivait ses années d’adolescence.
Kei Lam a vécu une histoire similaire. « J’en faisais dix fois plus que tout le monde pour être dans la norme et montrer que j’étais assimilée. J’évitais de traîner avec d’autres enfants chinois pour ne pas qu’on pense que j’étais communautariste. » D’origine hongkongaise, l’illustratrice arrive à Paris à l’âge de 6 ans, avec sa mère. Elles rejoignent le père, dessinateur, parti quelques années plus tôt pour se construire une situation avant de les faire venir. « Mon père est arrivé en 90. Il pensait rencontrer Monet et Van Gogh dans les rues de Paris », sourit-elle, assise à la terrasse d’un café de Montreuil, où se trouve son atelier. La dessinatrice raconte les péripéties de sa famille dans Banana Girl, son premier roman graphique paru cet été :
« Être une banane, c’est avoir une tête d’asiatique avec une culture occidentale. Jaune à l’extérieur et blanche à l’intérieur. »
« Ca n’est ni une insulte, ni un compliment à mon sens. Juste un fait », commente Grace.
Connaître son histoire
« Personne ne parle de double culture. La première fois qu’on m’a dit “tu es mixte”, ça a été une révélation ! J’ai compris un paquet de trucs », explique Kei Lam, en replaçant ses lunettes. Elle raconte ne s’être jamais, dans sa jeunesse, sentie représentée : elle n’était ni totalement asiatique, ni totalement blanche. « J’étais banane et je voulais montrer cette nuance dans mon livre. » Mais pas facile de se mettre à nu :
« Pourquoi mon histoire serait-elle plus intéressante qu’une autre ? Pourquoi en parler alors qu’elle n’est pas ouf ? Comment réagiront mes proches et ma famille ? »
webserie Ca reste entre nous – épisode 1
Finalement, les retours sont plus que positifs. « Les gens se sont retrouvés dans mon histoire, à ma grande surprise. Certaines personnes avaient l’air soulagées de ne pas être seules. » « Ce type de récit est nécessaire. Il faut créer des documents qui parlent de notre histoire, de nos vie », assure Grace Ly, qui a elle lancé la websérie « Ca reste entre nous » :
« Il faut donner la parole aux concernés. »
« Il faut sortir de cette image réductrice d’enfant banane, qui créé souvent le sentiment d’illégitimité, nuance Sasha Lin, 41 ans et co-fondateur de l’Association des Jeunes Chinois de France (AJCF). Mixte ou pas la jeunesse doit connaître son histoire. Il faut qu’elle soit fière de son passé, de son héritage, et qu’elle se sente à l’aise avec dans le présent. »

Sasha Lin, co-fondateur de l'AJCF, dans son restaurant à Rambuteau. / Crédits : Pierre Gautheron
Il fait partie des militants historiques de la communauté. Grace abonde, exemple à l’appui : « Quand j’étais petite, j’en voulais à mes parents d’être si calmes face à des agressions de la vie quotidienne ». Un jour, alors que son père est au volant, un homme leur fait une queue de poisson :
« Pour moi, il fallait réagir à la manière des Français, des latins, qui ont le sang chaud. Il fallait gueuler quelque chose par la fenêtre. Mais il m’a dit “c’est pas grave, laisse”. Pour moi c’était un fuyard, j’en avais honte. Alors que dans les faits, il a vécu la guerre et a survécu aux Khmers Rouges. Evidemment qu’il s’en foutait d’une queue de poisson… Mais enfant, je ne me rendais pas compte de tout ça. »
La communauté modèle
Cette prise de conscience, Grace Ly appelle ça « être awoke » – littéralement être éveillé. « J’ai mis 37 ans à me rendre compte de toutes les discriminations que j’ai vécues dans ma vie, en tant que femme issue de l’immigration. Ca n’est pas simple d’ouvrir les yeux », avoue la blogueuse de 37 ans. Si ses pages Facebook et blogs étaient initialement tournés vers le fooding, la jeune maman essaie depuis un peu plus d’un an d’attirer l’attention sur les discriminations dont souffrent les asio-descendants. Elle évoque notamment les fantasmes sexuels autour des femmes asiatiques, qui devraient être douces et dociles. Un objet :
« Mes relations amoureuses ont été très douloureuses. On attendait des choses de moi que je n’étais pas. Tu te dis “c’est bizarre”, tu te demandes si c’est raciste et tu finis par conclure que c’est toi le problème. Tu perds confiance en toi et tu deviens l’objet qu’on attend que tu sois. »
Mère de trois enfants, elle a décidé de témoigner pour épargner ses peines aux générations suivantes. « Je me suis longtemps sentie très seule avec mes complexes. Je ne veux pas qu’ils passent par là. » Compliqué de briser cette solitude quand tout le monde tend à minimiser ces discriminations. « Je pense que pour beaucoup de gens, le mot d’ordre est “pour vivre heureux, vivons caché”. Il ne faut pas faire de vague », conjecture la blogueuse, qui enchaîne sur la théorie de « la minorité modèle » :
« Il y aurait deux types d’étrangers : d’un côté les pires, les noirs et les arabes, et de l’autre nous, les gentils asiatiques discrets. »
Ainsi, pendant les manifestations de l’été 2016 en hommage à Chaolin Zhang, elle entend « eux, au moins, quand ils font une manif’, ils ne brûlent pas des voitures… ». « On est acceptés parce qu’on ne fait pas de bruit. Et quand on fera du bruit, que se passera-t-il ? On sera mis dans le même paquet que les autres ? », s’interroge Rui Wang, président sur le départ de l’AJCF.

Rui Wang. / Crédits : Pierre Gautheron
Ouvrir la voix
Le jeune homme en polo et pull noué sur les épaules concède avoir toujours eu une grande gueule. Mais il sait que, dans son association, il fait figure d’ovni :
« Prendre la parole, c’est accepter l’éventualité de mourir sur place publique… ».
« Il faut se sentir légitime aussi. Personnellement je ne considère pas que ça soit mon métier ou mon rôle. Moi je fais de la musique », juge la DJ Louise Chen. Elle signait pourtant, en janvier dernier dans Les Inrocks, une tribune intitulée Pourquoi je n’ai toujours pas digéré le sketch de Gad Elmaleh et Kev Adams sur les asiatiques. Dans leur spectacle, les deux humoristes enchaînent les clichés, allant de l’imitation d’accent, aux sous-entendus de chien dans les raviolis. Assise en terrasse rue Montmartre, dans le 2e arrondissement de la capitale, la DJ débriefe :
« On m’a quand même dit “tu vas un peu loin”, “oh la la on ne peut plus rire de rien”, “relax”, alors que j’étais extrêmement choquée par ce sketch ! Pour moi, il participe à garder la personne d’origine asiatique à son statut d’étranger, auquel on ne peut pas s’identifier. Qui ne nous ressemble pas. »
Ajoutant : « Ce qui m’a fait le plus de mal, c’est qu’M6 et le CSA laissent passer ce genre de propos. 4 millions de téléspectateurs ont décidé de rire d’une même communauté – qui représente quand même 600.000 personnes en France – et tout le monde trouve ça normal… »
Autant de clichés et réflexions qui se retrouvent dans l’espace public, comme en témoignent nos interlocuteurs : « Des étrangers me disent Ni Hao dans la rue » – « on me répond avec un fake accent chinois » – « On me demande “combien tu prends” en pleine rue comme si j’étais une prostituée » – « on me complimente régulièrement parce que je parle super bien et sans accent pour une asiatique » – « on me balance des “rentre chez toi” » – « la blague “pas de sushi” est devenue classique »…
« Devant ces agressions, il ne faut pas rester passif », répète inlassablement Sacha Lin, pionnier du militantisme asiatique. Il a intenté, avec l’AJCF en 2012, l’un des premiers procès pour diffamation contre l’hebdomadaire Le Point : « On s’est dit ‘cet article est attaquable juridiquement, alors on y va!’ ». Le papier, intitulé L’intrigante réussite de la communauté chinoise de France, joue sur « la peur du péril jaune ». Y sont listés, notamment, « Les 5 commandements de l’entrepreneur chinois » :
1. Tu travailleras 80 heures par semaine.
2. Tu dormiras dans ta boutique ou ton restaurant.
3. Tu ne rémunèreras pas tes employés car ce sont les membres de ta famille.
4. Tu ne cotiseras pas et donc tu ne toucheras pas d’aides.
5. Tu ne paieras pas d’impôts.
« Des propos discriminatoires et infondés, qui nourrissent la stigmatisation dont souffrent les citoyens d’origine chinoise », insiste Sacha Lin, qui se souvient qu’à l’époque son combat ne faisait pas l’unanimité dans les rangs de l’AJCF :
« J’étais le seul à vouloir attaquer. On m’a dit “ça n’est pas la bonne manière”, “mieux vaut faire de la médiation”, “on ne peut pas”, “on ne gagnera pas”. Et puis il y avait ceux qui avaient totalement assimilé et intériorisé les discriminations et qui jugeaient que ça n’était pas si terrible. »
L’asso s’est finalement lancée et a gagné le procès. Le Point et Franz-Olivier Giesbert sont condamnés pour diffamation. Et les discours ont changé autour de Sasha, qui a entendu des « on aurait dû faire ça depuis longtemps ».
La force de la culture
« Est-ce qu’il est nécessaire de lever le poing pour revendiquer nos droits ? », s’interroge quant à elle Julie Hamaïde, créatrice et rédactrice en chef de Koï Magazine – passé par Média Maker, l’incubateur de médias de StreetPress – dont le premier numéro est paru en septembre. La journaliste a fait le choix de mettre en avant les cultures asiatiques :
« Je ne voulais pas faire un journal d’asiat’ pour les asiat’. Le magazine est pour tout le monde et met en lumière des sujets et thématiques oubliés des médias traditionnels. »

Julie Hamaïde, fondatrice de Koï Magazine. / Crédits : Pierre Gautheron
« C’est une initiative inspirante qu’il faut promouvoir », juge Cam Linh, photographe qui a participé au crowdfunding du mag. Cette dernière se sent plus féministe qu’asio-militante : « Je préfère rassembler les combats et m’intéresser globalement au sexisme et au racisme ». Elle rejoint Julie sur une grande idée : la communauté asiatique n’est pas uniforme.
« Nous ne sommes pas tous chinois », rigole Boon, grand homme longiligne aux cheveux longs. Le graphiste thaïlandais est arrivé en France à 24 ans pour ses études. Voilà 9 ans qu’il a adopté Paris et déambule dans les soirées hypes de la capitale. Avec cinq de ses amis – originaires du Japon, de Corée ou encore du Vietnam – il a fondé le collectif Yellow Ghetto, qui organise des événements mettant en avant des artistes du continent asiatique. « On aime bien jouer sur ce terme Yellow, utiliser les insultes racistes et se les réapproprier », explique Kumi, chanteuse et membre du collectif. Elle est fière de rappeler la mixité de leurs fêtes – aujourd’hui plus rares par manque de temps. « On accueille tout le monde. Et on a réussi à ramener des asiatiques dans les soirées branchées, en plein Paris. » Louise Chen est particulièrement admirative de leur travail :
« Leur force, c’est qu’ils créent des ponts entre les cultures. Et en plus, ils font comprendre à des blancs bourgeois qu’ils n’apprendront rien aux asiatiques, qui ont aussi une culture hyper vaste et intéressante ! »

Le collectif Yellow Ghetto. / Crédits : Pierre Gautheron
Selon la DJ, la culture, et notamment la pop culture, permet l’ouverture des consciences. « On voit bien quel rôle jouent en ce moment les séries et les films dans les luttes afro aux Etats-Unis. Nous sommes en retard, mais il faut compter sur ce combat culturel. » Rui Wang abonde :
« Le soft power est bien plus efficace que la lutte sociale pure et dure. »
Il prend l’exemple du film Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu : « bam ! Tout le monde l’a vu ». Le jeune homme cite ensuite Frédéric Chau, « véritable modèle de réussite ». Ajoutant : « Il en faudrait plus. »
Une immigration récente
Dans son bureau à Nation, Rui Wang, 30 ans et agent immobilier lorsqu’il n’est pas à l’AJCF, retrace l’histoire des asiatiques de France. Une immigration qui ne date, pour l’essentiel, que des années 70. « C’est très récent. » Lui-même n’est que de la 2e génération. Ses parents sont arrivés de Chine à la fin des années 80, en Italie puis en France. Il les rejoints, enfant, en 1995. « Quand on regarde les militants des minorités voisines, ce sont souvent des gens de la 3e génération. » Charline Ouarraki, co-fondatrice de l’association Womenability – qui milite pour que les femmes se réapproprient la ville – explique par ailleurs que se penser comme communauté est laborieux :
« Le pouvoir individuel ne suffit pas, nous avons besoin du collectif pour empoweriser la communauté. Il faut collaborer, construire. Ca n’est pas facile et ça prend du temps. »
« C’est drôle, j’ai dû davantage militer pour le féminisme, voir l’afro-féminisme, que pour l’asio-féminisme qui me concerne pourtant directement », rigole-t-elle, concédant qu’il est toujours plus simple de rejoindre une lutte déjà existante. La trentenaire s’inspire d’ailleurs directement des luttes afro aux USA, et des luttes afro-féministes françaises. « L’avancée des unes ouvre évidemment la porte aux autres », assure-t-elle. « Elles nous ont montré que l’on pouvait parler, témoigner et ne pas se laisser marcher sur les pieds », explique Jaune Vénère, 22 ans. L’étudiante, comme Sovanara qui a créé le collectif Sokhanyæ, milite sur Twitter. « On suit beaucoup les blogs des militantes afro-féministes, qui se rapprochent le plus de ce que je vis et ressens », souligne la première. Elle cite Amandine Gay et son documentaire Ouvrir la voix, Nkali et ses coaching de femmes racisées en entreprise, le collectif Mwasi. Mais aussi des assos comme Lallab, qui défend un féminisme intersectionnel où les femmes musulmanes et voilées pourraient se retrouver.
Les deux jeunes femmes sont étudiantes et, sur leur temps libre, militent au sein de collectifs asio-féministes, mais ne se voient pas encore sortir d’internet. Elles préfèrent d’ailleurs témoigner sous pseudo. Sovanara :
« C’est angoissant de se mettre en avant et de militer sur le terrain. Mais un jour, je montrerai ma tête et je prendrai la parole. »
Contrairement au reste des personnes interrogées par StreetPress, elles se revendiquent militantes. Elles connaissent le vocabulaire féministe par cœur et revendiquent une certaine radicalité. « Quand je vois aujourd’hui des jeunes filles de 17 ans prendre la parole sur Twitter, je trouve ça génial. Elles sont dix fois plus au courant que moi, ont plus d’aplomb. Elles m’apprennent énormément », sourit Grace enthousiaste, avant d’ajouter tout de même :
« Mais il nous manque toujours une Rokhaya Diallo [militante afro et chroniqueuse dans TPMP] de la communauté asiatique. »
 Soutenez
Soutenez