Paris, 1er arrondissement – Attablé au Deux Palais, le troquet qui fait face à l’ancien Palais de Justice de Paris, Arié Alimi enchaîne les rendez-vous. Il faut caler la promotion de son bouquin dans les interstices d’un emploi du temps déjà chargé. Dans l’État hors-la-loi, l’avocat découpe au scalpel le processus judiciaire qui, bien trop souvent, mène à l’acquittement de policiers violents. Il raconte, en s’appuyant sur les nombreux dossiers qu’il a défendus, le chemin de croix des victimes.
Tout en sirotant un verre de blanc, il revient sur cinq dossiers emblématiques. Au fil des affaires, il décrit sa façon de bosser. L’homme use des réseaux sociaux et s’appuie sur le travail des journalistes (parfois de StreetPress), autant qu’il fait du droit. Une méthode qui secoue le monde lisse de la justice et lui vaut aussi bien le respect des uns, que l’inimitié des autres. Mais tout bon ténor du barreau se doit d’avoir sa dose de controverses.
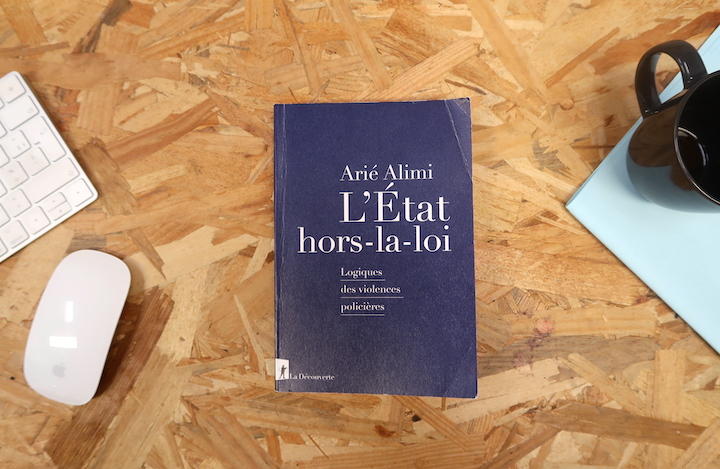
Le nouveau livre d'Arié Alimi, L'État hors-la-loi, sorti aux éditions de La Découverte. / Crédits : StreetPress
L’un des premiers dossiers que tu évoques dans ton livre, c’est celui de Jean-François Martin. Peux-tu nous raconter son histoire ?
Jean-François Martin est un étudiant de 21 ans. Il est dans une manifestation contre la loi travail à Rennes (35) et se retrouve sur l’une des rives de la Vilaine. Il tombe. Il a été touché – on le saura plus tard – par un LBD 40 tiré par des policiers qui étaient sur l’autre rive. Il vient me voir, avec ses parents, après que le juge ait prononcé un non-lieu.
C’est quoi l’argument dans ce dossier ?
Deux policiers sont susceptibles d’avoir tiré et d’avoir éborgné Jean-François. On ne sait pas lequel a tiré. Donc non-lieu.
On dépose un recours et j’appelle la société Index, avec qui j’ai l’habitude de travailler. Ils arrivent à faire une chose très importante : avec les vidéos et les photos, l’orientation des tirs, ils excluent qu’un des deux policiers soit l’auteur du tir. C’est énorme, parce que la chambre de l’instruction se retrouve un peu embêtée. Elle est obligée de dire : « Effectivement, vous avez pu faire le boulot, et montrer que c’était ce policier ». D’ailleurs, ils prononcent le non-lieu pour l’un des policiers [et donc acte indirectement que l’autre est bien le tireur].

Capture d'écran de la vidéo d'Index. / Crédits : Capture d'écran
Quelle est la suite de cette affaire ?
Ils renvoient l’affaire devant le tribunal correctionnel, mais il y a un problème de forme, donc retour à la case départ. On retourne devant une autre chambre de l’instruction et là, on se prend une taule : cette fois ils disent « légitime défense ». Les policiers avaient reçu un feu d’artifice [qui n’a pas été tiré par Jean-François] sur un auvent qui avait pris feu juste avant. On retourne devant la cour de cassation. Et là, on attend.
C’est un parcours du combattant pour les victimes. Et à chaque étape, on doit mettre en œuvre une énergie incroyable pour espérer passer à la suivante. Alors qu’ici, il a été victime de violences et qu’on a identifié le policier. Dans un autre dossier de violence, ça aboutirait à une poursuite devant la cour d’assises.
Autre histoire de violences policières en manif’ : l’affaire Geneviève Legay. Pendant le mouvement des Gilets Jaunes, cette dame de 73 ans est gravement blessée, victime notamment de fractures du crâne. Comment tu te retrouves là-dessus ?
Ses filles m’appellent, à un moment où Geneviève est entre la vie et la mort. Dans cette affaire, on a immédiatement une version officielle : le procureur de la République de Nice (06) dit que les policiers n’ont pas touché Geneviève, la charge était légale et la manifestation est, elle, interdite. Le maire de Nice, Christian Estrosi, le député des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, le préfet des Alpes-Maritimes, Georges-Henri Leclerc, et in fine le président de la République, prennent la parole sur ce dossier. Emmanuel Macron, alors qu’elle était entre la vie et la mort, va dire que Geneviève Legay n’aurait pas dû être dans cette manifestation, qu’elle aurait dû faire preuve de sagesse.
La première expérience de ce dossier, c’est le caractère éminemment politique des affaires de violences policières. Elles ont une implication immédiate au plus haut niveau de l’État, sur la structure de l’État elle-même.
La deuxième chose, c’est la nécessité, face à ce mur, de réinventer la façon d’être avocat. Tu n’as pas le choix : tu dois devenir enquêteur dans les 48 premières heures, avant que tout ne disparaisse. Avant que l’institution judiciaire ne fasse disparaître les preuves. Ils avaient les vidéos, ils savaient dès le départ ce qui s’était passé.
Et ils ont masqué ces preuves ?
Ce dossier est tellement caricatural, en termes de partialité et de conflit d’intérêts, que ça en devient ridicule. La compagne de Rabat Sushi [le policier accusé d’avoir blessé Geneviève Legay] va être chargée d’enquêter. Et elle va aller voir Geneviève Legay pour lui demander d’identifier un journaliste comme étant l’auteur des violences.
Et toi, tu vas essayer par tes propres moyens et notamment par les réseaux sociaux, de mener une espèce d’enquête parallèle rapide ?
Quand tu sais que les preuves vont disparaître, que les témoins vont s’évanouir ; quand tu sais que les enquêteurs et le procureur vont protéger les policiers, tu n’as pas d’autres possibilités que de devenir toi-même policier…
Et ça marche dans le dossier Geneviève Legay ?
Et ça marche, mais pas tout seul. Seul, tu ne peux pas. D’abord parce que tu n’as pas les moyens d’un détective privé. Donc tu travailles avec les journalistes. Sans eux, il n’y aurait pas de révélation sur les affaires de violences policières. Il y a un travail commun avec Pascale Pascariello de Mediapart, qui est une journaliste extraordinaire. Moi, avec l’appel à témoins sur Twitter et elle avec les révélations dans l’épaisseur de la police et de l’État, on arrive à faire sauter le bouchon.
Il y a un de tes dossiers les plus emblématiques où tu vas mettre en place ce même système et qui va permettre des révélations. C’est l’affaire Chouviat. Comment tu te retrouves sur cette affaire ?
Je suis appelé par le beau-frère de Cédric. Il sent qu’il y a quelque chose de bizarre, alors même que les policiers disent que c’est « un malaise cardiaque ». Je viens directement à l’hôpital Georges Pompidou. C’était un moment… Je m’en souviendrais toute ma vie [il s’interrompt pour contenir ses émotions]. Quand tu vois un corps sur une table, qui respire encore parce que les machines le font respirer, et que tu apprends qu’il est mort quand même… Et toute la famille est autour, avec une sorte de ferveur parce que c’est une grande famille. Tu te dis : là il faut être à la hauteur.
À LIRE AUSSI : Cédric Chouviat a dit sept fois : « J’étouffe » avant de mourir
J’arrive chez moi : qu’est-ce qu’on fait ? Je n’ai pas d’enquête donc je prends ce que j’ai sous la main, c’est-à-dire mon téléphone. Je fais un appel à témoins. J’attends un jour, deux jours, rien. On est le week-end. J’arrive le lundi au cabinet, sur le répondeur, j’ai deux messages.
Il y a un chauffeur Uber. Je l’appelle. Je lui dis : « Vous y étiez ? » « Oui. » « Est-ce qu’on peut se voir ? » « Oui. » Il vient et me dit : « J’ai vu tout et j’ai même filmé ».
C’est souvent grâce à des gens qui sont là avec leur téléphone que l’on peut avoir une révélation. Tout le monde devient un peu journaliste sans le savoir.
Ça m’amène à un autre dossier : l’affaire de l’île Saint-Denis. Dans ce dossier aussi la vidéo sera déterminante.
C’est encore plus incroyable. Je suis contacté par Taha Bouhafs qui est journaliste et qui lui-même a été contacté par des riverains. Deux jeunes gens. Et hasard de l’histoire, un ingénieur du son va mettre son micro professionnel sur le rebord de son jardin, juste devant la camionnette où Samir va être victime de violences et d’injures à caractère raciste. Et son frère filme en même temps. Donc on a des images et un son incroyables. Taha Bouhafs m’appelle et on retrouve Samir qui a déjà été interrogé par l’Inspection générale de la Police nationale (IGPN).
Je voulais te parler d’un autre de tes clients : Taha Bouhafs.
La première fois que j’ai rencontré Taha, c’est à mon cabinet. Il est venu comme journaliste pour un dossier. C’est devenu par la suite une amitié véritable malgré tout ce qu’il a vécu… et que j’ai vécu parce que j’étais son ami. En fait, je pense que ce qu’on représente tous les deux peut surprendre. Un gamin Algérien d’Échirolles (38) sans parcours académique, né dans les luttes. Et un gamin juif de Sarcelles (95), devenu avocat, un peu bourgeois. On se retrouve pour défendre ensemble des victimes de violences policières raciales. C’est quelque chose qui est compliqué à admettre, je pense, dans le conservatisme français.
Tu vas aussi le défendre après qu’il ait été victime de violences policières…
L’histoire, c’est Taha qui va sur un piquet de grève de travailleurs sans papiers, au sein d’un entrepôt Chronopost pour raconter le mouvement social, comme il le fait pratiquement tous les matins à 5h, à cette époque. Il raconte les luttes. Et un policier de la Brigade anti-criminalité (Bac) commence à le pousser pour ne pas qu’il filme. C’est-à-dire qu’il lui interdit de faire son travail, et de manière un peu violente. Et là, il est mis au sol. Son épaule est luxée. Il est menotté, frappé dans une voiture et c’est lui qui est poursuivi.
Et le parquet fait un truc très malin : au lieu de demander aux policiers de regarder les images qu’il avait prises, ce qui permettait d’avoir une vérité, il va mettre le téléphone sous scellé pour empêcher l’exploitation des images.
Tu réagis comment ?
On dépose plainte immédiatement. Il se trouve que l’enquête de l’IGPN va permettre d’empêcher la justice de le faire condamner. Et puis elle nous permettra d’avoir une enquête sur ce qui s’est passé avec plein de témoignages et toutes les vidéos qui ont été récupérées. Malgré l’évidence, on a un parquet qui va classer. On va devoir nous-mêmes poursuivre ce policier et on l’a fait condamner.
Pour la petite histoire, ce policier avait déjà été condamné quelques mois auparavant pour des violences conjugales, à savoir, avoir mis un flingue sur sa conjointe de l’époque qui était elle-même policière en la menaçant de mort. Autant dire que, et je l’ai dit au tribunal, la violence se pérennise. Et c’est parce que la justice ne prend pas la mesure de cette violence qu’elle se reproduit. Cet exemple est vraiment très important pour comprendre la reproduction de la violence au sein du corps policier.
À LIRE AUSSI : « Violences policières, le combat des familles », le nouveau documentaire de StreetPress
NE MANQUEZ RIEN DE STREETPRESS,
ABONNEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER


